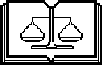|
|
Dernières notes de lecture et archives >>> |
|
-
BLANCHARD
(Francis)
L’Organisation internationale du travail. De
la guerre froide à un nouvel ordre mondial
Paris, Seuil, 2004, 312 p.
et
MERCIER
(Michèle)
Le Comité international de la Croix-Rouge.
L’action humanitaire dans le nouveau contexte mondial
Lausanne, Presses polytechniques & universitaires romandes,
2004, 126 p., coll. Le savoir suisse
-
FERRAND
(Jérôme) et PETIT (Hugues) (eds)
Enjeux et perspectives des droits de l’Homme
Paris :
L’Harmattan, 2004, 3 volumes.
-
AL-MIDANI
(Mohammed
Amin)
Strasbourg : Université Marc Bloch de Strasbourg/Association des
publications de la Faculté théologique protestante, 2003, 141 p.
(ISSN : 1146-5808). [cette note de lecture figure également
dans la bibliographie "Islam et droits de
l'Homme"]
-
LTAEIF
(Wassila)
Thèse pour le
Doctorat en droit, soutenue le 20 mars 2004 à la Faculté de Droit de
Rouen
[cette note de lecture figure
également dans la
bibliographie "Islam et droits de l'Homme"]
-
KOVÁCS
(Peter) (ed.)
Historia ante portas. L’histoire en droit
international/History in International Law
Miskolc : Peter Pazmany Catholic University/Miskolc University,
2004, 362 p. (ISBN : 963 9466 84 0)
-
KORCHIA
(Nathalie) et PETTITI (Christophe) (sous la
coordination de)
Sport et garanties fondamentales. Violences
–Dopages/Sports and fundamental guarantees. Assault - Doping
Paris : Dafné,
2003, 712 p. – Institut de formation en droits de l’Homme du Barreau
de Paris/ Association internationale de droit du sport (ISBN :
2-9520431-0-8)
|
|

|
|
BLANCHARD
(Francis)
L’Organisation
internationale du travail. De la guerre froide à un nouvel ordre
mondial
Paris, Seuil, 2004, 312 p.
et
MERCIER
(Michèle)
Le Comité
international de la Croix-Rouge. L’action humanitaire dans le
nouveau contexte mondial
Lausanne, Presses polytechniques & universitaires romandes,
2004, 126 p., coll. Le savoir suisse |
|
Ces deux livres sur
ces vénérables institutions internationales atypiques confrontées
aux mutations de l’après-guerre froide ne sont pas des ouvrages de
Droit, bien que les considérations juridiques y abondent. Ils ne
relèvent pas non plus de la littérature scientifique des Relations
internationales, même s’ils apportent d’utiles informations sur la
sociologie des organisations internationales. Il s’agit de
témoignages de praticiens (respectivement Directeur général du BIT
de 1974 à 1989 et membre du CICR durant 25 ans) et de réflexions sur
l’avenir de ces organisations dans un monde en transition qui
permettent une meilleure compréhension de l’action tant normative
qu’opérationnelle que déploient, chacun à leur façon, ces deux
acteurs internationaux, ainsi que des défis auxquels ils sont
confrontés.
Ainsi que le note
dans sa préface M. Philippe Séguin, le livre de M. Blanchard « ne
s’inscrit dans aucune catégorie connue. Il ne s’agit pas de
Mémoires, mais la précision poétique des souvenirs (…) ferait
honneur aux meilleurs ouvrages du genre. Il ne s’agit pas davantage
d’un ouvrage savant sur l’OIT (…). Et pourtant il recèle une mine
d’informations de première main, sans doute inaccessibles dans les
archives, ainsi que des réflexions d’une grande richesse sur un
chapitre essentiel de l’histoire contemporaine, celui du basculement
de la guerre froide à la mondialisation». Des mémoires ce curieux
opus emprunte la trame chronologique, ce qui, allié à un style
classique, offre une certaine facilité de lecture. Les amateurs de
systèmes se désoleront toutefois de son absence de structure : les
portraits de célébrités et de personnalités qui auraient gagné à
l’être alternent avec les chroniques diplomatiques (correspondance
entre Henry Kissinger et l’auteur et entre celui-ci et l’ambassadeur
de Pologne reproduite en annexes), les idées politiques et les
observations juridiques – ces dernières étant cependant
insuffisamment développées, mais il est vrai que l’auteur a été
formé à Sciences Po… Enfin, ce livre qui ne ressemble à rien
s’achève sur la proposition de créer, à Genève, un Conseil de
sécurité économique qui « constituerait un signe fort de la volonté
politique des Etats membres d’inscrire dans le long terme les
objectifs écologiques, sociaux et humains en lieu et place des
logiques purement économiques et financières » (p. 282).
L’ouvrage de Mme
Mercier (à qui l’on doit déjà Crimes sans châtiment : l’action
humanitaire en ex-Yougoslavie 1991-1993 paru en 1994 dans la
collection Axes chez Bruylant et la LGDJ) est de facture plus
académique comme le laisse deviner sa parution dans une collection
universitaire. Son apport essentiel est la vue de l’intérieur du
CICR et la description des hommes et femmes qui œuvrent pour lui,
sans jamais sombrer dans l’anecdote (pp.81-113). Comme le sous-titre
l’indique, ce livre témoigne notamment des changements puisque le
« temps est passé où, sous la seule protection de son drapeau, le
CICR pouvait se mouvoir d’un camp à l’autre pour accomplir ses
tâches » (p.13) et désormais les délégués sont pris pour cibles en
tant qu’Occidentaux chrétiens. A un moindre degré de gravité, on
notera que « l’anglais devenu la lingua franca de
l’institution » (p. 34) et que l’Université de Harvard concurrence
désormais le CICR comme référence en matière de droit international
humanitaire (pp. 37-38). L’auteur traite aussi rapports du CICR avec
les Etats – notamment avec la France, Paris étant « une plateforme
de première importance pour le CICR s’agissant du traitement de ses
dossiers africains les plus chauds » (p. 57), ou les Etats-Unis (pp.
41-50) – mais aussi de la collaboration avec les Nations Unies pour
laquelle le CICR « veut éviter le piège de l’harmonie à tout prix.
Il lui préfère une complémentarité renforcée (…) Il est prêt à aller
jusqu’à un concubinage de bon aloi, mais se refuse au mariage avec
qui que ce soit.» (p. 70) et des relations avec l’organisation
« sœur », la Fédération internationale des Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (pp. 71-80). Si le droit n’est
évidemment pas absent de cette monographie, l’intérêt essentiel de
celle-ci est donc d’offrir une vision plus vivante (et plus
préoccupante) de l’institution genevoise que les écrits quelque peu
secs et désincarnés des publications officielles du CICR.
Philippe Ch.-A. Guillot
|
|

|
|
FERRAND
(Jérôme) et PETIT (Hugues) (eds)
Enjeux et
perspectives des droits de l’Homme
Paris :
L’Harmattan, 2004, 3 volumes. |
|
Un colloque
intitulé 2001, l’Odyssée des droits de l’Homme
organisé par le Centre historique et juridique des droits de l’Homme
avec la collaboration du Centre de droit fondamental, du Groupe de
recherche sur les coopérations européennes et régionales de
l’Université Pierre Mendès France de Grenoble II et le réseau des
droits fondamentaux de l’Agence universitaire de la Francophonie,
s’était tenu à Grenoble les 22, 23 et 24 octobre 2001.Ayant pour but de faire une « synthèse » sur les droits de
l’Homme, notamment sur leur naissance, leur reconnaissance, leur
mise en application, leur évolution et leur avenir, tant dans
l’ordre interne qu’international, d’un point de vue juridique mais
aussi historique, politique, sociologique, économique, etc., ce
Colloque international regroupant des universitaires de différents
pays, a abordé de façon remarquable la plupart des grands thèmes des
droits de l’Homme. Aujourd’hui l’ensemble des communications ont été
rassemblées par Jérôme Ferrand et Hugues Petit dans un ouvrage
comportant trois tomes.
Dans un premier
tome intitulé Fondations et naissances des droits de l’Homme,
les articles sont regroupés sous deux titres : « Fondations » et
« Naissances ». L’approche des droits de l’Homme se fait au regard
de l’histoire (par exemple, l’article de Laurent Reverso « La
pensée juridique romaine face aux « Droits de l’Homme » : l’exemple
de Cicéron »), mais aussi au regard de la religion (par exemple,
l‘article de Jean Chelini «La réception des droits de l’Homme
dans la doctrine catholique de Jean XXIII dans Pacem in terris »).
Les droits de l’homme y sont aussi abordés d’une manière générale,
philosophiquement et théoriquement, mais aussi géographiquement
(plusieurs textes sont consacrés à l’évolution de la naissance des
droits de l’Homme dans des pays particuliers) et dans un domaine
précis relatif aux droits de l’Homme (tel le rapport entre les
droits de l’Homme et le droit du travail, par exemple).
Le deuxième tome
sur Les mises en oeuvre des droits de l’Homme regroupe
plusieurs articles qui portent sur la question de l’application de
certains droits de l’Homme (par exemple, l’article de Marc Frangi « Le
Conseil constitutionnel et la question linguistique en France »)
et de l’application des droits de l’Homme dans certains pays (par
exemple, l’article de Georges Saad « La réception des droits de
l’Homme en droit administratif libanais »).
Le dernier tome
enfin traite des Enjeux et perspectives des droits de
l’Homme. Il évoque l’évolution des droits de l’Homme en tant que
tels, mais aussi l’évolution de certains droits (cf. l’article de
Jean-Marie Breton « Du droit de l’environnement au droit à
l’environnement : quête humaine et ‘odyssée’ normative ») ou
l’apparition de droits d’une importance nouvelle dans le domaine
des droits de l’Homme (cf. l’article de Constance Chevallier-Govers
« Le droit à la protection des données à caractère personnel : un
droit fondamental au XXIème siècle ? » ) ou encore l’évolution
des droits de l’Homme par rapport à l’évolution de notre société
(cf. l’article de Joseph Yacoub « A l’épreuve des civilisations
et des cultures: repenser les droits de l’Homme »). En effet,
dans ce troisième tome, est souvent abordée la notion de
l’universalité des droits de l’Homme, à savoir si elle est réelle,
partielle ou complète (cf. l’article d’Alione Badara Fall « Universalité
des droits de l’Homme et pluralité juridique en Afrique : analyse
d’un paradoxe » ), ainsi que le devenir de cette universalité et
de ces droits.
D’une manière
générale, cette publication offre un panorama assez complet sur les
droits de l’Homme. Elle aborde tout autant les questions classiques
et fondamentales que les questions plus modernes de la
concrétisation de ces droits. Certaines contributions donnent une
vision générale des droits de l’Homme tout en abordant des thèmes
peu courants et très précis. La « synthèse » sur l’état des droits
de l’Homme semble réussie d’autant plus qu’elle présente une
approche pluridisciplinaire du sujet abordé qui touche souvent
d’autres domaines tels que la philosophie, la science, la religion
et la culture, tout en restant un ouvrage juridique. C‘est ce
mélange des genres qui fait réellement de la publication de ces
Actes un ouvrage complet sur le thème des droits de l’Homme et
abordable tant par des juristes que par des spécialistes ou non
spécialistes d’autres matières. Ces différents tomes peuvent être
lus à la suite puisqu’ils s’inscrivent dans une logique, mais chacun
se suffit à lui-même dans la mesure où chaque tome regroupe des
thèmes d’une immense ampleur. A l’intérieur même de chaque tome les
contributions peuvent aborder parfois le même sujet, mais la
différence « d’appréhension » de ce sujet par les auteurs ne leur
fait pas perdre leur qualité. Enfin, certains articles abordent des
sujets pointus qui peuvent apparaître comme des détails dans la
généralité de ce thème, mais le lecteur plus spécialiste y trouvera
toujours quelque intérêt. Ils montrent là encore l’incidence des
droits de l’Homme sur d’autres branches du droit et dans d’autres
domaines et, sur ce point, « l’universalité » des droits de l’Homme
n’est plus à démontrer.
Hélène Apchain
|
|

|
|
AL-MIDANI
(Mohammed Amin)
Les droits de l’Homme et l’Islam. Textes des
organisations arabes et islamiques
Strasbourg : Université Marc Bloch de Strasbourg/Association des
publications de la Faculté théologique protestante, 2003, 141 p.
(ISSN : 1146-5808).
|
Comme le note Jean-François Collange dans la préface à ce
petit ouvrage, « A l’heure où certains parlent de « choc des
civilisations » ou d’ « axe du Mal », la question des droits de
l’Homme et de l’Islam se pose avec une acuité particulière ». C’est
donc le premier mérite de Mohammed Amin Al-Midani que d’avoir réuni
et présenté les textes de base adoptés par les organisations arabes
et islamiques (Ligue des Etats arabes, Organisation de la conférence
islamique et ONG) dans ce domaine. Le second mérite de l’auteur est
de permettre un retour aux textes toujours utile, et même
indispensable dans des matières aussi controversées.
Certes le choix des
textes peut être discuté dans le détail. Pourquoi reproduire la
Charte de la Ligue des Etats arabes puisqu’il est affirmé qu’elle
« ne contient aucune disposition relative aux droits de l’Homme ».
De même, on aurait pu se limiter à reproduire les dispositions
pertinentes de la Charte de l’Organisation de la Conférence
islamique. Toutefois, dans l’ensemble le choix des textes est
judicieux et permet utilement d’éclairer les débats actuels, y
compris sur le terrorisme ou la torture. Cependant, il est permis de
regretter que la Charte des droits de l’enfant arabe, adoptée en
1983, ne figure pas dans l’ouvrage, d’autant plus que l’auteur
indique qu’il n’existe pas jusqu’à présent de version française de
cette Charte (p. 9, note’ 18).
Dans l’ensemble il
s’agit de textes relativement anciens et déjà connus, du moins des
spécialistes, mais l’auteur nous offre d’utiles clés de lecture dans
un « avant-propos » qui constitue en réalité une introduction
substantielle, ainsi que dans des « présentations » précises et
critiques, qui accompagnent chacun des textes. Celles-ci sont
toujours utiles, mais parfois trop brèves et trop concises. Le
lecteur s’interrogera, par exemple, sur la situation de la Charte
arabe des droits de l’Homme de 1994, signée par un Etat et ratifiée
par aucun, mais il ne trouvera aucune explication à une telle
situation ! De manière plus générale, on peut se demander si dans le
monde arabe et musulman, comme ailleurs – ou plus qu’ailleurs ? –
les textes ne restent pas trop souvent lettre morte. D’autre part,
ce qui est inquiétant, c’est l’absence quasi-totale de mécanismes de
mise en œuvre de ces chartes, conventions ou déclarations.
On peut aussi poser
la question de savoir si les Etats arabes et musulmans n’acceptent
pas plus facilement les instruments universels en matière de droits
de l’Homme et se soumettent même à certaines procédures de contrôle
international, et, en outre, pourquoi en est-il ainsi ? Si une telle
constatation était vérifiée, cela serait relativement encourageant
quant à l’universalité des droits de l’Homme plus que jamais
nécessaire.
Paul Tavernier
|
|

|
|
LTAEIF
(Wassila)
La liberté de mariage au Maghreb : dimension
historique et perspective contemporaine
Thèse pour le
Doctorat en droit, soutenue le 20 mars 2004 à la Faculté de Droit de
Rouen |
|
C’est un thèse
volumineuse (843 pages de texte + glossaire + bibliographie +
annexes), mais bien rédigée et enrichie par une bibliographie
abondante et précise et des annexes dont certaines totalement
inédites (rapports de police sur « l’affaire » Tahar Haddad, à
Tunis, en 1930). La thèse aborde une question essentielle au cœur du
débat sur le statut de la femme qui agite les sociétés maghrébines,
la liberté de mariage. L’approche du sujet n’a pas seulement été
comparative mais aussi interdisciplinaire, conjuguant approche
historique, sociologique et juridique du mariage au Maghreb.
Le droit de chaque pays
porte les marques de son histoire et de ses fondements
socio-économiques. Aussi, malgré un référent religieux commun, les
trois nations veulent affirmer leur particularisme. La situation de
la femme tunisienne n’est en effet pas identique à celle de ses
consoeurs algériennes et marocaines du fait du modernisme
volontariste impulsé par Habib Bourguiba. Ni les souverains
marocains, ni les présidents algériens n’ont eu l’audace du Raïs
tunisien pour mettre fin à la polygamie et à la répudiation bien que
la réforme de la
Moudawana
au Maroc (2003) et le projet de révision du Code de la famille
algérien (2004) aient introduit quelques changements mineurs (âge du
mariage, tutelle, restriction de la polygamie et de la répudiation,
garde des enfants, etc.). Les « réformettes » à la mode algérienne
ou marocaine traduisent la difficulté à concilier tradition et
modernité dans les sociétés arabo-islamiques.
La thèse est structurée
en trois parties qui portent respectivement sur l’héritage
historique islamique et colonial (p. 1-330), sur la mise en place
des législations nationales après les indépendances maghrébines (p.
331-634), et sur la confrontation de ces législations nationales au
droit international des droits de l’Homme (p. 635-836).
L’auteur fait une excellente synthèse historique des fondements
religieux du droit de la famille sans oublier d’examiner les
traditions matrimoniales berbères. Le mariage tout comme l’héritage
et plus généralement le droit familial, est au coeur de la
shari’a,
la loi musulmane dont l’application relève du Cadi et non du Prince.
Le mariage au Maghreb et à travers lui le statut personnel est
étroitement lié à la religion musulmane. C’est au nom de l’Islam que
des discriminations en raison du sexe ou de la religion sont
maintenues dans le droit du mariage, la Tunisie ne faisant
semble-t-il pas exception, en dépit d’avancées notable par rapport à
ses voisins.
Les deuxième et
troisième parties plus juridiques sont consacrées au droit positif
des pays maghrébins accordant une place importante à la doctrine au
détriment parfois de l’analyse et du débat sur les textes et la
jurisprudence. L’analyse des fondements sociaux et politiques,
juridiques et historiques du droit du mariage, n’oublie pas de faire
une place à l’idéal contemporain des droits de l’Homme abordé plus
spécifiquement en troisième partie. Mlle Ltaeif se demande « si
l’ouverture aux conventions internationales n’est pas une brèche
dans les systèmes juridiques internes pour tempérer un excès de
conservatisme ? ». La réponse à cette question doit être nuancée,
tant les résistances sont fortes au sein des Etats dont les pouvoirs
sont soucieux d’acheter la paix sociale (opposition des mouvements
islamistes et des confréries religieuses) au détriment des
réformes. En définitive, l’égalité juridique dans le mariage n’a de
sens au Maghreb que si elle s‘inscrit dans un processus plus large
de démocratisation et d’enracinement de l’Etat de droit.
Abdelwahab Biad
|
|

|
|
KOVÁCS
(Peter) (ed.)
Historia ante portas. L’histoire en droit international/History in
International Law
Miskolc : Peter Pazmany Catholic University/Miskolc University,
2004, 362 p. (ISBN : 963 9466 84 0) |
|
Cet ouvrage réunit
des contributions d’auteurs hongrois et étrangers, écrites en
français, en anglais et en allemand. Elles concernent l’évolution de
la doctrine du droit international, mais aussi des études de cas
concrets, anciens ou présentant un intérêt renouvelé. Plusieurs
d’entre elles abordent les questions relatives aux droits de l’Homme
et au droit humanitaire.
On
notera en particulier :
-
Eszter KIRS, « Saint-Stephen’s legacy, immigration and foreign
policy in Hungary in the X-XIst Century »
-
Katalin SISKA, “Historical and legal perspectives of the right
of asylum and extradition until the XIXth Century”
-
Simeon
KARAGIANNIS, « Des traités d’échange de populations au nettoyage
ethnique »
-
Dinah SHELTON, « The world of atonement : reparations for
historical injustices »
-
József GEHER,
“Le destin juridique des oeuvres d’art hongroises enlevées de
Russie”
-
Csaba PAKODZY,
« Les effets de la deuxième guerre mondiale dans la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme sur la
liberté d’expression ».
Tous ces articles
sont disponibles également sur Internet :
www.uni-miskolc.hu/~wwwdrint/mjilarticles.htm.
Cet ouvrage n’a pas
la prétention de couvrir tous les aspects trop souvent négligés de
l’influence croissante de l’histoire et du passé dans les relations
internationales et dans le droit international, et plus
particulièrement dans le droit international des droits de l’Homme
et le droit humanitaire, mais il apporte certainement des éclairages
intéressants et originaux sur des situations parfois peu connues. La
préoccupation et le poids du passé se reflètent par exemple de plus
en plus dans le développement des commissions « vérité et
réconciliation », mais aussi dans la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’Homme, surtout après les bouleversements
de la carte de l’Europe depuis 1990. Des études plus complètes
mériteraient d’être entreprises. L’ouvrage publié sous la direction
de Peter KOVACS pourrait donc susciter de nouveaux projets plus
ambitieux et plus systématiques.
Paul Tavernier
|
|

|
|
KORCHIA
(Nathalie) et PETTITI (Christophe)
(sous la coordination de)
Sport et garanties fondamentales. Violences –Dopages/Sports and
fundamental guarantees. Assault - Doping
Paris : Dafné,
2003, 712 p. – Institut de formation en droits de l’Homme du Barreau
de Paris/ Association internationale de droit du sport (ISBN :
2-9520431-0-8) |
|
Cet ouvrage est
issu des travaux du 7ème Congrès international de
l’Association internationale du droit du sport, co-organisé par
l’Institut de formation en droits de l’Homme du Barreau de Paris et
qui s’est tenu à Paris les 30 novembre et 1er décembre
2000. Mais il a été complété par des communications hors congrès. Il
réunit une somme d’informations et de réflexions considérable dans
un domaine neuf. Le sport est de plus en plus saisi par le droit et
par les procédures juridictionnelles comme en témoigne le fameux
arrêt Bosman de 1995 rendu par la Cour de Justice des
Communautés européennes, mais aussi la création du Tribunal arbitral
du sport en 1984. Bien que la Cour européenne des droits de l’Homme
ne se soit pas encore penchée sur les problèmes du sport, la
protection des droits de l’Homme dans le sport soulève d’ores et
déjà des questions et on peut s’interroger sur l’émergence d’un
nouveau droit de l’Homme : le droit au sport. L’accent a été mis sur
les violences dans le sport et sur le dopage. Les deux Conventions
du Conseil de l’Europe de 1985 et 1989 sont reproduites en annexe
(en français et en anglais). Les questions abordées dans cet ouvrage
sont extrêmement nombreuses et variées et ne sont pas traitées
uniquement sous l’angle juridique et par des juristes. La réflexion
porte sur les aspects nationaux, internationaux et européens des
problèmes. Les contributions sont traduites ou résumées en français
ou en anglais selon la langue d’origine. Le public touché par cette
publication devrait donc être très large et la lecture est facilitée
par un index dans les deux langues.
Paul Tavernier
|
|

|
|
|