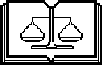Le sujet de l'affaire était peut-être plus difficile car plus sensible que les autres ingérences dans la liberté d'expression dont a pu connaître la Cour. L'affaire soulevait indirectement le problème de l'appréciation du comportement du gouvernement de Vichy sous l'Occupation et des faits de collaboration à la lumière de l'Holocauste, à propos d'un texte défendant la mémoire de l'un des principaux protagonistes de cette histoire, le maréchal Pétain.
On ne se retrouve pas devant un arrêt de principe comme purent l'être les arrêts Handyside ou Sunday Times. Pourtant le sujet aurait pu s'y prêter puisqu'il s'agit de savoir quelle liberté d'opinion et d'expression accorder à des idées ou à la défense d'un régime ou d'un homme, contraires aux idéaux de la démocratie tels qu'ils sont défendus par la Convention. C'est donc à un arrêt classique que s'en tient la Cour parce qu'elle poursuit sa jurisprudence traditionnelle tant sur l'article 10 que sur l'article 17.
Le refus d'examiner séparément l'article 17 est une position très ancienne de la Cour. Elle a une signification libérale. Invoquée très systématiquement au début de la mise en application de la Convention, la disposition ne fut plus utilisée car elle était systématiquement rejetée. Par sa généralité elle aurait permis de limiter trop gravement les libertés elles-mêmes sous le prétexte de les protéger. L'arrêt De Becker a clairement indiqué que l'article 17 n'avait qu'une portée limitée et ne pouvait s'appliquer à ceux qui menaçaient le régime démocratique que dans une mesure strictement proportionnée à la gravité et à la durée de la menace. Cette disposition constitue donc plutôt un principe d'interprétation qu'une règle à part entière. Ceci justifie qu'elle ne soit jamais examinée séparément des autres droits conventionnels.
La Cour a encore maintenu sa position traditionnelle en ce qui concerne les restrictions à la liberté d'expression. Malgré la demande d'une marge d'appréciation plus grande, elle maintient un contrôle strict de la restriction. Elle écarte, en effet, les deux principaux arguments invoqués par la défense.
Le premier veut prendre appui sur la nature du texte qui ne lui permettrait pas de profiter de la protection de l'article 10 : un encart publicitaire ne peut pas se réclamer de la liberté qui s'attache à un débat historique sérieux. Par différents arguments la France aurait voulu voir consacrer l'idée que la liberté d'expression ne vaudrait que pour un débat sérieux et objectif. Le juge européen, à juste titre, a refusé d'entrer dans cette voie qui réserverait la liberté d'expression à certains organes, personnes, moyens ou méthodes jugés sérieux. La liberté d'expression doit pouvoir emprunter tous les moyens ou toutes les formes de communication qui lui agrée sans avoir à recevoir une estampille de sérieux par l'État ou le juge. Le contenu doit suffire à écarter le caractère commercial que la France aurait voulu voir reconnaître au fait d'utiliser un encart publicitaire consistant d'ailleurs exclusivement en un texte écrit. Quant à l'objectivité d'un débat historique et politique, il est encore heureux que le juge européen ne soit pas entré dans une conception scientiste de l'histoire. Ni le juge ni l'État n'ont à fixer les critères de participation à un débat historique et politique ; en démocratie ils ne sauraient être réservés à quelques uns ; ce qui ne veut pas dire que la communauté académique des historiens n'aient pas le droit de définir les critères du sérieux et de la science historique mais que ce rôle n'appartient pas aux organes de l'État. Le critère de l'objectivité appartient à l'évidence à la seule communauté scientifique, mais jamais à l'État, sous peine de retrouver les pratiques de l'ancienne Union soviétique ou des habitudes dignes de l'Ancien Régime.
Le second argument de la France s'appuyait sur une jurisprudence de la Cour effectivement limitative de la liberté d'expression. En raison du caractère subjectif de l'idée de patrie -était-il soutenu-, il ne saurait en exister de conception uniforme ou commune en Europe et il en résulterait donc une grande marge d'appréciation pour l'État. Par ailleurs, le sujet du débat étant sensible et faisant référence à une histoire propre à la France, le gouvernement peut seul apprécier utilement la portée et les mesures de protection de la sensibilité de l'opinion qui s'imposent. La France invoquait ici la jurisprudence Otto-Preminger Institut et Wingrove, elles-mêmes inspirées de l'arrêt Handyside. Mais la Cour n'a pas fait droit à cet argument. La jurisprudence citée est réservée au domaine de la religion et de la morale. Dans les autres domaines de la liberté d'expression elle maintient un strict contrôle de la marge d'appréciation des États. La prudence dont la Cour fait preuve lorsqu'il n'y a pas de morale commune européenne s'explique par rapport à des moeurs en évolution. Le juge n'a pas à anticiper une évolution de la société qui se prête encore à de fortes oppositions. Il ne peut en être de même à l'évidence en matière politique et historique. Ce sont là des sujets où il est normal qu'il y ait affrontements et oppositions. On ne saurait donc invoquer une opinion commune, ou son absence, pour mesurer la marge d'appréciation ou la portée du contrôle juridictionnel.
Une protection particulière de la liberté d'expression en matière politique ou de débats généraux
La décision de la Cour ne peut se comprendre si on ne tient pas compte à la fois de la distinction qu'elle établit entre le domaine politique ou des débats généraux et celui qui touche à la morale et à la religion qu'elle estime plus sensible. En matière politique ou générale la protection de la liberté d'expression est renforcée parce que, depuis l'arrêt Handyside, la Cour considère que c'est un des éléments fondamentaux de la conception pluraliste de la démocratie que protège la Convention. Le pluralisme autorise l'expression d'idées qui choquent ou heurtent.
Dans des formulations souvent implicites la Cour a mis en oeuvre des conceptions qui renforcent la liberté d'expression. En se référant à l'ancienneté des faits (§55), on peut penser qu'elle entend assurer la liberté du débat sur des faits historiques.
Par ailleurs, dans la suite de l'arrêt Jersild, la Cour a fait prévaloir une approche subjective de l'intention par rapport à l'approche purement objective de la notion de diffusion de propos racistes ou de propos favorables à un régime politique ayant pratiqué et défendu une politique de collaboration. Le fait qu'elle relève que les requérants se sont explicitement démarqués des actes du régime nazi, montre que contrairement à ce que semble exiger la convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations, elle n'entend pas réprimer purement et simplement le seul fait objectif de la diffusion. Cette distinction aurait été un peu plus claire et mieux fondée si la Cour avait approfondi la remarque selon laquelle on ne pouvait déduire "des termes du texte incriminé que le fait pour les requérants d'exprimer leurs idées constituât une "activité" au sens de l'article 17"(§ 37). La Cour indique en passant ce qui constitue un critère très important dans la tradition libérale pour savoir quelles sont les opinions qui doivent être interdites. L'article 17 ne vise, en effet, que le fait de "se livrer à une activité ou d'accomplir un acte". Il faut séparer les actions et les opinions et ne pas considérer les opinions comme des actions tant qu'elles n'en sont pas la préparation directe. C'est l'une des options fondamentales de la loi française de 1881 lorsqu'elle poursuit la provocation à commettre des actions qualifiées crimes ou délits. Toute la question est donc de savoir si exprimer des idées constitue une action. Si on ne devait pas faire la distinction, il ne subsisterait rapidement plus aucune opposition ou discours contestataire. C'est bien le sens qu'il faut donner à la grande réserve de la Cour à l'égard d'une invocation trop fréquente de l'article 17. C'est tout l'enjeu des notions de provocation ou d'apologie mises en oeuvre par la Cour de cassation. Il est évident qu'il est une façon d'entendre l'apologie qui réduit à fort peu de chose la liberté d'opinion et d'expression. Historiquement cette question fut illustrée par la répression des opinions anarchistes à la fin du 19e siècle : dès que l'apologie de l'anarchie ne fut plus liée, à supposer qu'elle l'ait toujours été, aux attentats anarchistes, la répression de l'apologie devint la poursuite d'un délit d'opinion.
L'attention de la Cour européenne des droits de l’Homme devait donc se fixer sur la façon dont la Cour de cassation entend l'apologie du crime de collaboration et c'est sur ce point que la condamnation va porter. Celle-ci a apprécié la notion dans l'absolu, c'est-à-dire sans tenir compte du contexte dans lequel l'apologie a eu lieu. Car il y a bien eu apologie puisque c'était l'objet même de l'association que d'obtenir la réhabilitation du maréchal Pétain. Mais à partir du moment où les requérants se sont clairement exprimés à l'égard du nazisme, la Cour entend que l'apologie soit appréciée à la lumière des circonstances d'ensemble de l'affaire : ancienneté des faits, intention subjective des auteurs qui se sont explicitement désolidarisés du nazisme. Pour que la répression d'une opinion soit justifiée, il faut qu'il y ait un lien suffisant entre l'apologie et le risque de commettre de nouveau les mêmes actes. Les circonstances montrent que la démocratie française n'était pas immédiatement menacée par un discours dont les éléments sont connus et diffusés depuis très longtemps, arguments que le travail historique dément d'ailleurs un peu plus chaque jour. La Cour a pu noter que le comportement des autorités françaises montrait qu'elles n'avaient certes pas immédiatement perçu les dangers que l'article publicitaire paru dans un quotidien faisait courir à la démocratie française. L'association au nom de laquelle les deux requérants s'exprimaient, existait depuis longtemps, était régulièrement constituée et n'avait jamais fait l'objet de poursuites et encore moins de menaces de dissolution. Tout ceci tend à montrer que l'ordre public qui justifie une protection et une limitation de la liberté d'expression doit être entendu de façon strict, c'est-à-dire largement matériel. Les menaces qui justifient l'ingérence doivent comporter des risques matériels suffisants. Ceux-ci sont constitués d'appel ou apologies directs à commettre des actions criminelles ou délictuelles. Quant aux idées mauvaises ou contraires à la démocratie, la Cour indique qu'il existe "d'autres moyens d'intervention et de réfutation" qu'une lourde condamnation pénale (§57).
Même si elle ne leur a pas donné une forme solennelle ou principielle, la Cour a repris ses principes classiques et fait application de la doctrine libérale en matière de liberté d'opinion et d'expression. Il est vrai qu'elle semble réserver cette doctrine libérale essentiellement aux débats politiques ou de nature générale ; elle devrait réexaminer dans le même sens libéral sa jurisprudence sur la liberté d'expression dans le domaine des moeurs et de la religion, celle-là même qui fut invoquée par la France pour justifier la répression dans cette affaire.
Paul Mahoney
Non seulement les juristes, mais aussi les non-juristes, et même les clients des cafés du commerce ont un point de vue sur les écoutes téléphoniques et sur les faits qui sont à l’origine de l’affaire Lehideux-Isorni... Je m’attends donc à un vif débat sur les rapports qui viennent d’être présentés.
Un intervenant dans la salle
En ce qui concerne l’argumentation de la Cour. Elle se défausse derrière le ministère public qui n’a pas poursuivi dans l’affaire Lehideux-Isorni. Vous avez dit une chose qui est vraie, mais en même temps, c’est la Cour en réalité qui se défausse. Dans l’affaire Jersild c/Danemark, elle reproche à un journaliste tout simplement d’avoir exercé son métier correctement et elle condamne l’Etat danois... Dans l’affaire Lehideux, elle dit que le gouvernement français aurait dû peut-être poursuivre et faire poursuivre de manière beaucoup plus explicite. Elle adopte deux positions différentes : elle souffle le chaud et le froid. Dans la première affaire, elle condamne le Danemark qui est impliqué normalement, mais dans l’affaire Lehideux, elle dit à la France qu’elle aurait dû faire quelque chose. C’est ce qui m’attriste dans le cheminement intellectuel de la Cour.
Patrice Rolland
Dans la position de la Cour à l’égard du ministère public français, il faut comprendre, me semble-t-il, dans quel contexte on se trouve. L’argument de la Cour est utilisé sous deux angles différents. La France invoque l’article 17 (on a le droit de se protéger contre des actions qui menacent les valeurs défendues par la Convention, c’est-à-dire les valeurs de liberté). La Cour doit dire : vous n’avez pas dissous les associations, vous ne les avez pas empêchées de s’exprimer et lorsqu’elles se sont exprimées vous ne les avez pas poursuivies. Il faut que le gouvernement soit logique : vous ne pouvez pas demander à la Cour effectivement de poursuivre et de condamner ce qu’il n’avait pas envie de condamner pour toutes sortes de raisons, puisque c’est à lui d’abord, selon le principe de subsidiarité, d’appliquer la Convention à la lumière des circonstances locales, etc. Je crois que c’est un peu la réponse du berger à la bergère. Le gouvernement invoque la menace de l’ordre public, républicain et démocratique, par les propos d’Isorni. Mais la Cour lui réplique : tout d’un coup si vous découvrez qu’il menace l’ordre public et les valeurs démocratiques, il y avait tout de même toutes les autres procédures à suivre avant. Autrement dit, c’est ce que j’ai appelé la présomption de respect de l’ordre public. Cette association existe depuis au moins 1960 en vue de faire réhabiliter le Maréchal Pétain ; elle n’émeut pas les foules outre mesure, et elle ne draine pas beaucoup de monde (mais les circonstances peuvent changer bien sûr et ce qui était anodin dix ans auparavant, peut devenir dangereux...) et c’est justement le rôle de l’Etat d’apprécier ce risque au premier chef. J’ai envie d’aller un peu plus loin ; c’est un rappel du principe de subsidiarité et j’admire le juge qui dit : commencez à faire le premier votre travail et à appliquer la Convention, à bien l’appliquer, avant de me demander de vous suppléer dans vos insuffisances ou vos hésitations. Je crois que l’argument est un peu circonstanciel car la France y est allé fort en invoquant l’article 17 qui n’est pratiquement plus jamais invoqué séparément. Je comprends un peu la réponse de la Cour.
Par rapport à l’arrêt Jersild, c’est un peu différent. Le Danemark avait manifestement une législation qui appliquait purement et simplement la Convention sur la discrimination. Or la France a fait une réserve explicite sur ce point là. Il n’était pas question d’appliquer la Convention sur la discrimination et de toucher aux principes traditionnels de la France en matière de liberté d’expression. C’est ce que M. Toubon avait oublié quand il a préparé son projet de loi relatif à la lutte contre le racisme. Il avait oublié cette réserve. Alors est-ce que le ministère de la Justice peut suspendre la réserve française (je ne suis pas un bon internationaliste) ? La réserve est quand même extrêmement typique : obligation d’édicter des dispositions répressives qui ne soient pas incompatibles avec les libertés d’expression, d’opinion, de réunion et qui sont garanties par ces textes (sous entendu la Déclaration universelle des droits de l’Homme, etc.) ; il y a là un sujet difficile, mais la France avait une position assez précise au départ.
Michèle Dubrocard
Je ne vais pas reprendre l’ensemble des arguments du gouvernement français dans l’affaire Lehideux-Isorni. Pour ceux qui sont intéressés, je les invite vivement à prendre connaissance du mémoire que le gouvernement français a adressé à la Cour. Il est relativement dense et la Cour ne reprend pas, loin s’en faut, tous les arguments développés par le gouvernement dans son mémoire.
Je vais répondre à deux questions.
Concernant le rôle du ministère public : ce n’est pas le ministère public qui juge, ce sont des juges qui ont pris une décision au niveau de la Cour d’appel, laquelle décision a été confirmée par d’autres juges au niveau de la Cour de cassation. Que le ministère public ait choisi de ne pas prendre des réquisitions en faveur de la condamnation est une chose, mais il ne faut pas oublier qu’en France ce n’est pas le ministère public qui juge, même si on lui reproche parfois son manque d’indépendance, ce n’est pas lui qui prend la décision en dernier lieu.
Pour ce qui est de l’Association légalement constituée, l’argument est très simple. Ce n’est pas parce qu’une Association est légalement constituée qu’elle peut se livrer à des activités contraires à l’ordre public et à la loi, et qu’elle ne puisse pas être condamnée. Mais je ne veux pas rentrer à nouveau dans le détail des arguments.
Ce qui est important, d’une manière beaucoup plus générale par rapport à la jurisprudence de la Cour, c’est que sa jurisprudence sur l’article 10 est certainement l’une des jurisprudences les plus contestées et parfois contestable. On a fait référence à l’affaire Jersild, on pourrait aussi faire référence à l’affaire Otto Preminger Institut, et surtout à l’affaire Wingrove. Ce que le gouvernement français avait soulevé dans le cadre de sa plaidoirie devant la Cour, c’était que la Cour européenne dans l’affaire Wingrove avait considéré qu’il y avait lieu de laisser une large marge d’appréciation aux autorités nationales quand il s’agissait des convictions religieuses d’une personne qui pouvait être offensée par la production d’un film vidéo sur les extases de Sainte Thérèse d’Avila. En établissant un parallèle, on ne voit pas pourquoi les autorités nationales ne disposeraient pas d’une marge d’appréciation à tout le moins similaire quand ce sont non pas des convictions religieuses qui sont en jeu, mais la mémoire d’hommes et de femmes qui ont été directement victimes de l’holocauste, et qu’ils ne puissent pas faire valoir des arguments par rapport à une période de l’histoire à laquelle, on le sait bien et cela n’est contesté par personne aujourd’hui, Philippe Pétain et son gouvernement ont pris directement part, ou ont eu en tout cas des complicités importantes. Cela est la vraie question.
Du point de vue de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, si on accepte qu’il y ait une marge d’appréciation en matière religieuse parce que les convictions religieuses de certaines personnes seraient offensées, on ne voit pas pourquoi d’autres personnes, dans un autre contexte, ne pourraient pas être offensées compte tenu de ce qu’elles ont vécu à une période donnée de leur histoire, elles ou leurs auteurs. Contrairement à ce que vous dites M. Rolland, je pense que l’arrêt Lehideux-Isorni est un arrêt où la Cour n’a fait preuve d’aucune prudence. La prudence la plus élémentaire dans cette affaire, c’était effectivement de laisser aux autorités nationales le soin d’apprécier par elles-mêmes s’il convenait de protéger ou pas la mémoire de certaines personnes. Je ne rentrerai pas une fois encore dans l’ensemble de l’argumentation qui a été utilisée, ce n’est pas une question passionnelle, c’est une question de cohérence de la Cour européenne vis-à-vis de l’article 10 et vis-à-vis de ce qu’elle entend sur la notion de marge d’appréciation.
Patrice Rolland
Je ne vais pas répondre longuement car c’est un immense débat. Sur le fait que la France ait utilisé les arguments de l’arrêt Otto Preminger et Wingrove, elle avait raison de les utiliser. Dans toute jurisprudence, il y a des choses qui ne sont pas dites et qu’on sent... Il est clair que la Cour fait des distinctions matérielles entre les sujets d’expression. Je ne les justifie pas nécessairement. Dans l’arrêt Otto Preminger, il y avait bien d’autres solutions que de justifier ce qu’avait fait l’Etat autrichien. Les affaires Otto Preminger et Wingrove ont quelque chose en commun. On ne peut pas parler des extases de Sainte Thérèse d’Avila comme cela. Ce sont des extases mises en scène, de type érotiques, extrêmement crues. Dans l’affaire Otto Preminger, c’est aussi le même sujet, entre Dieu, la Sainte Vierge et autres.... Dans ces deux arrêts la Cour refuse de traiter de la même façon l’expression des idées (politiques, portant sur des questions générales ou même religieuses) et la production d’images qui choisissent délibérément de choquer une frange de la sensibilité (ici catholique ou chrétienne). La Cour est beaucoup plus libérale pour l’expression intellectuelle que pour l’expression visuelle.
L’autre argument que je voudrais rappeler est le suivant : le gouvernement français n’a pas lancé les poursuites, ce sont les Associations des victimes qui l’ont fait. Mais est-ce que les victimes doivent pouvoir bloquer toute forme d’expression dès lors qu’il y a un débat historique ? Pour peu qu’on rattache l’histoire de toute la Seconde guerre mondiale, de 1939 à 1945, au phénomène de l’Holocauste, qui pourra encore parler de la guerre, s’il y a un association qui se plaint qu’on ne présente pas les choses sous un jour favorable ? Il y a un problème de liberté du débat historique à laquelle la Cour a été sensible fugitivement. Je crois que c’est là le noyau le plus important de sa position qui a peut-être emporté la position de la majorité, en considérant que tout le monde après tout pouvait parler ou se défendre. Je pense que c’est un enjeu important et les milieux historiques en parlent. C’est un débat qui se pose aussi devant d’autres tribunaux. Il faut tenir compte de cet aspect.
Michèle Dubrocard
Sans monopoliser le micro, je voudrais tout de même dire que lorsqu’on parle de débat historique dans l’affaire Lehideux-Isorni, on parle comme les requérants. Cela a été toute leur argumentation du début à la fin. Leur texte, qui a été considéré par des juges comme apologétique, s’inscrivait dans un débat historique. C’est rentrer dans leur jeu que de dire que ce texte se situait dans un cadre historique. Précisément, le gouvernement français l’a indiqué dans son mémoire, ce texte ne s’inscrivait pas dans un débat historique puisqu’il était de nature apologétique. Il est quand même extraordinaire de voir que la Cour dans son arrêt parle encore de cette thèse du bouclier, du rôle suprêmement habile que Pétain aurait joué pendant la Seconde guerre mondiale. Cette thèse ne tient plus pour tous les historiens actuels qui examinent cette question, et pas seulement les historiens français, les historiens américains, allemands, canadiens. Si on veut entrer dans un débat historique, ce qui à mon avis n’est pas le rôle de la Cour européenne des droits de l’Homme, alors il faut accepter le fait que ce texte ne s’inscrit pas du tout dans un débat historique.
Patrice Rolland
Je me pose la question, et je vous la pose : est-ce que c’est à l’Etat de définir ce qu’est un débat historique ? La plupart des historiens soutiennent que le seul moyen est le débat, et que ceux qui ne sont pas d’accord doivent pouvoir prendre la parole, etc. Si l’Etat, ou le juge européen aussi sage soit-il, se met à définir quel est le débat historique sérieux, le débat qui n’est pas sérieux, le débat publicitaire ou le débat du café du commerce, nous ne sommes plus dans un régime de liberté. C’est une question en débat et le juge français est souvent sollicité de définir le débat historique.
Raymond Goy
Premier élément : c’est cette internationalisation du débat judiciaire. je crois que dans un domaine qui évidemment agite terriblement, on le comprend, les opinions nationales, l’internationalisation de ce Tribunal apporte une certaine objectivité ou objectivisation.
Deuxième élément : c’est le temps qui passe. Et voici qu’aujourd’hui, paradoxalement, alors que la Convention nous habitue à dire que quand les procès sont très longs c’est contraire à la Convention, on s’aperçoit qu’un procès très long au contraire aboutit peut-être lui aussi à un certain apaisement et à une certaine objectivation. Votre appel m’a beaucoup frappé et me semble juste : vous avez tout à l’heure exprimé l’idée que le temps passé en matière d’histoire est de nature à rassurer mais qu’il n’en laisse pas moins le débat ouvert aux historiens et que ceux-ci ont la responsabilité principal de le poursuivre.
Arnaud Bories (DEA droit public, Sceaux)
Il fallait rappeler une chose essentielle à propos de la proportionnalité. Les requérants avaient été condamnés en France effectivement pénalement, mais seulement à 1 F de dommages et intérêts. La Cour européenne intervient ensuite en disant que la condamnation était disproportionnée, ce qui est un peu curieux !
Sur l’intentionnalité, qui était le fil conducteur de votre exposé, vous avez comparé l’affaire Jersild et cette affaire. Dans l’affaire Jersild, le journaliste n’avait effectivement rien dit et son émission n’avait été que le support de propos racistes. Dans l’affaire Lehideux-Isorni, ils étaient parfaitement conscients de leurs propos qui étaient intentionnels. C’est vrai, qu’ensuite, ils se sont aperçus qu’ils étaient allés trop loin et ont dit qu’à aucun moment ils n’avaient voulu minimiser le problème du génocide juif. De toute manière, ils ont fait une apologie impressionnante de Pétain qui faisait l’impasse complète sur cette question. Leurs propos sont donc intentionnels et ce fil conducteur de votre exposé mérite d’être relevé.
Patrice Rolland
L’intentionnalité ne porte pas sur leurs propos. Pour la Cour, il ne s’agit pas d’une affaire quelconque. On ne parle pas du Maréchal Pétain comme on parlerait du général Mangin en 1917 ou de Nivelle, même si c’est difficile. Le poids de l’Holocauste est derrière tout cela. La Cour interdit les propos négationnistes. Lehideux et Isorni ne se sont jamais associés aux propos négationnistes, ni à une apologie ou à une minimisation de l’holocauste, même si politiquement nous avons le droit de dire : vous êtes quand même complices par le biais d’une interprétation politique et morale, mais qui n’a pas de valeur juridique puisque ni Lehideux ni Isorni n’ont fait le travail de Touvier. Il faut tout de même faire une distinction car sinon par contamination progressive, c’est la France entière qui est réduite au silence sur le sujet. L’intention porte bien sur la seule réserve absolue que pose la Cour : êtes-vous négationnistes ou pas ? Ce propos là est interdit. Ils ne le sont pas. Ils ont dit qu’ils ne l’étaient pas. Il faut s’en tenir à ce qu’ils disent. Selon Montesquieu (il raconte qu’un personnage grec a rêvé la nuit qu’il égorgeait le tyran et le tyran l’a fait exécuter), il s’agit d’une grande tyrannie parce que le droit ne connaît que ce qui est extérieur. Je ne connais pas les intentions de Lehideux et Isorni, mais ils ont publiquement dit qu’ils refusaient toute idée négationniste. Je crois qu’il faut s’arrêter là car ensuite nous entrons dans une inquisition qui relève d’un autre ordre et en principe qui ne relève pas d’un Etat laïc et libéral.
Alexis Guedj (ATER à l’Université de Lille II)
Quant à la marge d’appréciation, je suis un peu étonné qu’on puisse comparer la marge d’appréciation des arrêts Wingrove et Otto Preminger et celle laissée à l’Etat français dans l’affaire Lehideux-Isorni, parce qu’il me semble que la ligne de conduite Handyside, Wingrove et Otto Preminger concerne les questions relatives à la morale et à la religion, et plus particulièrement à la sexualité. Dans l’affaire Lehideux, le problème n’est pas celui-ci. Ses auteurs ont passé sous silence la politique de collaboration active menée par le gouvernement de Vichy. Je rappellerai seulement que si l’armistice a été signé le 22 octobre, la loi sur le statut des Juifs date du 3 octobre. Ce qui veut dire que cette politique a mené les gens à Drancy et les a conduit aux camps d’extermination. Quand on dit que l’intention des auteurs, et je déborde sur l’intention maintenant, n’est pas une intention malveillante, je suis un peu insurgé et quand on compare l’arrêt Jersild à cet arrêt, je me permettrai de faire une autre remarque. Dans l’arrêt Jersild, ce sont aussi les libertés journalistiques qui sont en jeu parce que le requérant est un journaliste. Il interviewe les skinheads danois pendant plus de six heures. Il fait un montage d’à peine dix minutes. Il prend simplement les propos les plus outrageants et ceux qui portent le plus atteinte aux droits moraux d’autrui et c’est de ceux-là qu’on parle. On dit aussi que l’intention de Jersild n’est pas celle d’un raciste, peut-être, mais il a abreuvé les skinheads danois avec de la bière pour leur faire dire ce qu’il voulait entendre. C’est important quand on parle de l’intention des auteurs. De la même façon, quand on parle de l’affaire Lehideux et Isorni, on sait de qui il s’agit. On connaît leur passé politique et leur intention. C’est un peu comme si aujourd’hui on voulait nous faire dire, et certains cherchent à nous le faire dire, que parmi Le Pen et Mégret, l’un est plus raciste que l’autre, alors que l’on est au sein d’un mouvement fasciste, raciste et xénophobe.
Patrice Rolland
Vous avez en partie raison : c’est effectivement sur la question des moeurs et de la morale que la jurisprudence s’est faite, mais l’affaire Handyside était aussi politique puisque l’éditeur était gauchiste et qu’il avait un fort appui politique. L’arrêt Sunday Times dit à peu près la même chose. La liberté d’expression est une catégorie que la Cour porte, notamment pour la presse, assez haut. Je ne crois pas que ce soit ni au juge ni à l’Etat à faire le travail des historiens, des philosophes et des moralistes. L’Etat maintient l’ordre public. Pour le reste, il y a à se battre et à débattre. Vous avez raison de dire que les arguments de Lehideux et Isorni sont dérisoires. Tout le monde le sait ; les historiens ont travaillé sur l’argument du bouclier. Je ne sais pas très bien pour qui il fait encore illusion, ce qui fait que le danger me paraît un peu minime. Le problème est plus vaste, c’est la question de savoir qui peut parler légitimement ? Si seules certaines personnes peuvent le faire, je pense que nous retournons à l’Ancien Régime.
Catherine Teitgen-Colly
Il a été dit tout à l’heure qu’exprimer une opinion était différent de mener une action au sens de l’article 17, c’est ce qui ressortirait de l’un des paragraphes de la décision de la Cour. Pourtant l’article 17 vise quiconque se livre à une activité ; n’est-ce pas dès lors un peu rapide de dire qu’exprimer une opinion n’est pas une action ? Est-ce cela que la Cour dit, et est-ce la première fois ? ou bien est-ce une interprétation personnelle de ce que la Cour a dit ?
Patrice Rolland
Je rappelle un argument qui est repris dans la décision de recevabilité et qui n’apparaît pas dans le rapport de la Commission. La Cour le reprend en résumant la décision de recevabilité : " en outre il ne pouvait se déduire des termes du texte qu’exprimer des idées constituait une activité... ". Pourquoi le rappelle-t-elle, alors qu’effectivement elle n’a peut-être pas rappelé tous les arguments et soulevé tous les arguments ? Je ne le sais pas. J’ai été prudent. Je l’ai signalé et fait le rapprochement avec d’autres éléments du texte : le fait qu’elle ne veut pas examiner séparément l’article 17, par exemple, et qu’au fond elle le neutralise derrière l’article 10, me semble-t-il.
Antoine Buchet
Je ne suis pas de l’avis de M. Rolland lorsqu’il dit que c’est un arrêt prudent. Il me semble au contraire qu’il s’agit d’un arrêt où les juges ont fait preuve d’une certaine légèreté. On peut même parler d’une certaine complaisance à certains endroits, et, en tout cas, d’un manque de rigueur juridique.
Le gouvernement avait effectivement insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une publicité commerciale, domaine dans lequel la " marge d’appréciation " des Etats est plus étendue. C’était un argument recevable, pas un " fond de tiroir " ; c’était d’ailleurs un argument que l’on retrouvait dans les opinions dissidentes de certains membres de la Commission, et dans plusieurs arrêts de la Cour. Il y avait, dans cette affaire, un rapport marchand entre les requérants et le journal Le Monde. La Cour a sans doute été impressionnée par la publication dans Le Monde, et c’est toute l’habileté de MM. Lehideux et Isorni que d’avoir choisi ce quotidien pour insérer leur encart publicitaire, qu’ils ont payé. Ce n’était pas un article de fond, ce n’était pas une libre opinion des requérants parue en page " débats " du journal. Je crois qu’à cet argument la Cour n’a pas répondu avec suffisamment de rigueur.
Le deuxième élément qui révèle à mon sens la légèreté de la Cour européenne dans cette affaire, c’est le paragraphe 55, relatif à l’ancienneté des faits. C’est effectivement l’un des éléments déterminants dans la motivation de l’arrêt, ainsi que M. Rolland l’a très justement fait remarquer. Ce qui me semble contestable, et pour le moins léger, quel que soit l’avis que l’on puisse avoir sur cette notion d’écoulement du temps, c’est ce passage, je cite : " le recul du temps entraîne qu’il ne conviendrait pas, 40 ans après les faits, de leur appliquer la même sévérité que 10 ou 20 ans auparavant ". Tout d’un coup la Cour européenne établit une sorte de fourchette, de 10 à 20 ans, qui constitue le délai de décence, le délai de viduité, au-delà duquel on pourrait se permettre certains écarts. Je ne vois là aucune trace de la prudence dont a fait état précédemment ; je vois au contraire une légèreté étonnante, notamment dans un arrêt qui essayait de " tenir ", et qui, brusquement, à bout de souffle, lâche cet argument définitif.
En ce qui concerne enfin la protection de la liberté du débat historique, il me semble nécessaire de rappeler que la Commission, dans une décision Marais c/France, avait déclaré irrecevable la requête introduite par un historien révisionniste. Le hasard fait que cette décision fut rendue le même jour que la décision de recevabilité dans l’affaire Lehideux et Isorni.
M. Rolland a cité Montesquieu. On fait souvent appel à la philosophie des Lumières pour dénoncer les atteintes aux droits de l’Homme. Malheureusement, la citation est un exercice difficile, et réversible. Rappelons-nous simplement ce que disait Montesquieu sur l’esclavage, dans l’Esprit des Lois, pour en défendre les fondements et l’intérêt. Il écrivait notamment, je cite approximativement, que " Dieu n’a pas pu vouloir mettre une âme dans un corps tout noir "...
Patrice Rolland
Je répondrai seulement sur l’argument publicitaire. Qu’est-ce que vous faites de toutes les pétitions qui passent sous forme de communiqués ? Les Arméniens plaident sous forme de communiqués payants. On ne peut pas séparer le contenu de la forme.... C’est tout de même hypocrite. On ne peut pas traiter une publicité commerciale payante de la même façon qu’un encart même payant pour se défendre ou défendre des idées. C’est sûrement désolant de payer pour défendre ses idées, bonnes ou mauvaises. Les Arméniens ne le font que sous cette forme et cela fait partie de la liberté d’expression. On ne peut pas scinder artificiellement la forme et le fond.
Les autres problèmes soulevés sont immenses et je ne peux pas monopoliser la parole.
Paul Mahoney
J’ai bien sûr des remarques à faire sur les commentaires qui ont été émis sur la qualité de l’arrêt Lehideux et Isorni. Mais je dirai seulement qu’il y a une certaine cohérence dans la jurisprudence de la Cour.
On peut déceler dans cette jurisprudence une distinction opérée entre, d’une part, les domaines du débat politique et du débat sur des questions d’intérêt général et, d’autre part, les domaines des mœurs et de la religion, domaines qui ne sont pas considérés comme aussi importants dans la vie démocratique de nos pays. Pour la dernière catégorie, la marge d’appréciation des autorités nationales est beaucoup plus large. Il y a une cohérence. Qu’elle vous plaise ou non, c’est une autre question. Dire que la jurisprudence est incohérente est, à mon avis, une critique injustifiée. Je ne dis pas que je partage toujours le point de vue ou même les conclusions exprimés dans les arrêts. Mais il y a quand même une certaine vision du rôle de la liberté d’expression dans notre société et de la liberté que les gouvernements doivent accorder même aux groupes qui ne sont pas populaires à un moment donné de l’histoire.
Dans cette affaire, dans laquelle je n’ai pas été directement impliqué, j’ai compris le raisonnement de la façon suivante : le but des associations était légitime et licite aux yeux de la loi française et la " publication litigieuse se situ[ait] dans le droit fil de l’objet social des associations à l’origine de celle-ci " (paragraphe 56 de l’arrêt). Il était donc difficile de justifier une condamnation alors que la publication ne reflétait que les objets des associations. Il ne s’agissait pas dans la publication litigieuse d’une apologie du racisme ni du révisionnisme. Bien sûr, les requérants recherchaient la révision du procès Pétain, mais ce n’était pas du révisionnisme. Il ne s’agissait pas non plus d’une tentative de réécrire l’histoire ou de déformer ou de nier ce que l’arrêt appelait des " faits historiques clairement établis ". C’était plutôt une invitation à entrer dans un débat sur la conduite du Maréchal Pétain. Les autorités nationales peuvent, dans l’exercice de leur marge d’appréciation, sanctionner des paroles racistes ou révisionnistes émises lors d’un tel débat, mais elles ne peuvent pas purement et simplement interdire le débat. C’est le raisonnement qui est à la base de cet arrêt.
Dans l’affaire Jersild, il s’agissait d’un reportage sur des faits de société inacceptables, mais des faits, et la bonne foi du journaliste n’a pas été contestée par le gouvernement danois. S’il l’avait contestée, peut-être que la décision aurait été différente.