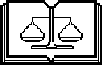Le contrôle juridictionnel de la durée de la détention provisoire (art. 5 § 3) et de la contrainte par corps en matière douanière (art. 5 § 4)
Affaires I.A. (23 septembre 1998) et Soumaré (24 août 1998)
par
Dominique ALLIX
Professeur à l’Université de Paris-Sud
Bien qu’elles soient regroupées sous un même titre, ces deux affaires n’ont que peu de points communs, si ce n’est qu’il s’agit dans l’un et l’autre cas d’une privation de liberté.
La première affaire, I.A. c/France, arrêt du 23 septembre 1998, concerne la durée de la détention provisoire et relève de l’article 5 § 3 qui reconnaît à toute personne ... le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée ...
La seconde affaire, Soumaré c/France, arrêt du 24 août 1998, concerne la contrainte par corps et relève de l’article 5 § 4 qui reconnaît à toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
Affaire I.A. c/France, arrêt du 23 septembre 1998
La Cour a depuis longtemps posé en principe que même si la longueur de l’instruction ne prêtait pas à la critique, celle de la détention provisoire ne devait pas excéder un laps de temps raisonnable (cf. Stögmüller c/Autriche, 10 novembre 1969).
Le 4 décembre 1991, dans le cadre d’une information ouverte contre X du chef d’homicide volontaire après la découverte du cadavre d’une femme identifié comme étant celui de son épouse, M. I.A. a été placé en garde à vue et entendu par les services de police. Inculpé 48 heures plus tard, il est placé sous mandat de dépôt et maintenu en détention provisoire jusqu’au 20 mars 1997, date à laquelle il sera enfin jugé et condamné par la Cour d’assises du Maine-et-Loire à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de 18 ans. Mais cette décision a été annulée par arrêt de la chambre criminelle en date du 1er avril 1998 et M. I.A., toujours incarcéré, attend aujourd’hui encore d’être jugé.
Se plaignant de la durée excessive, et de la détention provisoire, et de la procédure suivie à son encontre, M. I.A. a saisi la Commission qui, à l’unanimité, a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 5 § 3 mais non de l’article 6 § 1. Saisie par le gouvernement français, la Cour a conclu, à son tour, que par sa durée excessive la détention provisoire avait enfreint l’article 5 § 3 et, considérant la durée de la procédure, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6 § 1 .
La Cour examine séparément ces deux griefs comme le veut l’autonomie de l’article 5 § 3.
A • Sur la durée excessive de la détention provisoire et la violation de l’article 5 § 3
Conformément à sa jurisprudence habituelle, la Commission précise la période à prendre en considération avant de se prononcer sur le caractère raisonnable de la durée de cette détention.
a) Sur la période à considérer : la Cour estime que cette période a débuté le jour où M. I.A. a été inculpé d’homicide volontaire et placé sous mandat de dépôt, soit le 6 décembre 1991, pour s’achever le 20 mars 1997, date à laquelle le requérant avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la Cour d’assises du Maine-et-Loire.
Le requérant soutenait pourtant qu’il était toujours détenu dans l’attente d’être jugé puisque l’arrêt qui le condamnait avait été rétroactivement annulé par la Cour de cassation et que l’affaire n’avait pas encore été tranchée par la juridiction de renvoi. Mais la Cour observe qu’entre le 20 mars 1997 et le 1er avril 1998, date à laquelle la chambre criminelle avait annulé l’arrêt rendu par un tribunal compétent, et que la période à considérer sous l’angle de l’article 5 § 3 - période pendant laquelle le requérant était détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire- avait pris fin le 20 mars 1997. Quant à la nouvelle période de détention provisoire, celle dont le point de départ pouvait être fixé au 1er avril 1998 - date à partir de laquelle M. I.A. n’était de nouveau que provisoirement détenu dans l’attente d’être jugé - la Cour constate qu’elle est postérieure au 10 septembre 1997, date du rapport de la Commission, et que faute d’avoir fait l’objet d’un grief examiné, elle ne pouvait être prise en considération.
La détention soumise à l’appréciation de la Cour aura donc duré un peu plus de cinq ans et trois mois.
Restait alors à se prononcer sur le caractère raisonnable de la durée de cette détention.
b) Sur le caractère raisonnable de la durée de la détention : rappelant que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais qu’au bout d’un certain temps cette condition ne suffit plus, la Cour observe qu’il lui appartient d’établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuaient à légitimer une privation de liberté avant jugement.
Ce faisant, la Cour relève que durant la période considérée les juridictions françaises s’étaient prononcées sur la détention du requérant cinquante-sept fois en première instance et cinq fois en appel. Mais elle reproche à ces décisions motivées par référence à l’article 144 C.P.P. d’être peu détaillées quant aux considérations de fait sur lesquelles elles reposent et elle conclut, après examen au fond, que " pour être conforme à la Convention, la considérable longueur de la privation de liberté subie par le requérant aurait du reposer sur des justifications bien plus convaincantes et qu’en l’occurrence la pertinence initiale des motifs retenus par les juridictions d’instruction à l’appui de leurs décisions relatives au maintien de l’intéressé en détention ne résistait pas à l’épreuve du temps ".
L’article 5 § 3 dont elle constate la violation apparaît alors comme une disposition autonome qui produit des effets quelles que soient les circonstances qui ont causé la longueur de l’instruction.
B • Sur la durée de la procédure et la violation alléguée de l’article 6 §1
a) Quant à la période à considérer dont elle fixe le point de départ à la date de l’inculpation, la Cour constate qu’après annulation de l’arrêt rendu par la Cour d’assises, la procédure n’est toujours pas achevée et qu’elle a duré, en l’état, 6 ans et 9 mois, soit près de sept ans. Un tel délai pouvait-il être considéré comme raisonnable ?
b) Rappelant que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et, eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, la Cour considère que la phase de la procédure postérieure à l’arrêt de renvoi ne saurait être sérieusement critiquée.
En revanche, s’interrogeant sur la longueur de l’information - quatre ans et plus de six mois - la Cour relève que le comportement des autorités chargées de l’instruction n’était pas exempt de critiques. Mais considérant que l’affaire présentait une certaine complexité de fait de nature à expliquer certains délais et que le requérant avait lui aussi substantiellement contribué à la lenteur de l’information, elle conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.
Ainsi comme dans l’affaire Stögmüller, la Cour considère qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable de l’article 6 § 1 après avoir conclu à la violation de l’article 5 § 3. Mais l’on retiendra surtout que la longueur de l’information quelle qu’en soit la cause ne saurait suffire à justifier le maintien d’une détention dont les motifs ne résistent pas à l’épreuve du temps. Solution d’autant plus remarquable qu’en l’occurrence la longueur de l’information était imputable au comportement du requérant qui avait, de tactique délibérée, usé de moyens dilatoires afin de prolonger l’instruction.
Affaire Soumaré c/France, arrêt du 24 août 1998
Poursuivi pour avoir participé à un trafic d’héroïne, M. Soumaré a été condamné par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris à dix ans d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’au paiement d’une amende douanière assortie de la contrainte par corps pour en garantir le paiement. Après avoir purgé sa peine d’emprisonnement de droit commun, M. Soumaré a été maintenu en détention du 22 juin 1994 au 16 janvier 1995 au titre de la contrainte par corps en raison du non-paiement de l’amende douanière.
Ayant tenté, mais en vain, d’obtenir la mainlevée de cette contrainte par corps en transigeant avec l’Administration des douanes qui jugeait ses offres insuffisantes, M. Soumaré avait saisi le juge des référés afin d’obtenir cette mainlevée en raison de son insolvabilité. Mais constatant que M. Soumaré ne rapportait pas la preuve de son insolvabilité, le juge des référés avait ordonné le renvoi devant la Cour d’appel de Paris qui, considérant que la contrainte par corps décidée par le juge pénal par application de l’article 388 du Code des douanes ne relevait pas de la procédure de droit commun, avait rejeté comme non fondée en droit la requête de M. Soumaré.
Saisie par M. Soumaré qui se plaignait de l’absence de recours devant un tribunal pour faire statuer sur la légalité de sa détention au titre de la contrainte par corps, la Commission a conclu par cinq voix contre quatre à la violation de l’article 5 § 4. Saisie par le gouvernement, la Cour a conclu à son tour, mais par huit voix contre une, qu’il y avait bien eu violation de l’article 5 § 4.
Le gouvernement soulevait une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il reprochait au requérant de ne pas avoir formé de pourvoi en cassation contre l’arrêt qui avait rejeté sa demande de mainlevée comme non fondée en droit. Mais la Cour observe que l’arrêt contre lequel le requérant aurait dû former un pourvoi en cassation se fondait expressément sur un arrêt de la Cour de cassation pour justifier de son incompétence en matière de contrainte par corps douanière, ce qui renvoyait à la question de savoir si le requérant avait effectivement disposé d’un recours devant un tribunal, c’est-à-dire au fond du grief déduit de la violation de l’article 5 § 4.
L’exception préliminaire a donc été jointe au fond.
Sur le bien-fondé du grief, la Cour relève qu’en ce qui concerne la première période de détention qui a débuté le 22 janvier 1988 et pris fin le 21 juin 1994, le contrôle prévu par l’article 5 § 4 était incorporé à la décision de condamnation prise par la Cour d’appel de Paris et que ce n’est qu’après qu’avait pris effet le droit du requérant d’introduire un recours devant un tribunal pour qu’il soit statué sur la légalité de son maintien en détention au titre de la contrainte par corps.
Contrôle d’autant plus nécessaire qu’il s’agit d’une privation de liberté dont la régularité dépend de la solvabilité du requérant, élément qui pouvait évoluer avec le temps, et que dès l’instant où l’Administration des douanes avait le pouvoir de transiger, il était essentiel que saisis d’un problème de liberté individuelle, les magistrats de l’ordre judiciaire disposent des pouvoirs les plus étendus en la matière.
Or rappelant qu’une voie de recours doit exister avec un degré suffisant de certitude, sans que lui manque l’accessibilité et l’efficacité requise par l’article 5 § 4, la Cour constate que la référence explicite par la Cour d’appel de Paris à un arrêt de la Cour de cassation pour rejeter comme non fondée en droit la requête en mainlevée, constituait un élément déterminant de la croyance du requérant qu’il était inutile de chercher à obtenir satisfaction par la voie du recours en cassation et que si pourvoi du requérant il y avait eu, il aurait été examiné, de par sa nature pénale, par la chambre criminelle, laquelle ne s’était pas encore alignée sur la position de la chambre commerciale à l’époque.
Quant à l’exercice et l’efficacité du recours devant le juge des référés, la Cour note que seule l’appréciation de la régularité apparente de la détention a été examinée par le juge et qu’elle n’avait pu être effectuée au regard de l’article 5 § 4 qu’en cas de reconnaissance par la Cour d’appel de Paris de sa compétence en la matière.
En conclusion, la Cour n’exclut pas que l’exercice successif de recours prévus par la loi pour faire valoir l’insolvabilité d’un détenu au titre de la contrainte par corps puisse conduire désormais à un résultat conforme aux exigences de l’article 5 § 4. Mais elle constate que pareil résultat n’a pas été atteint en l’espèce, la jouissance effective du droit garanti par l’article 5 § 4 n’ayant pas été assurée avec suffisamment de certitude à l’époque des faits.
Il reste que cet arrêt se trouve entaché d’une erreur qui permet de douter de son bien-fondé.
En effet, la Cour croit pouvoir affirmer qu’en l’espèce seule la régularité apparente de la détention aurait été examinée par le juge des référés. Ce qui est faux, puisqu’après voir constaté que la régularité apparente de la détention n’était pas en cause dès lors qu’elle résultait d’une décision de justice, le juge des référés relève que M. Soumaré avait produit un avis de non-imposition et que ce document était à lui seul insuffisant pour rapporter la preuve de l’insolvabilité et justifier la mainlevée de la mesure de contrainte.
En réalité, comme le soulignait le Juge Pettiti dans son opinion dissidente, si M. Soumaré n’a pu obtenir du juge des référés la mainlevée de la contrainte par corps, c’est parce qu’il ne rapportait pas la preuve de son insolvabilité. Or le fait que M. Soumaré n’ait pu ou su rapporter la preuve de son insolvabilité devant le juge des référés ne permettait pas de conclure à l’ineffectivité du recours exercé de ce chef.
Débat
Antoine Buchet
Je reviens sur l’affaire Bernard, les psychiatres et les jurés. Dans votre présentation vous avez exprimé qu’effectivement vous aviez quelques doutes sur l’absence de violation telle qu’elle est relevée par la Cour dans cette affaire. Est-ce que vous pensez que, implicitement, s’il y avait eu une violation, cette violation aurait plaidé pour une césure du procès pénal devant la Cour d’assises, c’est-à-dire pour un examen d’abord de la culpabilité et ensuite de la psychologie, du comportement, etc. avec les experts psychiatres qui viendraient dans une deuxième phase du procès, ce qui permettrait évidemment d’éviter ces critiques, même si nous sommes passés à côté de la violation dans cette affaire ? Est-ce que vous estimez que la présomption d’innocence plaide en ce sens ?
Dominique Allix
Votre question me fait plaisir et me laisserait penser que je suis un bon pédagogue car vous avez compris que dans ma critique, je me demande comment les jurés ont compris que les experts psychiatres ne se prononçaient pas vraiment sur la culpabilité mais sur l’aptitude à la sanction pénale - je faisais écho évidemment à la césure du procès pénal si chère à l’école de la défense sociale nouvelle qui constitue le principe directeur de notre procédure pénale. Il est certain que si on veut sortir de cette ambiguïté, on pourrait envisager cela. Pourquoi pas. Cela dit, c’est tout de même un peu dangereux de vouloir distinguer la déclaration de culpabilité et ensuite le prononcé de la sanction. Il devrait y avoir des sanctions automatiques fixées par l’expert et non plus par le juge... c’est très dangereux. Vous voudriez faire échapper à la souveraineté du jury le prononcé de la sanction !
La philosophie d’Auguste Comte n’a pas encore droit de cité dans le système judiciaire, et pas du tout dans notre système conventionnel. Il y a là effectivement une ambiguïté épouvantable. Il faut lire le rapport d’expertise : il y a des détails absolument extraordinaires (il est un dangereux dandy, il n’hésite pas à ...). C’est vraiment accablant. C’est d’autant plus surprenant que c’est après avoir estimé qu’il n’y avait aucune violation de la présomption d’innocence, alors qu’on a parfois considéré que faire état d’une récidive en disant que c’est un dangereux récidiviste, c’est porter atteinte à la présomption d’innocence. Il y a eu des affaires, qui rejoignaient d’ailleurs le problème de la liberté d’expression, où l’on présentait l’accusé comme un dangereux malfaiteur, un multirécidiviste et on considérait que c’était contraire aux principes qui doivent régir le procès équitable puisque l’accusé était jugé avant même d’avoir comparu devant le juge.
Paul Mahoney
Dans le système pénal du Common Law, certaines exceptions mises à part, on ne doit pas faire mention du casier judiciaire de l’accusé au cours du procès et ce précisément pour ne pas compromettre sa présomption d’innocence. Si l’accusé a un passé criminel, il sera seulement rendu public après la condamnation en vue de fixer la peine.
Me Françoise Mendel-Riche
Le Pr Allix semble dire que la Cour a considéré dans cette affaire que les experts devaient partir de l’hypothèse qu’il aurait été l’auteur des faits. Est-ce exact ? Cela me paraît choquant.
Dominique Allix
Les expertises psychiatriques subies par M. Bernard tendaient à obtenir, entre autres, une réponse à la question de savoir si l’intéressé souffrait d’une quelconque anomalie mentale ou psychique, ou dans l’affirmative, s’il existait un lien entre ces affections et les faits qui lui étaient reprochés. Elles devaient également évaluer la dangerosité de l’individu, les deux spécialistes nommés par le juge d’instruction durent en toute logique partir de l’hypothèse de travail selon laquelle le requérant était l’auteur des crimes à l’origine des poursuites, etc. Les propos sont vraiment accablants... D’ailleurs, même dans son opinion concordante, le juge qui dit : je présume que tout le monde connaissait la procédure et savait que l’expert ne lie pas le juge (le juge qui fait bénéficier d’une sorte de présomption d’innocence le jury reconnaît quand même que les propos des experts n’étaient pas tolérables), a l’air de dire que ce sont surtout leurs propos écrits qui ne le sont pas, et là il aurait peut-être fallu faire quelque chose, mais qu’à partir du moment où l’on avait laissé passer ces rapports écrits, les déclarations à l’audience qui reprenaient les conclusions de ce rapport, n’avaient pas une grande portée puisque les avocats pouvaient tout de suite répliquer et défendre. On lit par ailleurs dans le rapport : la dangerosité extrême de M. Bernard exige certaines mesures particulières.... la sanction pénale doit être directement proportionnelle à la dangerosité extrême. Il n’est pas curable par le traitement pénal, etc. C’est un gangster, les experts le disent. L’expert s’est substitué au juge. ... Il a été pris dans une autre affaire et le juge aurait répondu : maintenant on vous connaît très bien...
Paul Tavernier
Une question sur la motivation. Vous avez dit que la motivation ne faisait pas partie du procès équitable. Le soutenez-vous toujours ?
Dominique Allix
Je me pose une question. On parle sans arrêt de l’obligation de motivation. Dans cette affaire Bernard il y avait une occasion inespérée pour la Cour de dire : comment voulez-vous que je contrôle l’équité du procès ? Il n’y a rien, je vois simplement que des experts ont tenu des propos outranciers puisque la Cour essaie toujours de minimiser les choses... Comment voulez-vous que la Cour connaisse l’impression que le rapport a pu faire sur les jurés ? Est-ce que les jurés se sont sentis liés par les experts, ou non ? Magnifique question à trancher. La Commission ne s’y était pas trompée lorsqu’elle s’est prononcée et a estimé qu’elle était délicate et que les garanties de la procédure sont insuffisantes...
Je suis prêt à dire que le verdict des Cours d’assises est généralement suffisamment motivé lorsque le jury répond à une liste de questions établie à partir de l’arrêt de renvoi. Cela revient pratiquement à une motivation de type QCM. Après tout, pourquoi pas, la procédure offre un certain nombre de garanties qui peuvent s’assimiler finalement à celles d’un procès équitable. En revanche, lorsqu’il y a des incidents lors de la procédure orale d’audience, avec des demandes de donné-acte, c’est vraiment léger...
Paul Tavernier
Je ne suis pas du tout un spécialiste de procédure pénale, mais il se trouve que j’ai dû transmettre récemment le texte de l’arrêt Papon aux responsables d’un nouvel Annuaire de droit international humanitaire dont je suis le correspondant pour la France, et qui est publié par l’Asser Instituut à La Haye. On m’avait demandé un commentaire, mais quand j’ai vu le texte avec plus de 200 questions, un texte complètement incompréhensible pour un juriste moyen comme moi et un arrêt sans aucune motivation..., j’ai renoncé. A votre avis, est-ce que c’est conforme à la Convention européenne des droits de l’Homme et à son article 6 ?
Dominique Allix
Je crois que lorsqu’il y a 200 questions. La seule motivation possible, en tout cas pour les jurés, c’est de répondre par oui ou par non. Vous me dites que c’est incompréhensible, c’est que les questions sont mal posées.
Paul Tavernier
Ce sont des questions purement techniques.
Dominique Allix
Elles doivent être posées en fait et non en droit. En fait, pour que le quidam puisse y répondre par oui ou par non. On ne peut pas parler d’absence totale de motivation. C’est un motivation à la française, QCM, qui n’a rien à voir avec la motivation anglo-saxonne, on peut le regretter, mais ce n’est pas une décision complètement arbitraire. Lorsque la chambre criminelle exerce son contrôle sur la position des questions, elle veille toujours à ce qu’il y ait une sorte de cohérence générale pour qu’il n’y ait pas de réponses contradictoires et que les questions posées puissent s’articuler les unes aux autres. Il n’y a pas absence totale de contrôle, et le jeu de la position des questions assure tout de même une certaine cohérence dans le verdict.
Paul Tavernier
Est-ce qu’on envisage une réforme des Cours d’assises qui pourrait changer sur ce point la pratique actuelle ?
Dominique Allix
J’ai pris la parole il y a deux ans à Bruxelles à un colloque organisé par une Association italienne qui portait sur l’anatomie du procès pénal à travers la Convention européenne. Je devais entretenir l’auditoire de la réforme des Cours d’assises. Deux mois avant le Garde des Sceaux avait été obligé de faire marche arrière... J’avais parié que deux ans plus tard la réforme ne serait toujours pas votée. Je n’ai pas eu tort. Il y a eu l’alternance et je pense qu’elle est arrivée au " bon " moment car c’était une réforme mal ficelée, mal partie : c’est le mariage de la carpe et du lapin, on supprime le jury ou on le maintient. On n’y échappera pas. On dit qu’on va obliger à motiver le verdict dans certains cas : nous avons déjà suffisamment de mal à apprendre la rédaction aux étudiants... les présidents de tribunaux vont se retrouver à essayer de donner quelques rudiments de rédaction aux jurés...C’est difficile d’apprendre à rédiger une décision de justice...
|