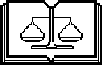CREDHO – PARIS SUD
Centre de recherches et
d’études sur les droits de l’homme et le droit humanitaire
HUITIEME SESSION D’INFORMATION
Faculté Jean Monnet à Sceaux
18 janvier 2002
LA FRANCE ET LA COUR EUROPEENNE
DES DROITS DE L’HOMME
Les arrêts rendus en 2001
Placée sous la présidence de M. Régis De
Gouttes, Premier Avocat général à la Cour de Cassation, la huitième session
d’information du CREDHO relative aux arrêts rendus par la Cour en 2001, s’est
déroulée à la Faculté Jean Monnet, le 18 janvier 2002. Précédant l’ouverture
officielle du colloque, le Professeur Tavernier a tenu à saluer la présence de
M. Régis De Gouttes, rappelant son action de défense des droits de l'homme aux
Nations Unies – en sa qualité de représentant de la France au Comité contre la
discrimination raciale de l’ONU – et au Conseil de l’Europe. Il a également
adressé ses vifs remerciements à Mme Françoise Tulkens, juge belge à la Cour
européenne des droits de l'homme, pour sa participation au colloque.
Dans ses propos introductifs, J.
Francillon, vice-doyen de la Faculté Jean Monnet, a tenu à remercier le
Professeur Paul Tavernier, directeur du CREDHO et organisateur de ce colloque,
« remarquable à plus d’un titre », témoignant de la vitalité et de l’excellence
des centres de recherche et soulignant la nécessité de son renouvellement annuel
au regard du rythme auquel les arrêts de la Cour de Strasbourg se succèdent. Il
a rappelé que cette huitième session d’information s’inscrivait dans la droite
lignée des deux journées organisées il y a deux mois par l’Institut Dumoulin,
relatif à l’interprétation nationale de la Convention de Rome, soulignant ainsi
le prolongement opportun de l’examen du droit communautaire à celui de la
jurisprudence des droits de l'homme. M. Francillon a mis en exergue les deux
notions fondamentales imprégnant la Convention européenne des droits de l'homme,
à savoir l’équité et la liberté, sous-tendant l’idée d’un équilibre entre
l’exercice de la liberté et les ingérences autorisées dans son exercice au
regard duquel la marge nationale d’appréciation ne doit pas disparaître.
Trois ans après
l’entrée en vigueur du Protocole n°11 (1er novembre 1998) et la
fusion de la Commission et de la Cour en un organe unique et permanent désormais
bien ancrée, c’est en procédant à l’examen des ambivalences de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que M. De Gouttes
a ouvert cette manifestation. L’année 2001 a en effet été marquée par une
accentuation des critiques doctrinales formulées à l’égard de certains arrêts de
la haute juridiction, lui reprochant de protéger davantage l’équité en apparence
qu’au fond, et s’élevant contre la remise en cause des spécificités du
pluralisme des droits internes de protection des droits de l'homme. La Cour
n’attribue-t-elle pas des défauts apparents aux systèmes judiciaires nationaux
qui, en réalité, n’existent pas ? (B. Genevois). Le dynamisme interprétatif de
la Cour n’est-il pas davantage la résultante du pouvoir discrétionnaire de la
haute juridiction que l’expression d’une évolution commune des juges nationaux ?
(F. Sudre). Faut-il aller jusqu’à « supprimer la Cour européenne des droits de
l'homme ? » : telles sont en substance les diverses questions posées qui
suscitent à leur tour de multiples interrogations concernant la crédibilité de
la Cour, pourtant considérée comme un modèle dans le monde entier. La Cour se
trouve certes placée face à de nombreux défis, qu’il s’agisse de l’élargissement
des membres du Conseil de l’Europe (regroupant aujourd’hui 43 pays, soit près de
800 millions de requérants potentiels), de l’accroissement exponentiel du nombre
de recours et de la menace d’un engorgement de la juridiction qui en découle –
le retard dans l’examen des requêtes comportant, à terme, des risques de déni de
justice par la Cour elle-même –, de la nouvelle tâche incombant à la juridiction
de contribuer à la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit dans les
pays de l’Est, des origines diverses des juges (opposant les pays de tradition
de common law et les pays de tradition romano-germanique). Un effort
reste indéniablement à mener afin que la Convention bénéficie d’une meilleure
application par les Etats eux-mêmes, conformément au principe de subsidiarité.
Des mesures d’ordre structurel doivent également être apportées afin de parvenir
à une limitation du flux des affaires et de réduire le délai des procédures.
L’intervenant s’attache ensuite à examiner les ambivalences proprement dites de
la jurisprudence de la Cour, opposant les dissonances existant entre le contrôle
poussé de la juridiction sur les mesures étatiques concernant les droits de
l'homme et la garantie des procédures et le contrôle trop pointilleux parfois
exercé par la Cour de la marge nationale d’appréciation dont bénéficie les
Etats, contrevenant en définitive au principe même de subsidiarité. Après avoir
exposé les avancées jurisprudentielles concernant la garantie des droits
fondamentaux en matière de protection du droit à la vie, de l’interdiction de la
torture et autres traitements inhumains et dégradants, de la protection de la
vie privée et familiale ou encore de la liberté d’expression à l’aune des arrêts
rendus en 2001, M. Régis de Gouttes n’en met pas moins en exergue les risques
d’impasse auxquels la Cour se trouve confrontée au regard des controverses
portant sur sa jurisprudence, ayant notamment trait à l’immixtion extrêmement
poussée de la juridiction dans le détail des règles nationales au nom de
critères trop généraux, la Cour risquant davantage de « faire œuvre
d’uniformisation que d’harmonisation ». En conclusion, le Premier Avocat général
à la Cour de cassation ne manque cependant pas de rappeler que la finalité
première de la jurisprudence européenne consiste avant tout à protéger des
droits concrets et non des droits théoriques et abstraits.
Le second rapport,
présenté par Mme Françoise Tulkens, est consacré au thème sensible de la
détention et des droits de l’homme au regard de l’apport de la Convention
et de la jurisprudence relatifs aux conditions de vie au sein des établissements
pénitentiaires. Après avoir souligné le développement progressif du droit
pénitentiaire, considéré par d’aucuns comme une « révolution tranquille »
et par d’autres comme une illusion, l’intervenante examine les conditions
d’application de l’article 3 (interdiction de la torture et de traitements
inhumains et dégradants) aux questions de détention. Il appert que la détention
ordinaire n’entre pas dans le champ d’application de l’article 3. Le juge
rappelle à cet égard que les critères d’applicabilité de l’article 3 se trouvent
appréciés au regard de l’intention, de l’exigence d’un seuil minimum de gravité
et de l’absence de justification. Ces critères amènent à examiner le problème
des traitements objectivement inhumains et dégradants, celui des conditions de
détention dans des quartiers spéciaux (quartiers de haute sécurité) ou dans des
situations particulières (régime de détention des détenus âgés ou malades).
Alors que les situations se complexifient avec un usage accru de la violence
dans la prison, l’analyse de différentes affaires permet de mettre en exergue
l’évolution jurisprudentielle croissante vers une prise en compte plus large des
conditions de détention des personnes, appréciées au regard de leur conformité à
la dignité humaine.
Ces deux premières communications donnent
lieu à un débat au cours duquel M. Régis de Gouttes pose la question de savoir
s’il ne convient pas, afin de remédier à la résurgence du souverainisme, de
trouver un compromis entre le traitement des questions importantes et celui des
détails de procédure. Ce qui importe en définitive est le résultat protecteur de
l’intérêt des justiciables afin que le crédit de certains arrêts de la Cour ne
soit pas affecté. Le juge Tulkens rappelle que les tensions souverainistes,
témoignant d’une certaine résistance au droit européen, existeront toujours.
Elle précise que l’établissement d’un groupe d’évaluation de la Cour au sein du
Conseil de l’Europe s’avère en définitive très sain, toute institution devant
s’inscrire dans un cadre permanent de remise en cause et que cette réflexion est
nécessaire pour améliorer les conditions de travail de la Cour en termes de
politique judiciaire. Elle pose ensuite la question de savoir si la Cour sera en
mesure de maintenir le droit de recours individuel face aux 800 millions de
requérants potentiels. Concernant les obstacles liés à la composition de la
Cour, formée de juges venant d’horizons divers, le juge Tulkens tient à préciser
que cette critique n’est formulée que par la France et que les juges ne
s’identifient pas forcément à leur pays d’origine.
La seconde partie
de la matinée est consacrée à la question de l’équité de la procédure en
matière pénale. C’est l’occasion pour le Professeur Allix de traiter de
l’arrêt G. B. du 2 octobre 2001, afférent aux garanties inhérentes à la
tenue d’un procès équitable. Lors du procès de G. B. pour viols et agressions
sexuelles sur enfants de moins de 15 ans devant la Cour d’assises du Morbihan,
l’un des experts psychiatres avait, dans un premier temps, déclaré que le
prévenu ne présentait pas d’état dangereux avant de se défausser dans un second
temps après avoir eu connaissance de nouvelles pièces déposées par l’avocat
général versant aux débats des documents attestant de son comportement sexuel
pendant sa minorité. Après une suspension d’audience, le même expert déclara
alors que le prévenu présentait un comportement pédophile avec un risque de
récidive très élevé. A l’issue de ce revirement, G. B. réclama une
contre-expertise. La Cour ayant sursis à statuer sur cette demande, G. B. fut
condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour agressions sexuelles. Suite au
rejet de son pourvoi en cassation, G.B. saisit la Commission d’une requête
tendant à constater la violation de son droit à un procès équitable. La Cour – à
laquelle la requête a été transmise suite à l’entrée en vigueur du Protocole
n°11 – estime que l’un des éléments le plus large de la notion de procès
équitable requiert que chaque partie puisse présenter ses positions en étant
placée dans une situation non moins favorable que celle dont bénéficie l’autre
partie. La Cour s’attache ainsi à examiner si un traitement équitable a été
effectué dans le cadre de l’administration des preuves. Si elle estime à cet
égard que le fait qu’un expert exprime devant la Cour d’assises un avis
différent de ses écritures et que le refus d’une contre-expertise ne sont pas en
eux-mêmes contraires aux règles d’un procès équitable, elle précise cependant
que la demande de contre-expertise a fait suite à la volte-face opérée par
l’expert après le dépôt de nouvelles pièces. Un revirement aussi brutal ne
manqua pas de conférer un poids important à l’avis de l’expert. Jointe au refus
de la contre-expertise, cette volte-face a indéniablement porté atteinte aux
règles du procès équitable et au respect des droits de la défense. A la lumière
des dispositions de l’arrêt, le Professeur Allix considère que l’administration
des preuves doit faire l’objet d’une « discussion exempte de tout jugement à
l’emporte-pièce ».
C’est à travers
l’examen de l’arrêt Krombach du 13 février 2001 qu’Olivier Bachelet
examine en second lieu l’équité de la procédure en matière pénale au regard de
la procédure française par contumace. Un ressortissant allemand, en état de
contumax, fut jugé, sur la base de la compétence personnelle passive, par la
Cour d’assises de Paris qui refusa que son avocat le représente en son absence,
conformément à l’article 630 du Code de procédure pénale. Toute possibilité de
faire contrôler par la Cour de cassation la légalité du refus de la Cour
d’assises d’autoriser les avocats de la défense à plaider lui fut également
refusée. La Cour est en l’espèce venue consacrer le droit de recours devant une
juridiction supérieure (double degré de juridiction), considérant que la purge
de contumace ne saurait être considérée comme une voie de recours que le
requérant devait épuiser au sens de l’article 35 de la Convention. La Cour
renvoie à l’inconventionnalité de la procédure de mise en état (arrêt
Khalfaoui) et harmonise dans cette affaire sa jurisprudence relative à
l’affaire Poitrimol. La Cour considère ensuite que le requérant n’a pas
eu la possibilité de se pourvoir en cassation et conclut à la violation de
l’article 2 du Protocole 7. M. Bachelet souligne qu’il ne faut cependant pas
conclure à un droit absolu à la cassation. Si cet arrêt s’inscrit ainsi dans la
droite lignée de la jurisprudence antérieure de la Cour dont l’arrêt Van Pelt
constitue la dernière manifestation, la juridiction étend cependant ici le champ
d’application de sa jurisprudence à la procédure criminelle. L’intervenant
considère cependant que la solution dégagée en l’espèce est discutable en ce que
le fait d’autoriser l’avocat à représenter son client absent remet en cause
l’effectivité du contradictoire, destiné à assurer la manifestation de la vérité
et revient en définitive à vider le principe d’équité de sa substance.
Suit la
présentation de l’affaire Papon (décisions sur la recevabilité des
requêtes des 7 juin et 15 novembre 2001) par Maître Puechavy, Avocat à la Cour
de Paris. Dans la première requête, M. Papon, condamné en avril 1998 à dix ans
de réclusion criminelle pour complicité de crime contre l'humanité, contestait
son maintien en détention qu’il assimilait à un « traitement inhumain et
dégradant » (article 3 de la Convention). La Cour rappelle en premier lieu
l’obligation positive qui incombe aux Etats de s’assurer que les conditions de
détention s’avèrent conformes à la dignité humaine. En second lieu, tout en
estimant que « dans certaines conditions » le maintien en détention d’une
personne âgée peut effectivement « poser problème » au regard de l’article 3, la
haute juridiction, s’appuyant sur des expertises médicales, estime que l’état de
santé du requérant ne remplit pas ses conditions. Insistant sur le fait que sa
décision ne constitue pas une décision de principe, mais qu’elle s’appuie sur
une appréciation des faits de l’espèce, in concreto, la Cour considère
que l’état de santé du requérant n’atteint pas un niveau suffisant de gravité
pour s’inscrire dans le champ d’application de l’article 3 et que sa requête ne
saurait subséquemment être accueillie. La seconde requête déposée par M. Papon
avait trait aux conditions de son procès qu’il considérait comme ayant été
inéquitables. A l’appui de son propos, le requérant invoquait entre autres la
violation du droit à un double degré de juridiction, la violation du droit à une
durée raisonnable de la procédure, la méconnaissance des principes relatifs à la
présomption d’innocence, remettait en cause l’impartialité du tribunal et
excipait de l’insuffisance de la motivation de l’arrêt. Déclarant deux griefs
recevables au regard de l’article 6 § 1 et du droit à un double degré de
juridiction, la Cour est venue rappeler l’importance capitale du droit à l’accès
au juge tout en renvoyant au juge national la question de la durée déraisonnable
de la procédure, l’article L. 180-1 du Code d’organisation judiciaire prévoyant
la possibilité pour le requérant d’obtenir réparation en ce domaine.
La seconde
demi-journée de ce colloque est consacrée à l’équité de la procédure en
matière civile. Maître Delaporte expose, à travers l’examen de l’arrêt
Tricard du 10 juillet 2001, la question de l’accès à la Cour de cassation et
la computation des délais de recours. En l’espèce, M. Tricard avait fait l’objet
d’une procédure pénale en Polynésie française pour corruption et fraude. Mis en
examen en avril 1995, le requérant avait déposé une requête près de la Chambre
d’accusation de la Cour d’appel de Paris afin de pouvoir déposer des pièces
supplémentaires. Cette requête fut rejetée le 29 janvier 1996 par lettre
recommandée envoyée le 30 janvier 1996 au domicile du requérant à Tahiti. Cette
notification n’étant parvenue au requérant que le 6 février, le délai permettant
à M. Tricard de se pourvoir en cassation avait à cette date expiré, le délai
imparti en matière pénale correspondant à un délai franc de 5 jours à compter de
la date d’envoi de la lettre recommandée. Le pourvoi du requérant déposé le 12
février se trouva donc par voie de conséquence rejeté. Saisie de l’affaire, la
Cour considère que la France a méconnu les exigences découlant du délai
raisonnable. La Cour de Strasbourg ajoute que les principes relatifs aux règles
de procédure des délais ne doivent pas empêcher les justiciables d’exercer leurs
droits effectifs. Dans cette optique, Maître Delaporte estime que
l’interprétation en vertu de laquelle le délai court à compter de la date
d’envoi de la notification à l’intéressé ne s’impose pas, l’envoi recommandé
ayant en définitive pour but de contrôler la remise effective de la
notification. Concernant la portée de l’arrêt, Maître Delaporte se pose la
question de savoir si l’on peut aller jusqu’à affirmer que le délai ne saurait
être opposable en matière civile et pénale à une partie qui ne pouvait en être
informée.
Suit l’analyse de l’équité de la procédure
en matière de curatelle à travers l’exposé de l’arrêt Vaudelle du 30
janvier 2001 par Mme Claire d’Urso du Ministère de la Justice. Alors qu’il était
placé sous la curatelle de son fils, M. Vaudelle fit l’objet d’une procédure
pénale pour des actes d’atteinte sexuelle sur deux mineures de 15 ans. La
citation à comparaître à l’audience ne fut adressée qu’au seul requérant qui ne
comparut pas à l’audience, fut jugé contradictoirement, puis condamné à 12 mois
d’emprisonnement dont 8 avec sursis. Il ne fit pas appel du jugement qui devint
donc définitif. Le requérant se plaint devant la Cour de ce que la citation à
comparaître et la notification du jugement n’ont été adressées qu’à lui seul et
non à son curateur, ce qui l’empêcha d’assurer ses droits de la défense, dans la
mesure où il ne disposait pas de la capacité mentale nécessaire comme en
attestait son placement sous curatelle. Attachant une « importance particulière
aux circonstances spécifiques de l’espèce », la haute juridiction estime que
toutes les mesures n’ont pas été prises dans le cas présent pour assurer au
requérant la jouissance de ses droits effectifs et conclut à une violation de
l’article 6. La Cour entend ainsi préciser que la Convention exige, dans
certains cas, que les Etats contractants prennent des « mesures positives » pour
assurer le respect effectif des droits garantis par l’article 6. Pour sa part,
l’intervenante insiste sur le fait que le régime de curatelle requiert, en droit
interne, à la différence du régime de tutelle, une capacité d’agir. Au-delà
d’une appréciation in concreto, la question de savoir si la Cour se
trouve en mesure d’apprécier les conséquences juridiques d’une curatelle demeure
ainsi ouverte.
Le thème de
l’équité de la procédure est ensuite abordé en matière administrative.
C’est l’occasion pour le Professeur Bertrand de revenir sur le rôle controversé
du Commissaire du gouvernement devant le Conseil d’Etat, à travers l’analyse de
l’arrêt Kress du 7 juin 2001. Après avoir posé le principe selon lequel
la procédure suivie devant le Conseil d’Etat respecte le principe du
contradictoire, la Cour considère en revanche que la participation du
Commissaire du gouvernement aux délibérations de la formation de jugement au
Conseil d’Etat s’avère contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. Le
Professeur Bertrand estime qu’il convient de ne pas mettre fin à une institution
qui a jusqu’ici fait la preuve de son efficacité, ce au nom d’un « juridisme
abstrait ». Cet arrêt ne manque pas d’alimenter les discussions et donne lieu à
de vives controverses sur le rôle et la fonction spécifiques du Commissaire du
gouvernement. D’aucuns estiment à cet égard que la solution dégagée en l’espèce
aurait gagné à être plus sévère compte tenu du rôle prépondérant du Commissaire
du gouvernement qui peut considérablement influer sur la décision lors de sa
participation au délibéré, en ce qu’elle lui offre une possibilité
supplémentaire d’appuyer ses conclusions en faveur de l’une ou l’autre partie.
D’autres estiment que les membres de la formation de jugement ne suivent pas
forcément les conclusions du Commissaire du gouvernement qui ne participe en
outre nullement au vote.
Passant à la
présentation du thème de la liberté de circulation, Céline Renaut résume
et commente l’arrêt Baumann du 22 mai 2001, concernant la saisie de biens
d’un ressortissant allemand dans le cadre d’une procédure pénale en France dans
laquelle il n’était pas incriminé. Parmi ses biens figurait son passeport. Après
avoir vainement intenté une série d’actions en restitution, le requérant saisit
la Cour de Strasbourg alléguant la violation par la France de son droit d’accès
à un tribunal (article 6), de son droit au respect de ses biens (article 1
Protocole 1). Il affirme également que la confiscation de son passeport porte
atteinte à sa liberté de circulation (article 2 du Protocole 4). Conformément à
sa jurisprudence constante, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1
par la France et considère que ce constat la dispense de statuer sur la
violation du Protocole 1. L’intervenante met en exergue l’intérêt majeur de
l’arrêt Baumann, résidant dans l’appréciation afférente à la violation de
l’article 2 du Protocole 4, en ce qu’elle vient préciser les contours de la
liberté de circulation. La Cour conclut à la violation de l’article 2 du
Protocole 4 sans consacrer toutefois l’existence au profit de l’individu d’un
« droit au passeport ». La Cour prononce en effet la violation de la liberté de
circulation en se fondant sur le fait que la mesure de confiscation, bien que
« prévue par la loi », ne s’avérait pas nécessaire « dans une société
démocratique », le passeport ne figurant pas sur la liste des pièces mises sous
scellé requises pour les besoins du procès et le requérant n’ayant en outre
nullement été incriminé dans le cadre de cette procédure. La difficulté
rencontrée par les juges en l’espèce – l’opinion dissidente commune de trois
juges sur les sept attestant d’une certaine ambiguïté – a essentiellement porté
non sur le caractère infondé de la confiscation du passeport, mais sur la
question de savoir si la liberté de circulation avait réellement été entravée.
Les juges dissidents font à cet égard remarquer que M. Baumann qui se trouvait
en Allemagne lors de la saisie de son passeport n’a pas été empêché de circuler
librement en France et qu’il n’a d’ailleurs aucunement prétendu avoir été
empêché de quitter n’importe quel pays, qu’il s’agisse de la France ou de
l’Allemagne. Ainsi, dans la mesure où la Cour a sanctionné une mesure
restrictive à la liberté de circulation, certes injustifiée, mais qui n’a causé
aucun préjudice au requérant, la question se pose de savoir s’il convient d’en
déduire qu’il incombe au gouvernement d’apporter la preuve que le requérant n’a
subi aucune entrave dans sa liberté de circulation. C. Renaut précise qu’une
telle option est peu probable au regard des dispositions de la décision de la
Commission en date du 7 avril 1994 (F.C.B. c./Italie, Pays-Bas, Belgique),
jugeant la plainte du requérant irrecevable en ce qu’il n’avait pas démontré
qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’ingérence, ou qu’il avait été empêché de
quitter tel ou tel pays. C’est ainsi que la question du bien-fondé de la
sanction de la mesure gouvernementale demeure à ce jour encore ouverte.
Après avoir remercié Céline Renaut pour la clarté de son
exposé, le Professeur Paul Tavernier laisse la parole à Mme Jarreau du ministère
des Affaires étrangères qui analyse le thème du
respect de la vie privée et
familiale
sous
l’angle du contentieux relatif à l’éloignement des étrangers, à la lumière des
arrêts Ezzouhdi
du 13
février 2001 et
Abdouni
du 27 février 2001 résultant du prononcé d’une mesure d’interdiction définitive
du territoire français, à l’encontre d’étrangers célibataires sans enfants issus
de la deuxième génération, impliqués dans des affaires d’acquisition et de
détention de stupéfiants. La Cour précise ici les critères d’appréciation que le
juge pénal doit retenir concernant l’interdiction définitive du territoire
français pour les étrangers célibataires de la seconde génération, ne possédant
plus aucun lien avec leur pays d’origine. Si la législation relative aux
infractions en matière de stupéfiants prévoit la possibilité de prononcer une
interdiction définitive du territoire français de délinquants étrangers
impliqués dans de telles affaires, celle-ci doit s’avérer « nécessaire dans le
cadre d’une société démocratique » et s’efforcer de concilier la protection de
la vie familiale avec la protection de l’ordre public. Il résulte de l’affaire
Ezzouhdi
que l’élément déterminant du contrôle de proportionnalité réside en
l’appréciation de la gravité de l’infraction. La Cour minimise en l’occurrence
la portée de l’infraction commise, relevant que les simples détentions et usage
de substances psychotropes, en l’absence de commerce de telles substances
illicites, ne constituent pas un danger pour l’avenir au regard du bon maintien
de l’ordre public et de la sécurité publique. Elle conclut ainsi à la violation
de l’article 8 (respect de la vie privée et familiale), le caractère définitif
de l’interdiction du territoire français apparaissant trop rigoureux au regard
des exigences de la protection de la vie familiale, et donc disproportionné par
rapport aux buts légitimes poursuivis. Cet arrêt permet ainsi de mieux cerner la
jurisprudence de la Cour en ce qu’une interdiction définitive de territoire ne
peut être prononcée à l’égard d’un étranger célibataire ayant simplement fait
usage de substances psychotropes. Seule une cession de stupéfiants à titre
onéreux peut justifier le prononcé d’une telle mesure. Suite au prononcé d’une
peine de trente mois de prison pour trafic d’héroïne, M. Abdouni, ressortissant
algérien vivant en France depuis l’âge de six mois, fit l’objet d’une mesure
d’interdiction définitive du territoire français de 5 ans édictée par le préfet
en cours d’instance. Le tribunal administratif annula par la suite cet arrêté,
relevant l’absence de tout lien du prévenu avec l’Algérie. La Cour a adopté une
vision très pragmatique de l’affaire, estimant que l’interdiction était privée
de tout effet juridique puisqu’elle avait été annulée et a, conformément à
l’article 37 de la Convention, prononcé la radiation de l’affaire du rôle, sans
se prononcer sur l’existence d’une violation ou non de l’article 8.
La seconde
intervention de Mme Anne Debet est consacrée à l’examen du cadavre et du
droit au respect de la vie familiale à travers l’analyse de l’arrêt
Panullo et Forte du 30 octobre 2001. En l’espèce, suite au décès de leur
enfant dans un hôpital français le 24 juin 1996, les parents d’Erika,
ressortissants italiens, se plaignaient de la restitution tardive par les
autorités françaises du corps de leur fille, intervenue le 14 février 1997. Ils
faisaient valoir que cette attente avait porté atteinte à leur droit au respect
de leur vie privée et familiale. La Cour a fait droit à leur demande, posant le
principe selon lequel le droit au respect de la vie familiale peut être invoqué
au regard de certains aspects concernant la sépulture. La juridiction consacre
ici une extension du droit à la vie familiale en reconnaissant qu’assurer
rapidement une sépulture à ses proches constitue un droit fondamental de l’homme
qui entre dans le champ d’application de l’article 8.
La fin de cette
journée est consacrée à l’examen des libertés de l’esprit à l’aune de la
liberté de religion et de la liberté d’expression. Le Professeur Patrice
Rolland aborde la question sous l’angle des sectes en France, à travers
l’exemple de la décision du 6 novembre 2001 rendue en l’affaire de la
Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah. La Fédération chrétienne des
témoins de Jéhovah entendait faire valoir devant la Cour que plusieurs décisions
administratives rendues en sa défaveur découlaient de la stigmatisation sociale
du mouvement résultant entre autres de deux rapports parlementaires
respectivement rendus en 1995 et 1999 qui recensaient et qualifiaient un certain
nombre de mouvements de « sectes » et classaient à cet égard les Témoins de
Jéhovah comme « dangereux ». La Cour a prononcé une décision d’irrecevabilité au
terme de plusieurs étapes. Dans un premier temps, la Cour a examiné le statut de
victime potentielle par rapport aux actes incriminés, pour conclure logiquement
que les actes incriminés n’ayant pas de valeur juridique, ils ne sauraient être
considérés comme la ratio legis des décisions rendues à l’encontre de
l’association requérante. La Cour n’en a pas moins poursuivi son examen pour
conclure qu’il existait un lien beaucoup trop indirect entre le second rapport
parlementaire et les décisions rendues à l’encontre des requérants. Elle a ainsi
désolidarisé les rapports parlementaires des décisions litigieuses invoquées par
les requérants, dissociant à cet égard effet d’opinion et effet
juridique. A la question posée de savoir quels critères permettent de
circonscrire la notion de victime, la Cour fait montre d’une hésitation certaine
oscillant entre une acception stricte et une acception large de cette notion.
Dans ses propos conclusifs, l’intervenant rappelle que la Cour a procédé à un
examen exhaustif des questions de recevabilité au regard de l’importance sociale
de cette affaire.
C’est à un
véritable plaidoyer en faveur de la liberté d’expression auquel nous invite
ensuite Maître Massis, Avocat à la Cour de Paris, à travers le commentaire de
l’arrêt Ekin du 17 juillet 2001, afférent au régime des publications
étrangères, et plus précisément à la conjonction de l’article 10 de
la Convention européenne des droits de l'homme (liberté d’expression) avec
l’article 14 de la loi du 29 juillet de 1881 relative à la liberté de la presse,
modifié par décret du 6 mai 1939, et permettant au Ministre de l’Intérieur
français de prononcer une interdiction de diffusion d’écrits étrangers lorsqu’il
juge que ceux-ci représentent une menace pour l’ordre public. En l’espèce,
l’association Ekin avait publié en 1987 un ouvrage intitulé Euskadi en guerre
retraçant les aspects historiques et culturels du combat des Basques. Celui-ci
fit l’objet en 1988 d’un arrêté ministériel, portant interdiction de la
diffusion de l’ouvrage, considéré comme encourageant le séparatisme et le
recours à l’usage de la violence. Saisie de l’affaire, la Cour, par une habile
combinaison des dispositions de l’article 10 avec celles de l’article 14
(interdiction de la discrimination), estime que l’ingérence des autorités
nationales dans l’exercice de la liberté d’expression n’était pas une mesure
nécessaire dans une société démocratique, en ce qu’elle ne répondait nullement à
un « besoin social impérieux ». L’arrêt relève en outre l’existence d’une
discrimination, les écrits d’origine étrangère ne bénéficiant pas du régime
libéral octroyé à la presse française. L’intervenant appelle de ses vœux la
suppression des dispositions litigieuses au regard du caractère discrétionnaire
et arbitraire du pouvoir du Ministre de l’Intérieur en la matière.
Le Professeur Paul Tavernier a conclu ce
colloque, remerciant les différents intervenants de leur présence et
l’assistance nombreuse de son intérêt soutenu. Les actes du colloque seront
prochainement publiés dans les Cahiers du CREDHO et seront également mis
en ligne sur le site internet (www.credho.org). Les arrêts les plus importants
rendus par la Cour en 2001 feront également l’objet d’un commentaire à paraître
dans la « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme », placée sous la direction de MM. les Professeurs Emmanuel Decaux et
Paul Tavernier dans le Journal du Droit International.
Nul doute que cette Journée, riche de
contributions diversifiées et d’avis partagés, aura permis de répondre par
l’affirmative à la question posée – certes non dénuée d’une pointe de
provocation – lors de l’ouverture du colloque. « Faut-il supprimer la Cour
européenne des droits de l'homme » au motif que celle-ci adopterait quelquefois
une conception trop maximaliste de sa fonction par l’exercice d’un contrôle
toujours plus rigoureux, remettant parfois en cause les exigences du principe de
subsidiarité en privilégiant les critères abstraits de l’apparence ? Assurément
non si l’on prend en compte le fait que la Cour constitue le dernier rempart
permettant d’assurer le respect des intérêts des justiciables et que sa
jurisprudence vivante, constamment renouvelée au gré des exigences d’une société
démocratique, contribue en définitive à insuffler aux Etats une acception
toujours plus large de la protection de la personne humaine.
Isabelle MOULIER
ATER à l’Université Paris I