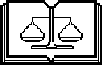CREDHO – PARIS SUD
Centre
de recherches et d’études sur les droits de l’Homme et le droit humanitaire
NEUVIEME SESSION D’INFORMATION
Faculté Jean Monnet à Sceaux
27 février 2003
LA FRANCE ET LA COUR EUROPEENNE
DES DROITS DE L’HOMME
Les arrêts rendus en 2002
Placée sous
la présidence de Mme Renée Koering-Joulin, Conseiller à la Cour de cassation, et
de M. Marc Fischbach, Juge à la Cour européenne des droits de l’Homme, la
neuvième session d’information du CREDHO relative aux arrêts rendus par la Cour
en 2002, s’est déroulée à la Faculté Jean Monnet, le 27 février 2003.
Précédant l’ouverture
officielle du colloque, M. Charbonneau, vice-président de l’Université de
Paris XI (Paris Sud) et M. Faugère, Doyen de la Faculté Jean Monnet, ont tenu à
saluer la tenue périodique de ce colloque regroupant des personnalités
d’horizons variés (professeurs, avocats, magistrats, jeunes chercheurs)
travaillant sur un même thème celui des droits de l’Homme, thème central pour la
Faculté Jean Monnet. Ils ont remercié M. le Professeur Paul Tavernier, directeur
du CREDHO, qui organise cette rencontre annuelle avec le concours des équipes
administratives et scientifiques.
Avant de céder la parole au
premier intervenant, M. le Professeur Tavernier a tenu à saluer la présence de
Mme Renée Koering-Joulin et adresser ses vifs remerciements à M. Marc Fischbach
pour sa participation au colloque. Il a remercié les personnes qui ont contribué
à la préparation de cette journée.
La première intervention est
consacrée à la présentation de la commission de réexamen des décisions
pénales instituée par la loi du 15 juin 2000. Mme Koering-Joulin met en
exergue les difficultés auxquelles la commission de réexamen a été confrontée
depuis sa création. La Commission de réexamen est composée de magistrats dont le
statut assure l’indépendance ; l’intervenante parle aussi d’impartialité
objective. Voie de recours extraordinaire, le réexamen est enfermé dans
d’étroites conditions de forme et de fond. La décision doit avoir été prononcée
par une juridiction pénale, y compris la Cour de cassation. Le réexamen n’est
possible qu’au profit d’une personne reconnue coupable d’une infraction. Le
droit au réexamen ne peut être accordé que sur le fondement d’une violation
constatée par un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme. Un lien de
causalité, relevé par la Cour EDH, entre la condamnation et la violation est
nécessaire ; que la condamnation ait été prononcée en violation de la Convention
EDH, ou que ce lien de causalité résulte de la décision de la Cour. Quant aux
conditions de fond, le législateur n’a pas entendu limiter le réexamen à
l’existence d’une violation de l’article 6 de la Convention EDH ; il peut s’agir
de la violation d’un autre principe. Concernant l’appréciation de la nature et
la gravité de la violation constatée, il n’existe pas de hiérarchie entre les
droits garantis. Cependant, dans les faits, il y a des violations si graves que
seul le réexamen permet d’y remédier. De même, toute violation n’ouvre pas droit
au réexamen. La violation constatée doit, en outre, entraîner des conséquences
dommageables auxquelles la somme allouée au titre de la "satisfaction équitable"
ne peut mettre un terme, le seul remède étant le réexamen. Après avoir statué
sur la recevabilité du réexamen, la Commission de réexamen peut décider de
suspendre l’exécution de la peine. Elle renvoie l’affaire pour un nouveau procès
devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la
décision en violation de la Convention. En cas de constat de double violation,
l’affaire est renvoyée devant la juridiction du fond et non devant la Cour de
cassation. Mme Koering-Joulin souligne que la Cour européenne, saisie de la
conformité de la procédure de réexamen, va développer un contentieux nouveau qui
n’est pas prêt de se tarir.
Suit
l’intervention de M.
Marc Fischbach qui
analyse la nature des relations entre la Convention européenne des
droits de l’Homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(concurrence ou complémentarité). Après avoir présenté l’avancée des travaux de
la Convention de Bruxelles chargée de rédiger le texte de la future Constitution
européenne, l’intervenant dresse un état des lieux et constate qu’à l’heure
actuelle, la protection internationale des droits fondamentaux est assurée
essentiellement par la Convention européenne et par le droit de l’Union
européenne. En l’absence de cohérence et de sécurité juridiques entre les deux
institutions, l’Europe n’aurait plus de crédibilité pour militer au plan
international pour l’universalisme des droits fondamentaux. Ce risque existe.
D’autant que les juges communautaires ne sont pas liés par la Convention
européenne bien que celle-ci s’impose aux Etats membres et qu’ils s’y réfèrent
parfois. Devant la Cour européenne, les Etats membres sont responsables au titre
des droits de l’Homme, des effets du droit communautaire. Le risque de
divergence jurisprudentielle existe et va s’amplifier du fait de la coexistence
au niveau européen de deux instruments distincts. La Charte européenne constitue
le prolongement de la Convention en droit communautaire ; la CJCE devrait jouer
un rôle moteur et développer une jurisprudence qui pourrait influer sur les
législations nationales ; d’autant que la Charte interprétée dans le cadre de
l’UE ne manquera pas d’engendrer une dynamique pour les droits de l’Homme en
Europe (ouverture plus large du droit de recours individuel). Ainsi, l’adhésion
de l’UE à la Convention EDH résoudrait bien des problèmes. Au stade actuel des
discussions, il existe un courant très fort en faveur de cette adhésion. Ni
l’autonomie du droit communautaire, ni le statut de la CJCE ne constituent un
obstacle. La Cour européenne, chargée de veiller au respect par l’UE des droits
de l’Homme, ne serait pas hiérarchiquement supérieure à la CJCE. Les questions
juridiques et techniques qui pourraient peser sur l’éventuelle adhésion de l’UE
à la CEDH ne sont pas insurmontables d’autant que l’adhésion ne va pas modifier
la répartition des compétences au sein de l’UE.
Ces deux
premières communications donnent lieu à un riche débat axé principalement sur la
coexistence, quant à la protection des droits de l’Homme, de deux Cours
européennes. M. Fischbach insiste sur le fait qu’il n’y a aucune sensibilité de
la part de la CJCE sur la question de la hiérarchisation entre les deux Cours.
La participation d’un juge représentant l’UE au sien de la Cour EDH, l’ouverture
et l’épuisement des voies de recours ont suscité une vive discussion entre les
intervenants et l’auditoire. La Charte européenne des droits fondamentaux offre,
à plusieurs égards, une protection plus étendue que la Convention EDH. La
question relative à la protection des droits sociaux et économiques a notamment
été soulevée. M. Fischbach précise que la Cour de Strasbourg, sans toutefois
aller jusqu’à appliquer la Charte, n’hésite pas à se prononcer sur les droits
économiques et sociaux, bien que ceux-ci ne soient pas spécifiquement visés par
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales. Les enjeux des relations entre Cour EDH et CJCE sont
considérables pour la sécurité et la cohérence du système de protection des
droits de l’Homme.
La
seconde partie de la matinée est consacrée au thème de la liberté
d’expression. C’est l’occasion pour Maître Thierry Massis, avocat à la Cour,
d’évoquer l’arrêt Colombani et autres du 25 juin 2002, afférent à
l’offense à chef d’Etat étranger et au sujet sensible de la liberté d’expression
du journaliste. Suite à un article du journal
Le Monde, intitulé “ Le Maroc, premier exportateur mondial de haschich ”,
sous-titré “Un rapport confidentiel met en cause l’entourage du roi Hassan II”,
les requérants, poursuivis sur le fondement de l’article 36 de la loi du 29
juillet 1881 pour offense proférée à l’encontre d’un chef d’Etat étranger,
furent relaxés par le tribunal correctionnel considérant que le journaliste
avait agi de bonne foi en poursuivant un but légitime et citant un rapport dont
le sérieux n’était pas contesté. La Cour d’appel, excluant la bonne foi du
journaliste, estima que la volonté d’attirer l’attention du public sur la
responsabilité de l’entourage royal et la tolérance du roi, était empreinte
d’intention malveillante. Elle reprocha notamment au journaliste de ne pas avoir
vérifié la véracité et l’actualité des faits qu’il rapportait. Réaffirmant la
prééminence du principe de la liberté d’expression dans une société
démocratique, la Cour EDH, s’appuyant sur le jugement du tribunal correctionnel,
constate que la condamnation des requérants s’analyse en une ingérence dans
l’exercice de leur droit à la liberté d’expression. La Cour relève deux points
centraux que sont le devoir et la responsabilité des journalistes. Or, le
rapport pouvait légitimement être considéré comme crédible, sans avoir à
vérifier l’exactitude des faits. La décision de la Cour remet en cause un
certain nombre de notions en droit français. A la différence de la diffamation,
le délit d’offense à un chef d’Etat étranger ne permet pas de rapporter la
preuve des allégations avancées afin de s’exonérer de sa responsabilité pénale.
Ceci constitue une mesure excessive pour protéger la réputation ou les droits
d’une personne. La Cour conclut que le régime dérogatoire est attentatoire à la
liberté d’expression soustrayant à la critique le chef d’état seulement en
raison de sa fonction. D’autre part, le délit d’offense tend à porter atteinte à
la liberté d’expression sans répondre à un “ besoin social impérieux ”
susceptible de justifier cette restriction. Il n’existe donc pas un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les restrictions imposées à la liberté
d’expression et l’objectif légitime poursuivi.
Maître Massis s’interroge sur
le sort de la loi du 29 juillet 1881 dont la Cour sape le fondement. La loi de
1881 étant modifiée de facto par la Cour EDH, ne s’oriente-t-on pas vers
un système de common Law. Cependant, bien qu’il existe une opposition
latente, les juridictions françaises et européennes, empruntant des voies
différentes, parviennent à la même solution. La conciliation des deux systèmes
européen et français ne semble pas impossible. Il existe des soubassements
communs. Une sorte d’harmonie règne entre la Convention EDH et le souffle de la
loi de 1881, consécration positive de l’article 11 de la Déclaration de 1789 ;
la liberté d’expression devant l’emporter sur le droit d’autrui.
La matinée se poursuit par
l’examen de l’équité de la procédure. M. Antoine Buchet, Sous-directeur
des droits de l’Homme à la Direction des affaires juridiques du ministère des
Affaires étrangères commentant l’arrêt Meftah et autres du 26 juillet
2002, traite du monopole des avocats aux Conseils ainsi que du rôle de l’Avocat
général devant la Cour de cassation. Dans la présente affaire, il est question
du droit de se défendre seul et des conséquences qu’il emporte. La Cour EDH
considère que le droit de choisir son défendeur n’est pas absolu, on peut y
apporter des restrictions. La spécificité de la procédure devant la Cour de
cassation, considérée dans sa globalité, peut justifier de réserver aux seuls
avocats spécialisés le monopole de la prise de parole. “ Une telle réserve n’est
pas de nature à remettre en cause la possibilité raisonnable qu’ont les
requérants de présenter leur cause dans des conditions qui ne les placent pas
dans une situation désavantageuse ”. Concernant l’absence de communication aux
requérants du sens des conclusions de l’Avocat général et l’impossibilité d’y
répliquer par écrit, la Cour applique sa jurisprudence antérieure. Faute d’avoir
offert aux requérants un examen équitable de leur cause devant la Cour de
cassation dans le cadre d’un procès contradictoire, en assurant la communication
du sens des conclusions de l’Avocat général et en permettant d’y répondre par
écrit, il y a eu violation de l’article 6 § 1. L’intervenant retrace l’évolution
de la jurisprudence de la Cour en la matière et souligne que l’élaboration des
normes européennes est un long processus. Il constate que l’édifice
jurisprudentiel est en voie d’élaboration. Par conséquent, toute approche
globale reste encore difficile en ce domaine.
L’étude de l’équité de la procédure se poursuit par l’intervention de M.
Frédéric Rolin, Professeur à l’Université d’Evry-Val d’Essonne. Son commentaire
des arrêts Del Sol et Essaadi du 26 février 2002 traite le thème
de l’accès à un tribunal et de l’aide juridictionnelle. En l’espèce, les
demandes d’obtention d’aide juridictionnelle formées par les requérants dans la
perspective de l’introduction de pourvois en cassation furent rejetées en
l’absence de moyens sérieux à l’appui des recours. La Cour EDH considère que le
système mis en place par le législateur français offre des garanties
substantielles de nature à préserver les individus de l’arbitraire. “ Le refus
du bureau d’aide juridictionnelle d’accorder l’aide judiciaire pour saisir la
Cour de cassation, n’a pas atteint dans sa substance même le droit d’accès à un
tribunal du requérant ”. La Cour n’a pas mesuré les enjeux de la question, et
aborde l’accès à la justice de manière abstraite et formelle. M. Rolin regrette
le caractère archaïque de la jurisprudence de la Cour qui méconnaît l’évolution
actuelle en la matière. En effet, l’aide juridictionnelle tend à devenir un
droit fondamental autonome se dissociant de la notion d’accès au juge. Il
s’inscrit dans de cadre de l’accès au droit et en constitue un aspect. L’article
47 de la Charte des droits fondamentaux accorde une protection plus étendue que
l’article 6 de la CEDH, en prévoyant expressément le recours à l’aide
juridictionnelle.
Pour conclure cette matinée, Mme
Claire d’Urso, Magistrat au Service des affaires européennes et internationales
(SAEI) du Ministère de la Justice, examine l’obligation de mise en état et le
droit de l’accusé d’être défendu par un avocat, à travers l’affaire Karatas
et Sari du 16 mai 2002. Invoquant les articles 6 § 1 et 3 c), les
requérants se plaignaient de ne pas avoir eu droit à un procès équitable, faute
d'avoir pu se faire entendre par l'intermédiaire de leurs avocats, ainsi que
d'une violation de leur droit d'accès à un tribunal, en raison de
l'impossibilité d'exercer l'opposition au jugement de condamnation sans se faire
préalablement emprisonner.
Quant au
droit à l’assistance d’un avocat,
la Cour va se distinguer de sa jurisprudence antérieure. Le fait qu’un prévenu
ne comparaisse pas, ne saurait justifier qu’il soit privé du droit à
l’assistance d’un défenseur. Les requérants en fuite, avaient ainsi manifesté
leur volonté de ne pas se rendre à l’audience, et n’entendaient dès lors pas se
défendre eux-mêmes. Suivant le raisonnement
de la Cour, Mme d’Urso considère qu’il est dès lors possible de demander par
écrit, en cas d’absence, que son avocat soit entendu à l’audience. Ainsi, la
position développée par la Cour dans cette affaire, va certainement modifier la
nature des débats devant les juridictions internes. Quant au droit
d’accès à un tribunal, la Cour européenne va se référer à sa jurisprudence
antérieure. L’obligation de se constituer prisonnier afin d’avoir accès à un
tribunal, ne constitue pas une entrave au droit d’accès à un tribunal, mais,
résulte de l’obligation préexistante à laquelle les requérants se sont
soustraits : celle de demeurer à la disposition de la justice afin d’accéder à
un tribunal.
***
Les
deux premières interventions de l’après-midi sont consacrées au thème de la
détention. Dans un premier temps, la détention est abordée par Maître Michel
Puechavy sous l’angle du traitement médical et de la dignité du détenu à travers
l’arrêt Mouisel du 14 novembre 2002.
Le requérant, atteint d’une leucémie, se plaignait de son maintien en détention
et des conditions de celle-ci nonobstant la grave maladie dont il souffrait.
Selon la Cour, l’état de santé, l’âge et un lourd handicap physique constituent
des situations pour lesquelles la capacité à la détention est posée au regard de
l’article 3 de la Convention. Bien qu’il n’y ait pas d’obligation générale de
libérer un détenu en raison de son état de santé, cette disposition impose aux
Etats de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté,
notamment par l’administration des soins médicaux requis. Par ailleurs, la Cour
rappelle que les modalités d’exécution des mesures prises ne doivent pas
soumettre le détenu à une détresse ou une épreuve d’une intensité excédant le
niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. La Cour estime que le
fait d’être menotté lors des transferts à l’hôpital alors que les circonstances
ne l’exigeaient pas, constitue une mesure disproportionnée. Enfin, la Cour
relève que les transferts ne sont pas conformes aux recommandations du Comité
européen pour la prévention de la torture sur les conditions de transfert et
d’examen médical des détenus. Aussi, les autorités nationales n’ont pas assuré
une prise en charge adéquate de l’état de santé du requérant. La jurisprudence
de la Cour relative à l’article 3 évolue et adopte une interprétation plus
souple. Maître Puechavy approuve cette extension et constate que la notion de
dignité humaine tend à se substituer aux notions négatives de l’article 3 de la
Convention européenne.
Suit
l’analyse de la détention à travers l’internement psychiatrique et l’exigence de
l’examen à bref délai de sa régularité. Isabelle Moulier, Doctorante à
l’Université de Paris I, commente les arrêts L.R. et D.M. du 27
juin 2002 et Laidin du 5 novembre 2002. La loi étant commune à tous les
citoyens, à ce titre, les personnes atteintes de troubles mentaux bénéficient de
la plénitude de leur droit notamment celui de la liberté. La Cour rappelle le
droit d’introduire un recours et l’obligation de diligence pour les juridictions
internes de statuer dans un bref délai. Les trois affaires exposées tentent de
cerner la notion de bref délai. La protection de l’article 5 § 1 de la
Convention pose un principe de liberté assorti d’exceptions pour lesquelles la
privation de liberté est autorisée. L’internement psychiatrique bénéficie d’un
encadrement juridique rigoureux, la privation de liberté doit en effet répondre
à des conditions minimales. L’article 5 § 4 offre une série de garanties quelle
que soit l’origine de la détention, dont la garantie d’introduire un recours
juridictionnel. L’effectivité du recours n’acquiert sa véritable dimension que
s’il est rapide. Cependant, l’étendue de l’obligation de statuer dans un bref
délai n’est pas identique et varie en fonction des faits de l’espèce. La Cour a
recours à la notion de sans délai ou bien à celle de bref délai. En l’absence de
critères précis et uniformes, divers éléments sont pris en compte par la Cour :
dysfonctionnements dans l’organisation judiciaire, vulnérabilité de l’individu.
La Cour en tire les conséquences au vue de la situation de vulnérabilité des
personnes internées. La Cour réaffirme la primauté de la liberté individuelle.
Le débat sur la judiciarisation de la procédure d’internement psychiatrique en
France et l’assistance à ce type de malade devrait aboutir à l’adoption d’une
réforme.
C’est à
travers l’examen de
l’affaire Göktan du 2 juillet 2002 qu’Olivier Bachelet,
ATER à l’Université de Paris I, examine les particularités du procès pénal
notamment la contrainte par corps au regard de la Convention européenne des
droits de l’Homme. Le requérant alléguait que l'application de la contrainte par
corps, en exécution du paiement des amendes douanières infligées parallèlement à
des peines d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, aboutissait dans la
pratique à infliger au condamné deux peines de prison successives en punition
des mêmes faits délictueux. Le refus de la Cour d'appel de prononcer la
confusion des deux peines de prison, confirmé par la Cour de cassation, portait
atteinte à l'article 4 du Protocole n°7. La Cour européenne considère que la
contrainte par corps dont est assortie l’amende douanière n’est pas une mesure
d’exécution de celle-ci, mais constitue une peine au sens de l’article 4 du
Protocole n° 7. La Cour se montre réservée à l’égard du système de la contrainte
par corps qui est une “ mesure de privation de liberté archaïque ”. La peine
obligatoire se concilie difficilement avec la séparation des pouvoirs et le
pouvoir d’appréciation des tribunaux, essence même de leur fonction. Quant à la
double peine, la Cour EDH considère qu’il y a, en l’espèce, un concours idéal de
qualifications, à savoir qu’un fait pénal unique se décompose en deux
infractions distinctes : un délit pénal général et un délit douanier.
L’intervenant souligne l’aspect particulier des faits et met en exergue que la
Cour n’applique pas réellement la théorie du concours idéal d’infraction qui
recouvre l’hypothèse où un même fait est susceptible d’être qualifié de
plusieurs infractions, le juge retenant la plus appropriée. En outre, la théorie
du concours idéal de qualifications, telle que dégagée par la jurisprudence
française, exige pour s’appliquer, la protection de deux intérêts distincts :
l’intérêt des finances publiques et l’intérêt de la sûreté publique, en
l’espèce. Or la Cour ne précise pas cette condition pourtant essentielle en
droit pénal français. Dès lors, la position de la Cour semble critiquable au
regard du principe non bis in idem. M. Bachelet examine ensuite l’affaire
sous l’angle de la théorie du concours réel d’infractions plus appropriée en
l’espèce dans la mesure où deux actes distincts ont été commis par le requérant,
chacun n’étant susceptible que d’une seule qualification (et non un fait unique
susceptible de plusieurs qualifications, tel que retenu par la Cour européenne).
Les particularités du procès pénal sont ensuite examinées à travers
l’arrêt Berger du 3 décembre 2002, sous l’angle de la limitation au droit
de la partie civile de se pourvoir en cassation, par Maître Vincent Delaporte,
Avocat aux Conseils.
Il commente la place laissée en droit français à la partie civile dans le cadre
du procès pénal. En l’espèce, la requérante se plaignait de l’équité de la
procédure pénale engagée suite à sa plainte avec constitution de partie civile.
Elle se plaignait, d’une part, d’une atteinte au droit d’accès à un tribunal en
raison de la décision de la Cour de cassation de déclarer son pourvoi
irrecevable à défaut d’un pourvoi de la part du ministère public ; d’autre part,
d’une rupture du principe de l’égalité des armes en raison du défaut de
transmission du rapport du conseiller rapporteur à son conseil. La Cour
européenne rappelle que le “ droit à un tribunal ”, dont le droit d’accès
constitue un aspect, n’est pas absolu. L’Etat jouit en ce domaine d’une certaine
marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre
l’accès ouvert à un justiciable et doivent tendre à un but légitime. De même, un
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
est exigé. La Cour relève que le pourvoi en cassation est une voie de recours
extraordinaire. Ainsi, la partie civile ne dispose pas d’un droit illimité à
l’exercice du pourvoi en cassation contre les arrêts de non-lieu. La partie
civile peut ainsi faire valoir ses droits devant les juridictions civiles. La
Cour considère qu’en l’espèce, le principe de l’égalité des armes ne fut pas
méconnu, eu égard à la place dévolue dans le procès pénal, à l’action civile et
aux intérêts complémentaires de la partie civile et du ministère public.
La seconde partie de la demi-journée du colloque est consacrée à
l’étude du respect de la vie privée et familiale et du domicile.
Rappelant les différentes phases de la procédure d’adoption en France, Mme
Béatrice Bourdelois, Professeur à l’Université du Havre, aborde la délicate
question de l’adoption d’un enfant par un homosexuel à travers la décision du 26
février 2002 dans l’affaire Fretté.
Le requérant, homosexuel
célibataire, s’est vu refusé sa demande d’agrément préalable malgré des rapports
favorables. La Convention EDH ne garantit pas, en tant que tel, un droit
d’adopter. Cependant, dès lors que l’Etat crée un droit, il doit se conformer
aux dispositions de la Convention si celui-ci entre dans le champ d’application
de la Convention. En l’espèce, la Cour juge in abstracto dans la mesure
où aucune famille n’est constituée. Les décisions de rejet de la demande
d’agrément poursuivaient un but légitime : protéger la santé et les droits des
enfants pouvant être concernés par une procédure d’adoption, pour laquelle
l’octroi d’agrément constitue en principe une condition préalable. La Cour
rappelle que “ les Etats contractants jouissent d’une certaine marge
d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre
des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de
traitement juridique ”. La Cour analyse l’état du droit en la matière et ne peut
trancher la question. En effet, aucun consensus au niveau international ou
européen ne se dégage à l’heure actuelle sur cette question. Le droit traverse
une phase de transition, il faut donc laisser une large marge d’appréciation aux
autorités nationales.
Le thème du
respect de la vie privée est ensuite abordé sous l’angle de la protection du
domicile des personnes morales. Mme Laurence Burgorgue-Larsen, Professeur à
l’Université de Rouen, commente l’affaire Sociétés Colas Est et autres du
16 avril 2002. Suite à des perquisitions, les requérantes furent condamnées à
des sanctions pécuniaires, sur la base de documents saisis. La Cour européenne
considère qu’il est temps de reconnaître que les droits garantis sous l’angle de
l’article 8 de la Convention puissent être interprétés comme incluant pour une
société, le droit au respect de son “ domicile ”. La Cour constate que ni la
législation, ni la pratique en la matière n’offraient de garanties adéquates et
suffisantes contre les abus. A l’époque des faits, l’administration compétente
disposait de larges pouvoirs, et opérait sans mandat préalable du juge
judiciaire et hors présence d’un officier de police judiciaire. L’intervenante
met en exergue la montée en puissance de l’article 8. L’arrêt Stés Colas Est
et autres parachève l’évolution de la conception de la vie privée initiée
par l’arrêt Chappel c. Royaume-Uni (la notion de domicile est étendue aux
locaux professionnels), et amplifiée par l’arrêt Niemietz c. Allemagne
(au droit au respect de la vie privée, vient s’ajouter le droit à la vie privée
sociale ou commerciale). Le domicile est entendu de manière compréhensible par
le juge. La Cour opère une reconnaissance des droits substantiels des sociétés.
Analysant la démarche argumentaire de la Cour qui essaie d’identifier la portée
de la vie commerciale, Mme Burgorgue-Larsen constate qu’il n’y a, dans l’arrêt,
ni référence législative, ni jurisprudence constitutionnelle, ni droit
communautaire. La Cour se réfère explicitement à la doctrine du droit vivant. En
outre, la Cour reconnaît aux personnes morales le droit à réparation résultant
d’un préjudice autre que matériel. La démarche de la Cour s’inscrit dans un
mouvement d’ensemble. Soulignant les divergences jurisprudentielles entre les
deux Cours européennes, l’intervenante constate qu’à l’heure actuelle les deux
juridictions ont adopté la même position en la matière ; la CJCE s’est alignée
sur la jurisprudence de Strasbourg dans un arrêt rendu le 22 octobre 2002.
Toutefois, quant à la portée de l’applicabilité de l’article 8 aux sociétés
commerciales, la démarche de la Cour de Strasbourg reste vague. Reprenant la
solution dégagée par le juge constitutionnel espagnol, Mme Burgorgue-Larsen
explique que la Cour met en adéquation l’intensité du niveau de protection
accordée à un droit et l’ingérence tolérée à l’exercice de ce même droit.
Passant à la présentation de la liberté de réunion, Mme
Céline Renaut, Doctorante à l’Université de Paris XI, ATER à l’Université d’Evry-Val
d’Essonne, commente l’arrêt Cissé du 9 avril 2002, concernant l’affaire
des “ sans papiers de Saint-Bernard ”. Ressortissante sénégalaise, la requérante
occupa, en compagnie d’environ deux cents personnes en situation irrégulière,
une église afin d’attirer l’attention sur les difficultés pour obtenir un
réexamen de leur situation administrative. Cette situation pris fin après deux
mois d’occupation, lorsque les forces de l’ordre, exécutant un arrêté
préfectoral, expulsèrent et interpellèrent tous les occupants de l’église au
motif que l’occupation était étrangère à l’exercice du culte, que les conditions
précaires de salubrité s’étaient dégradées et qu’il existait des risques graves
pour la santé, la tranquillité, la sécurité et l’ordre public. La requérante fut
condamnée à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir pénétré et
séjourné en France illégalement. La question qui se posait à la Cour de
Strasbourg était celle de savoir si des étrangers en situation irrégulière ont
ou non le droit de se réunir pacifiquement en vertu de l’article 11 de la
Convention. En l’espèce, la Cour ne consacre pas de façon explicite cette
liberté. Analysant la décision de la Cour, Mme Renaut, constate qu’une telle
consécration découle, d’une part, du rejet de l’argumentation française tendant
à faire du caractère irrégulier du séjour de la requérante un motif légitime
d’ingérence dans la liberté de réunion de la requérante et, d’autre part, de la
reconnaissance d’une ingérence du gouvernement français dans l’exercice par la
requérante de son droit. C’est non sans embarras que la Cour considère que
l’interférence dans la liberté de réunion de la requérante ne fut pas
disproportionnée et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 11. Ainsi, la
liberté de réunion reconnue aux personnes en situation irrégulière est largement
illusoire. En effet, la Cour laisse la porte ouverte à une répression indirecte
de l’exercice du droit à la liberté de réunion des sans papiers et soumet
l’exercice de celle-ci de façon excessive au pouvoir d’appréciation de l’Etat.
L’intervenante souligne que, dans cette affaire, la Cour ne rappelle aucun
devoir positif ou négatif à la charge de l’Etat. Cependant, Mme Renaut nuance la
portée de l’arrêt Cissé en ce qu’il s’agit d’un arrêt d’espèce et non de
principe ; la position de la Cour peut donc évoluer et prendre en compte les
répercussions concrètes de la situation irrégulière des personnes sur l’exercice
de leurs libertés fondamentales.
La
fin de cette journée est consacrée au respect des biens et au droit de
propriété. M. Michel Prat, magistrat à la Cour des Comptes, aborde les
difficultés d’application de la 6ème directive communautaire en
matière de TVA devant le juge de Strasbourg, à travers l’examen de la décision
du 16 avril 2002 rendue en l’affaire SA Dangeville. En l’espèce, la
question soulevée concernait la créance d’une société sur l’Etat.
La requérante, société de
courtiers en assurance dont l’activité est soumise à la TVA, s’acquitta de la
taxe correspondant à ses opérations de 1978. Or, les dispositions de la 6e
directive communautaire, applicables à compter du 1er janvier 1978,
exonéraient de la TVA certaines opérations. Le 30 juin 1978, la 9e
directive du Conseil des communautés européennes fut notifiée à l’Etat français,
lui accordant un délai supplémentaire pour la mise en œuvre des dispositions.
N’ayant pas d’effet rétroactif, la 6e directive devait s’appliquer du
1er janvier au 30 juin 1978. La requérante, invoquant le bénéfice de
la 6° directive, demanda la restitution de la TVA indûment versée. Par ailleurs,
une instruction administrative annula les redressements fiscaux des courtiers
n'ayant pas acquitté la TVA au titre de cette période. La requérante forma un
recours rejeté par le Conseil d'Etat. Alors que statuant sur l'action d’une
société dont l’activité commerciale et les prétentions étaient semblables à
celles de la requérante, le Conseil d’Etat opéra un revirement de jurisprudence
et fit droit à la demande de remboursement par l’Etat des sommes indûment
versées. La Cour européenne constate que “ la requérante bénéficiait d’une
créance sur l’Etat et qu'en tout état de cause elle avait pour le moins une
espérance légitime de pouvoir en obtenir le remboursement ”. Analysant ensuite
l’ingérence dans les biens, la haute Cour relève qu’elle ne répondait pas aux
exigences de l’intérêt général et que l’atteinte apportée aux biens de la
société requérante revêtait un caractère disproportionné. La Cour prend en
compte l’absence de mise en œuvre des procédures internes offrant un remède
suffisant pour assurer la protection du droit au respect des biens ayant rompu
le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de
la protection des droits fondamentaux. M. Prat approuve la décision de la Cour
constatant, en l’espèce, une violation de l’article 1 du Protocole n°1.
La dernière intervention est consacrée à l’examen de
l’expropriation au regard de la Convention européenne des droits de l’Homme.
M. Jean-Pierre Demouveaux, Premier Conseiller à la Cour administrative d’appel
de Paris, présente les arrêts Lallement du 11 avril 2002 et Motais de
Narbonne du 2 juillet 2002. Il s’agissait dans les deux affaires de
déterminer le quantum de l’indemnité suite à une procédure d’expropriation. Dans
l’affaire Lallement, bien que le requérant, exproprié pour cause
d’utilité publique, ait perçu une indemnité, il lui était impossible de
reconstituer son exploitation agricole en raison notamment de la complexité de
la législation en matière de terrains agricoles. Les tribunaux ayant une vision
désincarnée, ont rejeté ses recours. L’indemnisation accordée couvrait le
préjudice matériel sans prendre en compte le préjudice moral subi.
L’expropriation a eu pour effet d’empêcher le requérant attaché sentimentalement
à ses terres de poursuivre de manière rentable son activité. Constatant que
l'indemnité versée ne couvre pas spécifiquement cette perte, la Cour estime
qu'elle n’est pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien exproprié et
conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n°1. Dans son opinion
concordante, le Juge Costa souligne qu’il s’agit d’une situation particulière
qui ne doit pas avoir une portée jurisprudentielle trop extensive. Mme
Koering-Joulin s’interroge sur la possibilité de plaider ce type d’affaire en se
fondant sur la violation combinée de l’article 8 de la Convention et de
l’article 1 du Protocole 1 pour obtenir réparation du préjudice moral.
Dans la seconde affaire, M.
Demouveaux nous invite à nous intéresser aux rapports entre le temps et
l’indemnisation. Un arrêté préfectoral de 1982 déclara d’utilité publique le
projet d’acquisition par le département d’un terrain “ en vue de la constitution
de réserves foncières destinées à l’habitat très social ”. L’indemnité
d’expropriation est fixée par un jugement de 1983. Par la suite, le terrain fut
en partie cédé à une société immobilière. En 1989, le terrain étant resté à
l’état de friche, le TGI fut saisi d’une demande tendant à la rétrocession du
bien, puis en substitution, au paiement de sa valeur actualisée, diminuée de
l’indemnité d’expropriation déjà perçue. Le tribunal estima sa demande fondée ce
qu’infirma la Cour d’appel. La valeur du terrain ayant considérablement
augmenté, la Cour européenne constate que “ les requérants sont fondés à
soutenir qu'ils ont été indûment privés d'une plus value engendrée par le bien
exproprié et ont subi une charge excessive du fait de l'expropriation
litigieuse ”. L’intervenant expose ensuite les différentes possibilités pour
chiffrer l’écoulement du temps, dont l’indexation. Concernant le litige
administratif pour lequel il est difficile de procéder à une analyse abstraite,
M. Demouveaux relève qu’il s’agit d’un défit juridique. Il faut, en effet, que
le juriste renonce à ce confort et se plonge dans les “ méandres ” du droit.
L’examen approfondi des
arrêts rendus contre la France au cours de l’année 2002 par la Cour européenne
des droits de l’Homme a permis de rendre compte de l’évolution de la protection
de la personne humaine et des intérêts des justiciables. La Cour européenne
développe une jurisprudence importante quant aux droits des sociétés
commerciales. Cependant, on peut regretter que la Cour européenne reste frileuse
concernant certains domaines, laissant aux autorités de chaque Etat membre une
large marge d’appréciation. La protection accrue accordée par les organes
européens, s’accompagne de l’instauration au niveau national de nouvelles
procédures comme la Commission de réexamen des décisions pénales en France. La
protection des droits de l’Homme devrait aussi être renforcée avec l’adoption de
la future Constitution européenne. La coexistence de deux cours, bientôt
compétentes au niveau européen pour se prononcer sur d’éventuelles violations
des droits de l’Homme, soulève de nombreuses difficultés auxquelles les
intervenants ont apporté des éléments de réponse tout au long de cette journée.
Les instances de Strasbourg et de Luxembourg, conscientes de l’enjeu de cette
problématique, ont à cœur de préserver la sécurité et la cohérence du système de
protection des droits de l’Homme. A terme, le système européen devrait conférer
un niveau de protection des droits civils, culturels et politiques mais aussi
sociaux et économiques garantissant au mieux les intérêts des justiciables.
Après une journée riche de
contributions et de discussions, le Professeur Paul Tavernier a conclu ce
colloque, remerciant les intervenants de leur présence et l’assistance nombreuse
de son intérêt soutenu. Les actes du colloque seront prochainement publiés dans
les Cahiers du CREDHO et seront également mis en ligne sur le site
internet (www.credho.org). Les arrêts les plus importants rendus par la Cour en
2002 feront également l’objet d’un commentaire à paraître dans la “ Chronique de
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme ”, placée sous la
direction de MM. les Professeurs Emmanuel Decaux et Paul Tavernier dans la revue
Journal du Droit International.
Anne-Laure ZERR
Doctorante à l’Université
Paris XI
|