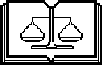Affaire Aït-Mouhoub (28 octobre 1998)
par
Me Hélène CLEMENT
Avocat au Barreau de Paris
Dans cette affaire, le requérant - démuni de ressources financières et n’ayant pas obtenu l’aide juridictionnelle -, se plaignait d’avoir été privé de son droit de recours devant un juge d’instruction, ses deux plaintes avec constitution de partie civile ayant été déclarées irrecevables en raison de son incapacité à verser le montant des consignations fixé à 80 000 F pour chacune d’elles.
Dans son examen du grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour a suivi un raisonnement en deux phases : elle s’est d’abord prononcée sur l’applicabilité de cette disposition à la procédure litigieuse avant d’examiner si le montant élevé des consignations pouvait mettre en jeu le droit d’accès aux tribunaux.
Applicabilité de l’article 6 § 1
Selon les principes dégagés par la jurisprudence européenne, pour que l’article 6 § 1 soit applicable, il doit y avoir une " contestation " sur " un droit de caractère civil " que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Par ailleurs, l’issue de la procédure doit être déterminante pour un tel droit (Voy. notamment l’arrêt Acquaviva c/France, 21 novembre 1995, série A, n° 333-A, p. 14, § 46).
Déjà, dans les affaires Acquaviva et Hamer c/France, le Gouvernement français avait défendu la thèse selon laquelle l’article 6 s’appliquerait aux seules constitutions de partie civile exercées à des fins matérielles, et non pas à celles ayant pour objectif la condamnation de l’auteur de l’infraction (Voy. arrêt Acquaviva précité ; arrêt Hamer c/France, 7 août 1996, Recueil 1996-III).
La question se posait derechef dans le cas de l’espèce où, pour le Gouvernement français, les plaintes du requérant n’auraient visé qu’à contester la légitimité de sa propre condamnation pénale. Il n’aurait jamais sollicité le paiement de dommages-intérêts et aurait pu agir directement devant les juridictions civiles. Poursuivant un but purement vindicatif, sans aucune finalité indemnitaire, les constitutions de partie civile de l’intéressé échapperaient donc, d’après le Gouvernement, au domaine d’application de l’article 6.
Au contraire, de l’avis de la Commission, la nature du fait générateur du préjudice (les vols) et de la plainte dirigée contre des gendarmes, laquelle imposait le recours à l’instruction préparatoire, l’issue de la procédure, qui portait sur un droit de " caractère civil ", était déterminante aux fins de l’article 6 § 1 pour l’établissement du droit à réparation de l’intéressé (Voy. Rapport adopté le 9 septembre 1997)
M. Aït-Mouhoub était condamné le 11 décembre 1992 à douze ans de réclusion criminelle pour complicité de vol avec port d’arme et recel qualifié par la Cour d’assises des mineurs du Gard devant laquelle il avait été renvoyé avec son fils et sa fille, mineurs au moment des faits. Contre cet arrêt, il formait un pourvoi en cassation. Puis, coup sur coup, il déposait deux plaintes avec constitution de partie civile.
La première, dirigée contre deux gendarmes ayant participé à l’enquête judiciaire diligentée contre lui, dénonçait des faits de subornation de témoins, de faux et usage de faux, de forfaiture, de prévarication, de concussion et de complicité de vol.
Dans la seconde plainte, le requérant reprochait à un témoin à charge lors de son procès et à une autre personne, beau-frère d’un gendarme, d’avoir commis les infractions d’incitation à la débauche de mineur, de vente d’armes de guerre et de munitions, de non-dénonciation de malfaiteurs, de faux témoignages, de vol, de chantage et de menaces. Il précisait qu’il avait été ruiné en raison des vols de son mobilier professionnel et personnel commis après son arrestation par l’un d’eux grâce à la complicité de l’un des gendarmes désignés dans sa première plainte.
La solution retenue par la Cour ne consacre certes pas l’opinion exprimée par certains de ses juges, selon laquelle l’action civile, jointe à l’action pénale, reste une action en réparation relevant de la protection garantie par l’article 6, quand bien même la réparation aurait un caractère purement moral, voire consisterait à obtenir la condamnation de l’accusé (Voy. l’opinion dissidente de M. le juge Martens, arrêt Hamer c/France, 7 août 1996, et l’opinion concordante de M. juge De Meyer, en annexe du présent arrêt). Elle aboutit néanmoins, par la démarche adoptée, à une application souple du critère tiré de la finalité indemnitaire de l’action civile.
La Cour a procédé d’abord à l’examen de la seconde plainte. Dans cette plainte, a-t-elle noté, l’intéressé a expressément fait état du préjudice de caractère financier causé par les faits de vols reprochés. La plainte portait donc sur un droit de caractère civil. Et le fait que l’intéressé n’ait pas chiffré son préjudice lors du dépôt de sa plainte est indifférent puisqu’en droit français, il avait la possibilité de présenter une demande en dommages-intérêts jusque et y compris devant les juridictions de jugement (Voy. arrêt Acquaviva précité, pp. 14-15, § 47).
Par ailleurs, poursuit la Cour, cette plainte, fondée sur l’article 85 du Code de procédure pénale, avait pour but de déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir une déclaration de culpabilité, pouvant entraîner l’exercice des droits civils du requérant en rapport avec les infractions alléguées, et notamment l’indemnisation du préjudice financier. L’issue de la procédure était donc déterminante aux fins de l’article 6 § 1 pour l’établissement du droit à réparation de M. Aït-Mouhoub (arrêts Tomasi c/France, 27 août 1992, série A, n° 241-A, p. 43, § 121, et Acquaviva précité, pp. 14-15, § 47). Partant, cette disposition conventionnelle s’applique à la procédure litigieuse.
La Cour a également conclu à l’applicabilité de l’article 6 § 1 pour la première plainte. En dépit de certaines différences, a-t-elle relevé, celle-ci est liée à la seconde, laquelle faisait notamment état de vols commis grâce à la complicité d’un des gendarmes visés dans la première plainte.
Or, rappelons-le, la première plainte était dirigée contre deux gendarmes qui avaient participé à l’enquête judiciaire à l’origine de la condamnation pénale du requérant et visait principalement des infractions en relation avec la procédure pénale menée contre lui.
D’ailleurs, dans son opinion dissidente, la minorité de la Commission avait estimé que les constitutions de partie civile du requérant tendaient à remettre en cause sa condamnation, que les infractions reprochées étaient au moins partiellement des infractions contre des intérêts non pas individuels mais publics, et qu’on imaginait mal une condamnation des défendeurs à payer des dommages-intérêts au requérant avant qu’une procédure en révision ait abouti à son acquittement.
Quant à M. le Juge Pettiti, celui-ci a souligné dans son opinion partiellement dissidente, les différences substantielles entre les deux plaintes, la première plainte ayant pour objet de remettre en cause l’autorité de la chose jugée par la Cour de cassation qui avait rejeté le pourvoi formé par le requérant contre l’arrêt de la Cour d’assises des mineurs du Gard du 11 décembre 1992.
Le droit d’accès à un Juge d’instruction
La Cour ayant admis l’applicabilité de l’article 6 § 1 en l’espèce, restait à savoir si le requérant, comme il le prétendait, avait été privé en fait du droit d’accès à un tribunal étant donné le montant manifestement excessif des consignations mises à sa charge compte tenu de son manque de revenus.
Les circonstances pertinentes du cas pour l’examen de ce point sont les suivantes :
Dans le cadre de chacune de ses plaintes, le requérant avait demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nîmes rejetait la demande concernant la première plainte au motif que, bien que le requérant ait des ressources évaluées à zéro francs, la demande était irrecevable en raison du pourvoi en cassation formé par l’intéressé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’assises des mineurs du 11 décembre 1992, dont l’examen était encore pendant. Le requérant faisait appel de cette décision auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Et il en avertissait le doyen des juges d’instruction.
Alors même que le bureau d’aide juridictionnelle n’avait pas statué sur le recours formé par l’intéressé contre la décision de rejet concernant la première plainte et ne s’était pas prononcé sur la demande concernant la seconde plainte, le doyen des juges d’instruction, constatant que le requérant n’avait pas obtenu l’aide juridictionnelle, fixait le montant de chacune des consignations à 80 000 francs. Pour lui, les pièces du dossier et l’existence d’une autre plainte justifiaient l’application des articles 88-1 et 91 du Code de procédure pénale, légitimant de la sorte la fixation d’une telle somme au titre de la consignation pour la seconde plainte. L’article 88-1 vise à garantir le paiement de l’amende civile d’un montant de 100 000 francs au plus, susceptible d’être prononcée en application de l’article 91 § 1 par le Tribunal correctionnel dans le cas où la constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire.
Sans aucune nouvelle du bureau d’aide juridictionnelle au sujet tant de son recours contre le rejet de sa demande pour la première plainte que pour celle concernant la seconde plainte, le requérant réitérait ses demandes d’aide juridictionnelle. Il ajoutait, à propos de sa première plainte, que la cause d’irrecevabilité retenue dans la décision de rejet avait disparu puisque la Cour de cassation s’était entre-temps prononcée.
A l’issue des délais impartis, le doyen des juges d’instruction déclarait cependant irrecevables les plaintes du requérant, l’aide juridictionnelle n’ayant pas été obtenue et les sommes devant être consignées n’ayant pas été versées. Or, le requérant n’avait toujours pas reçu de réponse à ses demandes de pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle.
La Cour a d’abord rappelé les critères de sa jurisprudence en la matière : le " droit à un tribunal ", dont le droit d’accès constitue un aspect (Voy. arrêt Golder c/Royaume-Uni, 21 février 1975, série A, n° 18, p. 18, § 36), n’est pas absolu ; il se prête à des limitations implicitement admises. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tel que son droit d’accès à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même, et elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Voy., parmi beaucoup d’autres, les arrêts Bellet c/France, 4 déc. 1995, série A, n° 333-B, p. 41, § 33, et Levages Prestations Services c/France, 23 oct. 1996, Recueil 1996-V, p. 1543, § 40). Par ailleurs, la Convention a pour but de protéger des droits concrets et effectifs. Il en est d’autant plus ainsi pour le droit d’accès aux tribunaux compte tenu de la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (Voy. arrêt Airey c/Royaume-Uni, 9 oct. 1979, série A, n° 32, pp. 12-13, § 24).
Ensuite, comme elle l’avait précédemment fait, elle a examiné successivement la seconde et la première plainte.
Au sujet de la seconde plainte, elle a noté qu’elle n’avait pas à en apprécier le bien-fondé. Puis, suivant un raisonnement identique pour chacune des deux plaintes, elle a estimé que la fixation d’une somme aussi élevée, eu égard à l’absence totale de ressources du requérant, que le doyen des juges d’instruction ne pouvait ignorer, avait en pratique privé l’intéressé de son recours devant ce magistrat.
La Cour a aussi été sensible à la circonstance que le requérant n’avait jamais reçu de réponse du bureau d’aide juridictionnelle concernant sa demande pour la seconde plainte, ce dont il avait informé le magistrat, et que la décision définitive de rejet concernant la demande d’aide juridictionnelle pour la première plainte était intervenue postérieurement à l’ordonnance déclarant irrecevable la constitution de partie civile pour défaut de consignation dans le délai imparti.
Le présent arrêt, il convient de le noter, fait référence mutatis mutandis à la décision rendue le 30 juillet 1998 par la Cour en l’affaire Aerts c/Belgique (Voy. Recueil 1998), laquelle a constaté une atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal. En l’espèce, l’intéressé s’était vu refuser l’assistance judiciaire pour exercer un pourvoi en cassation au motif que la prétention ne paraissait pas actuellement juste. La Cour a relevé qu’il appartenait à la Cour de cassation, et non pas au bureau d’aide judiciaire, d’apprécier les chances de succès du pourvoi envisagé.
Dans son avis sur le bien-fondé de la violation alléguée, la Commission avait elle-même considéré que la garantie du paiement d’une éventuelle amende civile ne peut justifier la fixation d’une somme disproportionnée et susceptible d’apparaître comme un " préjugement ", lequel ne semble pas devoir correspondre avec les dispositions des articles 88 et 91§ 1 du Code de procédure pénale. En effet, l’article 88 du Code de procédure pénale prévoit que pour la partie civile qui n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle, laquelle ne couvre pas l’amende civile mais dispense de consignation, le juge d’instruction fixe, en fonctions de ses ressources, la somme à consigner.
Pour conclure, l’on remarquera que la Cour n’avait jamais eu à trancher un cas semblable.
Et la Commission n’avait eu à se prononcer que sur la recevabilité de requêtes où les requérants se plaignaient, sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, d’avoir été condamnés par la juridiction suprême au paiement d’une amende pour recours abusif d’un montant élevé.
Dans ces affaires, cet organe avait considéré que l’imposition d’une amende, qui a pour but de décourager les plaideurs téméraires, d’éviter ainsi l’engorgement des rôles et d’assurer de ce fait une bonne administration de la justice, n’est pas contraire en tant que telle au droit d’accès à un tribunal tel qu’il est garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Toutefois, le montant élevé d’une amende pour recours abusif peut mettre en jeu le droit d’accès aux tribunaux. Tel n’avait pas été le cas en l’occurrence car rien ne permettait de penser que l’éventualité d’une condamnation au paiement de l’amende litigieuse avait empêché les requérants d’introduire leur pourvoi. (Voy. req. n° 12275/86, les Travaux du Midi c/France, déc. du 2 juillet 1991, DR 70, p. 47 ; req. n° 15384/89 G.L. c/Italie, déc. du 9 mai 1994, DR 77, p. 5).