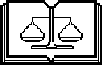La procédure devant la Cour de cassation
Le rôle de l’avocat général devant la Cour de cassation : affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd
(31 mars 1998)
par
François-Guilhem BERTRAND
Professeur à l’Université de Paris-Sud
S’il est vrai que la procédure est la sœur jumelle de la liberté, force est de constater que l’apport de la Cour européenne des droits de l’Homme à l’édification d’une base commune de droit processuel mérite autant de retenir l’attention que ses décisions concernant les droits substantiels.
Les condamnations fondées sur le dépassement du délai raisonnable ne méritent plus guère de commentaires, sinon pour souhaiter que les Etats concernés et la France, on le sait, en fait hélas partie, prennent enfin en compte une donnée essentielle du droit processuel. L’arrêt Reinhart et Slimane-Kaïd en fournit une nouvelle illustration avec une durée de procédure de huit années pour une affaire de faux en écritures de commerce bien ordinaire.
De même, il est devenu banal de constater que les instances de Strasbourg ont mis cinq années pour constater que la phase nationale de la procédure avait excédé le délai raisonnable. Dans la mesure où la Cour de Luxembourg n’a pas hésité à sanctionner son propre Tribunal de première instance sur le fondement de l’article 6-1 (affaire C-185/95 P Baustahlgewebe GmbH c/Commission, arrêt du 17 décembre 1998 inédit), il est permis d’espérer que la Cour de Strasbourg, tout en continuant à traquer la lenteur fautive des juridictions nationales, batte enfin sa coulpe.
Cela étant, l’intérêt majeur de l’arrêt n’est pas là mais bien plutôt dans l’appréciation que porte la Cour de Strasbourg sur l’institution de l’avocat général devant la Cour de cassation française. C’est cet aspect de l’arrêt qui retiendra notre attention exclusive. Après avoir constaté que la décision se présente comme l’aboutissement d’une ligne jurisprudentielle déjà marquée par plusieurs jalons antérieurs (I) nous serons mieux à même de souligner que l’approche de la Cour de Strasbourg ainsi que la conclusion à laquelle elle parvient demeurent contestables (II).
I • L’aboutissement d’une ligne jurisprudentielle déjà fortement jalonnée
L’institution d’un parquet constitué de magistrats, sinon de juges, appelé à donner publiquement, en toute indépendance, son avis sur les solutions possibles du litige, est originale mais non exclusivement propre à l’organisation judiciaire française. Il ne sera ici question que de ce parquet indépendant et non du ministère public partie à l’instance dont le représentant peut néanmoins développer oralement une argumentation distincte de celle qui résulte de ses écritures conformément à l’adage : "la parole est libre si la plume est serve". Adage qui, on le sait, a reçu une consécration statutaire dans l’article 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Ne sera pas davantage évoquée l’institution du commissaire du gouvernement devant les juridictions administratives dont le rôle est proche mais non identique de celui de l’avocat général près la Cour de cassation (cf. sur ce point l’arrêt CE 29 juillet 1998 Mme Esclatine, AJDA 1998, p. 69 Note F. Rolin).
Pour ne s’en tenir qu’aux juridictions suprêmes dont les règles de fonctionnement sont les plus proches de la Cour de cassation française, la Belgique et les Pays-Bas avaient déjà donné à la Cour de Strasbourg l’occasion de fixer sa doctrine (A) avant qu’elle ne l’applique au Quai de l’horloge (B).
A • Les précédentes condamnations de l’institution
La première décision de la Cour en la matière, tout en admettant la pleine indépendance des membres du parquet de la Cour de cassation belge, condamne leur présence au délibéré et le fait qu’ils aient la parole en dernier sans que leurs conclusions soient communiquées aux parties avant l’audience. Les exigences des droits de la défense et de l’égalité des armes se trouveraient ainsi violées (arrêt Borgers c/Belgique du 30 octobre 1991, Série A n° 11 pp. 15 à 18). Bien que cette présence n’entraîne pas de "crainte objectivement justifiée", le "rôle des apparences dans l’appréciation de leur respect"(sic !) conduit la Cour à censurer leur présence, dès lors ajoute-t-elle qu’ "en recommandant l’admission ou le rejet du pourvoi, l’avocat général en devient l’allié ou l’adversaire objectif". Si l’on a bien compris cette décision, seul le juge qui refuserait de statuer conserverait jusqu’au bout sa totale objectivité...
Tout en maintenant fermement sa condamnation de l’institution elle même la Cour devait au fil des arrêts postérieurs quelque peu atténuer la brutalité première de ses formules. Ainsi, tout en reconnaissant son objectivité, des arrêts de 1996 et 1997 soulignent que l’avis en droit de l’avocat général est destiné à conseiller et partant à influencer la Cour. Or l’absence de possibilité de réponse à ces conclusions fausse le débat et viole le principe d’égalité des armes (arrêt Vermeulen c/Belgique du 20 février 1996 et Lobo Machado c/Portugal, même date, Recueil 1996-I p. 233 ; arrêt Van Orshoven c/Belgique du 25 juin 1997, Recueil 1997-II p. 1051).
C’est cette impossibilité de réponse des parties aux conclusions de l’avocat général qui va également fonder les deux décisions du 27 mars 1998 [arrêts JJ c/Pays-Bas (affaire 9/1997/793/994) et KDB c/Pays-Bas (affaire 80/1997/864/1075)]. Tout en soulignant que le droit à une audience publique et le droit d’en être informé n’est pas absolu dès lors qu’une telle audience publique a eu lieu avant l’instance de cassation, la Cour estime dans un considérant repris à l’identique dans les deux décisions que le droit à une procédure contradictoire implique en principe le droit pour les parties de se voir communiquer toute pièce ou observation soumise au juge fût-ce par un magistrat indépendant en vue d’influencer sa décision.
On constate ainsi au fil des décisions que c’est le caractère contradictoire ainsi que l’autorité particulière du ministère public qui constitue aux yeux de la Cour la violation de l’article 6-1. En outre, la formulation des deux décisions du 27 mars 1998 introduit dans le débat un élément supplémentaire qui en élargit les données. On observe en effet que ne sont plus seulement visées les conclusions de l’avocat général, mais, plus largement la communication de toute pièce ou observation soumise au juge.
Ainsi l’élargissement que va concrétiser l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd apparaît déjà en germe dans ces deux arrêts.
B • La confirmation du rejet d’un système procédural
C’est essentiellement sur le non respect du caractère contradictoire de la procédure que la Cour va fonder sa condamnation de la procédure suivie devant la Cour de cassation française.
Donnant toute son ampleur à la thèse qui n’apparaissait que par bribes dans ses précédentes décisions la Cour critique le comportement du conseiller rapporteur au même titre que celui de l’avocat général. Au conseiller rapporteur il est fait grief de ne pas avoir communiqué aux parties ou à leurs conseils le second volet du rapport.
L’arrêt distingue en effet dans le rapport un premier volet constitué par le rappel des faits et de la procédure dont il est donné lecture à l’audience et un second volet constitué par une analyse juridique de l’affaire et un avis sur le mérite du pourvoi. On observera ici que la Cour ne va pas jusqu'à exiger que le ou les projets d’arrêts qui constituent la conclusion et la concrétisation du travail d’analyse du rapporteur soient soumis aux avocats des parties. La Cour admet que le projet d’arrêt est légitimement couvert par le secret du délibéré omettant au passage de relever, ce qui est loin d’être indifférent, que dans les affaires délicates le rapporteur présente souvent à ses collègues plusieurs projets d’arrêts avec éventuellement des variantes et que la discussion qui s’ouvre en cours de délibéré n’est pas un simulacre sous influence du rapporteur et de l’avocat général.
Mais poursuit la Cour, et c’est là le second grief qu’elle formule à l’égard de la procédure suivie, c’est bien l’intégralité du rapport ainsi que le projet d’arrêt qui furent communiqués à l’avocat général. La Cour souligne alors que, étant donné l’importance du rapport du conseiller rapporteur et principalement du second volet de celui-ci, ainsi que du rôle de l’avocat général, il s’est créé un déséquilibre faute d’une communication identique du rapport aux conseils des requérants.
On le voit, dans le dernier état de sa jurisprudence, la Cour a gommé l’argument tiré de l’égalité des armes mais avance une exigence supplémentaire de communication du rapport aux conseil des parties.
La suite du raisonnement est plus classique : la Cour rappelle le rôle de l’avocat général et déplore qu’il ait seul communication du rapport et qu’il ne soit pas tenu de donner connaissance de l’intégralité de ses conclusions aux requérants. Atténuant cependant la rigueur de sa condamnation la Cour relève que la pratique qui consiste pour l’avocat général à informer avant l’audience les conseils des parties du sens des conclusions et à permettre à ceux-ci de répliquer ou de fournir une note en délibéré est de nature à effacer en ce qui concerne l’avocat général la violation portée aux exigences du procès équitable. La Cour ajoute qu’il n’est pas avéré qu’une telle pratique existât à l’époque des faits de la cause.
En conclusion on peut donc souligner que la critique de la Cour s’est étendue en amont au rôle du rapporteur et au caractère partiel de la communication de son rapport, mais qu’en revanche si l’intervention de l’avocat général reste entachée de ce vice initial, son rôle propre est, compte tenu de l’évolution de la pratique, moins sévèrement apprécié que dans les arrêts antérieurs.
II • Une appréciation contestable
Sans méconnaître l’approfondissement de l’analyse de la Cour qui témoigne d’une approche plus exacte de la procédure suivie (A) il apparaît que le contresens persiste sur le caractère inéquitable de celle-ci au regard de l’article 6 (B).
A • Une exacte approche de la procédure suivie
On ne peut manquer de constater avec quelle minutie la Cour examine au delà des textes applicables la pratique réellement suivie par la Cour de cassation. Il faut bien reconnaître que les apparences ne sont pas en faveur du rôle tant vanté de l’avocat général diseur de droit en toute indépendance. Certes son statut, comme celui de tout membre du parquet, garantit sa liberté de parole ainsi que nous le rappelions au début de notre exposé, mais pour le reste les textes sont à l’opposé de cette indépendance.
Les avocats généraux sont placés sous la direction du procureur général à qui les fonctions de ministère public sont personnellement confiées (article R 132-1 C.O.J.) ; ces avocats généraux portent la parole au nom du procureur général (article L 132-3 C.O.J.). Le procureur général peut se faire communiquer les conclusions : s’il ne les approuve pas et que "l’avocat général persiste, le procureur général délègue un autre avocat général ou porte lui-même la parole à l’audience" (article R 132-3). Où est l’indépendance quand il suffit que le procureur le juge "convenable" pour qu’il porte la parole lui-même sans attendre le refus persistant de ses délégués (article L 132-1) ?
Il est cependant remarquable que la Cour ne s’en soit pas tenue à l’énoncé de ces textes qui forment un ensemble redoutable, bien peu conforme à l’idée que l’on se fait de l’indépendance du parquet.
C’est qu’en réalité la pratique est contraire au texte. Dans son discours cité par l’arrêt, le procureur général Burgelin (Gazette du Palais, 23-24 mai 1997) a bien souligné après d’autres observateurs que l’application des textes que nous venons de rappeler fait défaut, ce qui ne veut pas dire que leur existence soit totalement innocente, ni même qu'il n’ait pas eu d’application connue...
Avec bienveillance la Cour fait prévaloir la pratique qui lui est rapportée sur des textes qu’il faudra bien rapporter !
Manifestant à nouveau une attention soutenue à la pratique suivie, la Cour ne manque pas de relever que le sens des conclusions de l’avocat général est désormais porté à la connaissance des avocats qui sont ainsi à même de présenter des observations orales et même de lui porter la réplique s’ils le souhaitent (Crim. 18 déc. 1996, Bulletin 475) . Ce que la Cour ne précise pas c’est que cette pratique était traditionnelle. Elle avait été ensuite abandonnée. En constatant qu’elle a été reprise, on ne peut que se féliciter avec la Cour de ce retour à la tradition.
B • Un désaccord persistant
Bien que la motivation de l’arrêt rapporté manifeste comme on l’a vu une meilleure compréhension de la réalité procédurale, le désaccord persiste sur la portée exacte de la phase ultime de la procédure suivie devant la Cour de cassation française.
Certes la Cour est loin de considérer que le ministère public est un "résidu que l’histoire n’arrive pas à évacuer" (R. Martin, Faut-il supprimer le ministère public ? R.T.D. Civ. 1998, p. 874). Pour autant, il n’apparaît pas que la Cour ait bien compris que dans un recours en cassation, qui est une voie de nullité contre une décision de justice rendue après débats contradictoires, l’admission ou le rejet du pourvoi présentent un caractère objectif. Faire de l’avocat général l’allié d’une des parties au motif qu’il va conclure dans un sens ou un autre paraît témoigner d’une méconnaissance profonde de l’institution même du recours en cassation. Lors de l’audience, le débat peut avoir lieu. Lors du délibéré, la discussion est ouverte et l’avocat général n’y participe pas contrairement au commissaire du gouvernement devant les juridictions administratives.
Par ailleurs la Cour méconnaît totalement le caractère "ouvert" des débats au sein de la Cour de cassation dans la phase ultime de la procédure. Le ou les projets d’arrêt du rapporteur, les conclusions, sont des éléments qui vont intervenir dans le prononcé de la décision, ils en constituent des étapes mais loin d’apparaître comme un processus inéquitable ils sont le reflet d’un processus décisionnel qui a sa cohérence.
On a la nette impression que la Cour censure une institution qu’en vérité elle ne comprend pas. Des juristes continentaux sont parfois choqués par la possibilité pour un juge d’émettre une opinion dissidente considérée comme une atteinte à l’autorité de la décision rendue et au principe du dessaisissement du juge. Ce système est celui de la Cour et il fonctionne comme tel sans que l’impartialité des dissidents ni même celle du juge ad hoc ne soient mises en cause.
En d’autres termes, et bien qu’elle l’ait soigneusement évité, la Cour aurait pu faire un parallèle entre l’avocat général de la Cour de cassation française et l’institution voisine de la Cour de Luxembourg ou de celle du Tribunal de première instance qui s’en distingue par l’appartenance de l’avocat général au même corps que celui des juges. Ces rapprochements auraient permis de constater qu’il existe plusieurs voies pour parvenir à une procédure équitable et que l’institution de l’avocat général ne signe pas ipso facto une procédure inéquitable.
Par ailleurs on perçoit mal quel progrès dans l’équité permettrait d’obtenir la communication aux parties des projets de décision qui n’auront de cohérence qu’après leur adoption par la juridiction. L’avocat général donne son opinion avant une discussion à laquelle il ne participe pas et dont les éléments peuvent être modifiés en dehors de ses prévisions ou de celles du rapporteur. Cette liberté dans le délibéré est essentielle et l’avocat général n’y porte pas atteinte.
En conclusion il faut pourtant reconnaître à l’arrêt rapporté un mérite : c’est d’avoir mis en lumière l’étonnante distorsion entre les textes du Code de l’Organisation Judiciaire qui décrivent un parquet dépendant et subordonné et la réalité attestée par le procureur général de la Cour de cassation lui-même. L’apport de la Cour est bien de pointer, même dans les systèmes les plus élaborés, les failles ou les contradictions que l’on avait négligées jusque là.
Débat
Paul Mahoney
J’ai certains commentaires à formuler. Comme tout bon représentant commercial, je me sens dans l’obligation de défendre les mérites de mes produits... L’idée rapportée par le professeur Bertrand selon laquelle la possibilité pour un juge d’émettre une opinion séparée constitue une violation de l’article 6 me semble originale. En fait cette position n’est pas vraiment celle du droit anglo-saxon car chaque juge rend son arrêt. Il n’y a pas d’arrêt commun de la Cour. Dans l’affaire Pinochet, par exemple, il y avait cinq juges à la House of Lords et c’était un peu comme un penalty shoot-out, chaque juge lisant son arrêt. Les deux premiers étaient en faveur de la reconnaissance de l’immunité du président Pinochet, le troisième était contre, le quatrième était contre et on attendait l’avis du cinquième juge pour connaître le résultat. La possibilité pour un juge d’annexer à l’arrêt une opinion séparée, est une disposition du droit international. La Cour de Strasbourg a simplement copié la pratique de la Cour internationale de La Haye et cette pratique est maintenant entérinée avec le Protocole n° 11 qui a été adopté par tous les Etats, y compris la France. Cette possibilité ne peut en aucun cas être considérée comme une ingérence dans le déroulement du procès. Elle intervient après le prononcé de l’arrêt. Cela constitue peut-être une ingérence dans le secret du délibéré, mais là non plus ce n’est pas un principe qui soit reconnu partout en Europe. Le Tribunal fédéral suisse délibère en public. Le public peut assister et entendre les délibérations des juges. Le secret des délibérés n’est donc pas un principe fondamental de la justice en Europe. Ce n’est pas une question d’uniformité. En permettant au juge d’exprimer un avis séparé, on satisfait à un souci de transparence : on explique la décision aux intéressés et ce qui s’est passé. Dans l’arrêt Slimane-Kaïd, c’est le contraire, c’était plutôt l’absence de transparence qui était en cause.
La Cour de Strasbourg obéit à un principe de base très simple : si des observations sont présentées au tribunal par une entité qui lui est extérieure, que ce soit par l’une des parties ou par un organe complètement indépendant, toutes les parties ont le droit d’en avoir connaissance et d’y répondre. Dans certaines affaires britanniques concernant le tribunal des enfants, des experts indépendants avaient présenté au tribunal des rapports médicaux et sociaux mais les parents concernés n’en n’avaient pas eu connaissance. Partant, la Cour a constaté une violation. Il s’agit de l’équité de la procédure, et je suis d’accord avec le professeur Bertrand : cela n’a rien à voir avec l’égalité des armes. La motivation récente est préférable à la motivation que l’on trouve dans l’arrêt Borgers. L’arrêt Slimane-Kaïd est dans le droit fil de ce principe de l’équité de la procédure. Si l’avocat général, qui a pour tâche de conseiller la Cour de cassation, et qui n’est pas membre de la Cour, dispose d’informations qui ne sont pas à la disposition des parties, cela le met dans une situation privilégiée. La Cour de Strasbourg, dans ces conditions, a dit que la procédure n’était pas équitable. Cet arrêt, pour moi, n’est pas vraiment exceptionnel. Il est dans le droit fil de ce principe de base : ce n’est pas qu’on applique l’uniformité à tout le monde, c’est simplement que l’on doit respecter le principe selon lequel si des observations sont présentées à un tribunal dans l’objectif d’influer sur sa décision, il faut que les parties puissent en connaître la teneur et y répondre d’une manière adéquate. Le rôle de l’avocat général est sans doute objectif, mais ses " conseils " peuvent être décisifs pour la question de la culpabilité de l’accusé - d’où la conclusion qu’un déséquilibre entre l’accusé et l’avocat général ne se concilie pas avec les exigences du procès équitable.
Eddin Helali (maître de conférences à l’Université de Nancy II)
La Cour, lorsqu’elle a à examiner une affaire de cette nature, opte pour la réunion de la Grande chambre. Elle estime par là que le problème est manifestement complexe et comme le problème est tellement complexe, la complexité de l’affaire l’amène souvent à rendre un arrêt d’une grande simplicité quant à la solution adoptée en utilisant les faits de l’affaire pour les confronter à la règle de " raisonnabilité ". La confrontation en la circonstance d’un fait, le Code d’organisation judiciaire français et d’un principe relatif au droit de la défense incite la Cour à constater que le procès est déséquilibré parce que toutes les parties au procès n’ont pas connaissance de tout le dossier alors que l’Avocat général, partie au procès, connaît tout le dossier, notamment les conclusions du rapporteur spécial. La solution la plus simple, la plus raisonnable et respectueuse des droits de la défense consisterait à reconnaître à toutes les parties au procès le droit d’accéder à la totalité du rapport en question ou de ne pas y accéder. L’Avocat général serait sur un pied d’égalité avec les parties et le déséquilibre disparaîtrait.
François-Guilhem Bertrand
Si vous êtes en train de découvrir qu’il y a un déséquilibre entre les parties et les juridictions, je suis d’accord avec vous.
La motivation des arrêts de la Cour de cassation :
affaire Higgins (19 février 1998)
par
Me Vincent DELAPORTE
Avocat aux Conseils
1.- L'affaire Higgins constitue un exemple typique de ces procédures complexes qui s'alourdissent et s'épaississent avec le temps et que personne ne parvient plus à maîtriser. A l'origine de cette affaire, se trouvait une contestation en matière successorale opposant une vingtaine d'héritiers qui demandaient l'annulation de dispositions prises par le défunt pour faire échapper ses biens aux règles légales de dévolution.
Comme il arrive parfois en ce cas, différentes procédures furent engagées, et par là-même, différentes instances, différentes contestations qui se recoupaient partiellement, et qui ont fini par constituer un véritable labyrinthe, une machine infernale incontrôlable , pas même par les parties et les avocats qui l'avaient mise en place.
Avec le recul que nous donne le temps, et la synthèse probablement épurée que nous donne de l'affaire l'arrêt rendu par la Cour de Strasbourg, on trouve dans cette affaire Higgins des étrangetés. Et à la vérité, on ne comprend pas bien ni la position des requérants, ni les arrêts rendus par la Cour de cassation dans cette affaire, ni enfin l'arrêt rendu par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Pour en rester à l'essentiel, il faut rappeler que le Tribunal de grande instance de Papeete avait été saisi par les héritiers, les consorts Higgins, de trois procédures, sur lesquelles il avait été statué par trois jugements en 1988.
Deux de ces jugements avaient été défavorables aux héritiers, l'un leur avait été favorable.
2.- Les trois jugements avaient été frappés d'appel et c'est en cet état que les 25 mai et 1er juin 1989, les consorts Higgins ont saisi la Cour de cassation de deux requêtes en suspicion légitime visant à dessaisir la Cour d'appel de Papeete.
A l'appui de ces requêtes, les consorts Higgins faisaient valoir que la Cour ne comportait que six magistrats, que leur adversaire, le notaire, avait occupé une place éminente à Papeete et entretenu avec de nombreux magistrats de la Cour d'appel des relations amicales et privilégiées. Ils faisaient valoir qu'ils avaient obtenu sur les biens du notaire une mesure de séquestre à laquelle leur adversaire avait réagi très violemment en qualifiant publiquement la mesure d'acte de terrorisme judiciaire. Et les requêtes concluaient :
"certains magistrats de Papeete, eux-mêmes divisés, mis en cause publiquement, ayant pris parti sur des faits touchant étroitement aux procédures encore en cours, éprouvent le sentiment qui au-delà de leur bonne volonté, leur impartialité pourrait être objectivement mise en cause et que légitimement le soupçon peut peser sur les décisions qu'ils seront conduits à rendre".
Il faut insister sur une particularité qui semble être à l'origine de la destination de l'affaire vers la CEDH : alors qu'il y avait eu trois jugements et trois appels, les consorts Higgins n'ont présenté que deux requêtes en suspicion légitime, dont l'une visait deux instances d'appel. Au-delà de cette particularité formelle, il était bien demandé, sur le fond, à la Cour de cassation, de dessaisir la Cour d'appel de Papeete des trois instances d'appel dont elle était saisie. Cependant, par un arrêt du 22 mars 1990, la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur les deux requêtes qu'elle a estimé fondées. La Cour de cassation, dans cet arrêt du 22 mars 1990, déclare que :
"s'il n'est rapporté la preuve d'aucune prise de position par les magistrats de la Cour d'appel de Papeete sur l'issue des procès qui sont soumis à leur examen, il résulte des faits allégués et des productions que les consorts Higgins peuvent éprouver un doute sur l'impartialité de la juridiction chargée de juger leur procès ; qu'il convient donc d'ordonner le renvoi devant une autre juridiction dont la décision s'imposera au respect de tous avec l'autorité qui doit s'attacher aux arrêts de justice.
"Par ces motifs :
"Ordonne le renvoi devant la Cour d'appel de Paris des affaires suivantes..."
Et c'est là que l'affaire prend tout son relief : la Cour de cassation, statuant sur deux requêtes visant trois instances d'appel, déclare ces requêtes fondées mais n'ordonne le renvoi que pour deux des trois instances et ne dit pas mot du sort de la troisième.
La Cour de cassation ne fait pas allusion à la troisième instance sur laquelle elle n'ordonne pas le renvoi ni ne rejette la requête.
Devant ce silence de l'arrêt du 22 mars 1990, les consorts Higgins présentent le 2 juillet suivant une requête "en rectification d'erreur matérielle".
Cette requête est rejetée par un arrêt du 23 octobre 1991, avec les motifs suivants :
"Attendu... qu'à l'appui de leur requête ils soutiennent que cette décision est entachée d'une erreur matérielle, la Cour de cassation ayant ordonné la jonction de deux requêtes... dont elle était saisie et n'ayant ordonné le renvoi que des deux affaires visées par la première de ces deux requêtes ;
"Mais attendu que sous le prétexte d'une rectification, la requête tend à apporter une modification aux dispositions précises de l'arrêt ;
"Par ces motifs :
"Rejette la requête ;
"Dit n'y avoir pas lieu à rectifier l'arrêt du 22 mars 1990".
3.- Entre-temps, la procédure sur le fond avait suivi son cours devant la Cour d'appel de Papeete qui avait refusé de surseoir à statuer dans l'attente des décisions de la Cour de cassation sur les requêtes en renvoi, et qui avait donc statué au fond par deux arrêts du 29 juin 1990 et un arrêt du 7 décembre 1989.
En ce qui concerne les deux instances renvoyées devant la Cour d'appel de Paris par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 1990, la Cour de Papeete s'était prononcée par deux arrêts du 29 juin 1989. Ces deux arrêts ont été attaqués par deux pourvois en cassation, sur lesquels la Cour de cassation a prononcé un non-lieu à statuer le 16 juillet 1991. En effet, le renvoi devant la Cour de Paris, ordonné par l'arrêt du 22 mars 1990, conduisait à considérer comme nuls et non avenus les deux arrêts rendus par la Cour d'appel de Papeete le 29 juin 1989, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les pourvois dirigés contre eux ;
- quant à la troisième instance d'appel oubliée, comme on l'a vu, par la Cour de cassation dans son arrêt du 22 mars 1990, la Cour de Papeete s'était prononcée par un arrêt du 7 décembre 1989, qui avait été lui aussi frappé de pourvoi. Ce pourvoi a été rejeté par un arrêt de la Première Chambre civile du 17 décembre 1991, lequel statuait uniquement sur les moyens de fond dont la Cour de cassation était saisie, et qui n'invoquaient pas un défaut d'impartialité de la Cour d'appel de Papeete.
Dans le cadre du pourvoi contre cet arrêt du 7 décembre 1989, c'est seulement dans un mémoire complémentaire et une lettre à l'avocat général, après l'expiration du délai de mémoire ampliatif, que les consorts Higgins avaient fait valoir que la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime et l'absence d'impartialité objective de la Cour d'appel de Papeete.
L'arrêt de rejet du 17 décembre 1991 n'évoque donc pas cette question qui n'était pas abordée dans le mémoire ampliatif.
4.- Les données de la difficulté soumise à la Cour peuvent donc se résumer ainsi :
- la Cour d'appel de Papeete était saisie de trois instances connexes dans lesquelles son impartialité objective pouvait être suspectée ;
- les consorts Higgins avaient présenté deux requêtes dans lesquelles ils demandaient le renvoi pour cause de suspicion légitime des trois instances dont était saisie la Cour de Papeete ;
- cette requête a été jugée fondée par la Cour de cassation dans son arrêt du 22 mars 1990 ;
- c'est à l'évidence par une inadvertance de rédaction que cet arrêt du 22 mars 1990 n'a ordonné le renvoi que de deux instances sur trois ;
- ni l'arrêt du 22 mars 1990, ni celui du 23 novembre 1991 rejetant la requête en rectification d'erreur matérielle, ni enfin l'arrêt de rejet au fond du 17 décembre 1991 ne permettent d'affirmer que la Cour de cassation a estimé non fondée la demande de renvoi en tant qu'elle concernait la troisième procédure, et dans l'affirmative pour quelles raisons.
C'est dans cet état que les consorts Higgins ont saisi la Commission puis la Cour Européenne des Droits de l’Homme, se plaignant d'une violation de l'article 6, paragraphe 1er de la Convention qui serait caractérisée par le fait que "leur cause a été jugée par une juridiction dont le dessaisissement a été admis pour cause de suspicion légitime, mais non ordonné, la Cour de cassation, bien qu'ayant reconnu la légitimité de la suspicion des requérants, ayant à plusieurs reprises refusé d'en tenir compte".
5.- Cette requête a été déclarée fondée par l'arrêt commenté du 19 février 1998 de la Cour européenne. Mais ce qui saute aux yeux, c'est que la Cour a reconnu la violation de l'article 6, paragraphe 1er par un grief distinct de celui qui était invoqué par les requérants. Alors que ces derniers se plaignaient d'un défaut d'impartialité pour avoir été jugés, dans la troisième instance, par une juridiction, la Cour d'appel de Papeete, dont le défaut d'impartialité objective avait été reconnu par la Cour de cassation elle-même dans les deux autres instances, la Cour s'est placée, quant à elle, sur le terrain distinct du défaut de motivation. Le glissement est illustré dans le paragraphe 42 de l'arrêt, ainsi libellé :
"La Cour doit examiner le grief des requérants relatif à la manière dont la Cour de cassation a statué sur leurs doléances tenant au manque d'impartialité de la Cour d'appel de Papeete dans le cadre de la procédure contre la BBC, et plus particulièrement son omission de motiver sa décision sur ce point.
"Elle rappelle que l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu'il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (arrêt Van de Hurk c/Pays-Bas du 19 avril 1994, série A, n° 288, p. 20, § 61). L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (arrêts Ruiz Torija et Hiro Balani c/Espagne du 9 décembre 1994, série A, n° 303-A et B, p. 12, § 79, et pp. 29-30, § 27).
Ayant ainsi posé le problème, la Cour européenne se réfère aux deux requêtes dont l'une concernait deux procédures et l'autre une seule procédure.
La Cour rappelle encore l'arrêt du 22 mars 1998 dans lequel la Deuxième Chambre civile avait reconnu que l'impartialité de la Cour d'appel de Papeete pouvait être objectivement suspectée et dans lequel elle avait ordonné, dans le dispositif de sa décision, le renvoi de deux procédures seulement, sans évoquer la troisième pourtant visée explicitement au début de l'arrêt.
La Cour européenne relève que "cette dernière procédure était étroitement liée aux deux autres, puisqu'elle faisait partie d'un contentieux successoral complexe concernant pratiquement un même groupe de personnes et un même ensemble de biens... Par ailleurs, la composition de la juridiction d'appel était très semblable puisqu'à l'exception d'un seul conseiller... c'était la même formation de jugement qui avait connu des trois affaires".
La Cour européenne en arrive à la conclusion suivante :
"L'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 1990 ne fournit aucune indication de nature à éclairer la Cour sur le sort différent accordé à la procédure contre la BBC.
"Ni la procédure en rectification d'erreur matérielle, ni celle en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel du 7 décembre 1989 n'ont fourni aux requérants une réponse explicite et spécifique sur les conséquences à tirer de l'arrêt du 22 mars 1990. Faute de cette dernière (réponse), il est impossible de savoir si la Cour de cassation a simplement négligé d'évoquer la troisième affaire ou bien n'a pas voulu en ordonner le renvoi et, dans cette dernière hypothèse, pour quelles raisons.
"Il y a donc eu violation de l'article 6, paragraphe 1".
Il est donc clair que c'est le défaut de motivation que la Cour européenne a voulu sanctionner. La Cour a donc confirmé sa jurisprudence déjà bien établie en la matière.
6.- Pourtant, à la différence de l'impartialité qui est expressément exigée, la motivation ne va pas de soi au regard des dispositions de l'article 6 paragraphe 1. La Cour a cependant admis depuis longtemps que cette exigence se trouvait implicitement contenue dans la notion de procès équitable. "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement...". Il en résulte selon la Cour l'obligation pour les juges de motiver leurs décisions.
En effet, la motivation, c'est-à-dire l'explication des éléments de fait et de droit qui ont déterminé la décision du juge, garantit les parties contre les appréciations arbitraires et discrétionnaires ; elle garantit aussi l'autorité du législateur en permettant le contrôle de l'adéquation de la décision aux règles de droit ; elle garantit aussi le juge contre ses propres risques d'erreur, en l'obligeant à énoncer et donc à structurer le raisonnement qui l'a conduit à sa décision.
La Cour a donc rappelé sa jurisprudence sur l'obligation de motivation, et notamment son arrêt Van de Hurk c/ Pays-Bas du 19 avril 1994 :
"L'article 6 paragraphe 1 implique notamment, à la charge du tribunal, l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre".
Dans cette affaire, la Cour a ensuite constaté que cette exigence n'avait pas été méconnue au préjudice de M. Van de Hurk. Mais par deux arrêts du 23 novembre 1994, qui mettaient en cause l'Espagne, la Cour européenne a sanctionné le défaut de motivation de décisions juridictionnelles espagnoles, et elle a précisé avec prudence l'étendue de l'obligation. Dans ces deux arrêts (Hiro Balani et Ruiz Torija) la Cour européenne pose pour principe :
"La Cour rappelle que l'article 6 paragraphe 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions mais qu'il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument... L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Il faut en outre tenir compte notamment de la diversité de moyens qu'un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les Etats contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction des jugements et arrêts. C'est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l'article 6 de la Convention ne peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce dans les deux affaires, la Cour européenne constate qu'à défaut de réponse spécifique et explicite des décisions espagnoles aux moyens des parties, il était impossible de savoir si la juridiction espagnole avait simplement négligé les moyens ou bien avait voulu les rejeter et dans cette dernière hypothèse pour quelles raisons" (§ 27 de l'arrêt Hiro Balani et § 29 de l'arrêt Ruiz Torija).
La Cour paraît avoir du reste renforcé ses exigences en cette matière ; dans un arrêt Hell c/ Finlande du 19 novembre 1997, elle restreint la possibilité pour une juridiction supérieure de motiver sa décision par référence aux motifs de la juridiction inférieure. Elle énonce en effet ce qui suit :
"La Cour souligne que la notion de procès équitable requiert qu'une juridiction interne qui n'a que brièvement motivé sa décision, que ce soit en incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure ou autrement, ait réellement examiné les questions qui lui ont été soumises et qu'elle ne se soit pas contentée d'entériner purement et simplement les conclusions d'une juridiction inférieure. Cette exigence est plus importante lorsqu'une partie n'a pu présenter sa cause oralement dans la procédure interne...".
7.- Ces motifs retentissent comme un avertissement à l'égard des deux juridictions suprêmes que constituent en France le Conseil d'Etat et la Cour de cassation.
En ce qui concerne le Conseil d’Etat, on sait que celui-ci filtre les pourvois par le biais de la procédure dite d’admission des pourvois en cassation. Avant de procéder à l’instruction de l’affaire au fond, la sous-section chargée de l’instruction se prononce sur l’admission ou la non-admission des pourvois. L’admission est une décision non juridictionnelle qui n’est pas motivée. Mais le refus d’admission, qui met fin à la procédure devant le Conseil d’Etat, est une décision juridictionnelle qui à ce titre doit être motivée. Mais cette motivation est toute symbolique, et le respect d’une apparence de motivation ne peut tromper l’esprit le plus crédule : en guide de motivation, les arrêts de refus d’admission se bornent à viser la requête, à faire un résumé succinct, parfois caricatural des moyens soutenus. A la suite de quoi se trouve dans tous les arrêts la même formule lapidaire : " aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi ".
Et c’est ainsi que le pourvoi en cassation est écarté sans plus ample explication.
Quant à la Cour de cassation, elle évacue également un certain nombre de pourvois par une motivation stéréotypée dite " arrêt tampon " qui ne donne pas davantage d’explication sur les raisons qui justifient la décision de rejet.
On peut douter sérieusement de la conformité de cette pratique aux exigences de la Cour européenne.
8.- L’affaire Higgins a donc pour principal mérite de mettre en évidence l’exigence d’une motivation sérieuse, précise et circonstanciée qui s’impose non seulement aux juridictions du fond, mais également aux juridictions suprêmes.
La Cour de cassation n’a peut-être pas été insensible à cette leçon puisque dans un arrêt rendu la semaine dernière, le 10 décembre 1998, destiné à la publication et à une diffusion accélérée, elle a posé un principe qui sans être totalement révolutionnaire, ne paraît pas avoir été antérieurement formulé avec autant de netteté. Dans cet arrêt, qui vise l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation pose en principe que " les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions " (Cass. 2ème Civ., 10 décembre 1998, pourvoi n° W/96-22.023).
Dans cette affaire, l’adjudicataire d’un immeuble vendu sur saisie-immobilière contestait l’acte de surenchère en raison de l’insolvabilité du surenchérisseur. Et de fait, les circonstances de la surenchère étaient assez troubles pour permettre de suspecter le surenchérisseur de servir de prête-nom à une opération de blanchiment de capitaux. L’adjudication avait eu lieu pour environ 1 000 000 de francs ; et la surenchère avait été faite par un modeste ouvrier déclarant un revenu mensuel de 7 500 francs, qui avait reconnu expressément qu’il ne détenait personnellement aucun capital. De façon encore plus curieuse, ce surenchérisseur avait obtenu plusieurs mois après la surenchère un engagement de caution d’une banque correspondant au montant de la surenchère. Et c’est pourquoi le Tribunal avait écarté la nullité de la surenchère pour insolvabilité notoire : selon le Tribunal, ce cautionnement bancaire, fût-il donné après l’acte de surenchère, excluait l’insolvabilité du surenchérisseur. Après quoi le Tribunal avait refusé d’examiner les circonstances qui démontraient que le surenchérisseur n’avait pas les moyens de payer personnellement le prix d’adjudication. Suivant la jurisprudence classique, le pourvoi aurait dû être rejeté, puisque la solvabilité du surenchérisseur est appréciée souverainement par les juges du fond.
La nouveauté de cet arrêt du 10 décembre 1998 tient au chapeau posant en principe que les juges du fond ne peuvent se borner à une appréciation lapidaire, quand bien même celle-ci porterait sur une question de fait. Selon la Cour de cassation : les juges doivent " examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ". Même si l’arrêt du 10 décembre 1998 ne vise pas l’article 6 paragraphe 1, on peut présumer que la Cour de cassation n’a pas été insensible aux principes dégagés par la Cour européenne.
9.- Cela dit, l'arrêt Higgins laisse subsister plusieurs sujets d'interrogation.
Tout d'abord, on ne comprend pas bien comment la Cour a pu opérer une substitution de griefs : selon les énonciations de l'arrêt Higgins lui-même, la requête était fondée sur le fait que la troisième procédure n'avait pas été jugée par une juridiction objectivement impartiale ; autrement dit les consorts Higgins se plaignaient d'avoir été jugés par la Cour d'appel de Papeete qui ne présentait pas la garantie d'impartialité objective. Mais sous couvert d'accueillir ce grief, la Cour en retient un autre, qui est conceptuellement bien distinct et qui consiste dans le défaut de motifs des arrêts de la Cour de cassation des 22 mars 1990, 23 octobre 1991 et 17 décembre 1991. Comme le dit l'arrêt, "il est impossible de savoir si la Cour de cassation a simplement négligé d'évoquer la troisième affaire ou bien n'a pas voulu en ordonner le renvoi et, dans cette hypothèse, pour quelles raisons". C'est donc un défaut de motifs, et non un défaut d'impartialité que la Cour a sanctionné dans son arrêt du 19 février 1998. On peut s'étonner légitimement d'une telle substitution.
Un second sujet d'étonnement devant cette affaire tient au fait que tant les consorts Higgins que la Cour de cassation se sont abstenus de faire référence à la procédure qui, semble-t-il, s'imposait et qui consistait dans une requête en omission de statuer. Dans cette affaire, les consorts Higgins ont présenté à la Cour de cassation une requête en rectification d'erreur matérielle. Il est bien certain que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur la demande de renvoi pour suspicion légitime de la troisième procédure. Mais l'omission du juge de se prononcer sur un chef de demande ne constitue pas une erreur matérielle au sens de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile. Il s'agit tout simplement d'une omission de statuer qui peut être réparée suivant la procédure visée à l'article 463 : "la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens".
On ne comprend pas que dans cette affaire Higgins, les parties se soient arrêtées à la qualification d'erreur matérielle, alors qu'il s'agissait à l'évidence d'une omission de statuer. On ne comprend pas non plus que la Cour de cassation n'ait pas rectifié d'elle-même cette erreur, comme elle le fait souvent. Lorsque la Cour de cassation estime qu'un jugement a fait l'objet à tort d'un recours, elle déclare ce recours irrecevable mais dans le même temps, elle indique le recours qui aurait dû être formé.
Dans cette affaire, ce n'était pas un gros effort pour la Cour de cassation que de dire qu'il n'y avait pas d'erreur matérielle mais omission de statuer et de compléter, sous cette qualification, l'arrêt du 22 mars 1990. Cela eût évité à la France une nouvelle condamnation à Strasbourg.
La jurisprudence Poitrimol confirmée :
affaires Omar et Guérin (29 juillet 1998)
par
Michèle DUBROCARD
Magistrat (Ministère des Affaires étrangères)
Les arrêts Poitrimol, Omar et Guérin, rendus par la Cour européenne des droits de l’Homme le 29 novembre 1993 en ce qui concerne le premier de ces trois arrêts, et le 29 juillet 1998 en ce qui concerne les deux autres, soulèvent une question de droit identique : dans chacune de ces affaires en effet, les requérants se sont vus opposer l’application d’une jurisprudence séculaire de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en vertu de laquelle est déclaré irrecevable le pourvoi formé par un demandeur qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt et qui n’a pas déféré à celui-ci en toute connaissance de cause. Or la Cour européenne des droits de l’Homme a conclu dans ces trois affaires à la violation de l’article 6 par.1 de la Convention en considérant que le droit d’accès des requérants à un tribunal avait été méconnu.
Une lecture rapide de ces trois arrêts pourrait laisser penser que la position de la Cour de Strasbourg est désormais confirmée, à l’égard de cette jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation, qui serait donc contraire aux exigences résultant de l’article 6 de la Convention.
Une telle conclusion peut cependant apparaître trop hâtive, compte tenu d’une part de la particularité de l’affaire Poitrimol par rapport aux deux autres, et d’autre part de la motivation retenue par la Cour européenne des droits de l’Homme dans les affaires Omar et Guérin, qui n’est pas sans susciter quelques incertitudes sur la position de la Cour.
I- les particularités de l’affaire Poitrimol
M. Poitrimol avait été condamné en première instance par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine d'un an d'emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt, pour non-représentation d'enfant. Il ne s'était pas rendu ‡ l'audience, mais il s'y était fait représenter par deux avocats.
Il avait ensuite interjeté appel du jugement mais, une fois encore, n'avait pas comparu devant la Cour d’appel d'Aix-en-Provence. Celle-ci devait cependant juger sa présence nécessaire, et l'avait réassigné. Mais le requérant ne s'était pas montré à la nouvelle audience fixée par la Cour d’appel, qui avait alors refusé à son avocat la possibilité de représenter son client.
A la suite de l'arrêt rendu par la Cour d’appel d'Aix-en-Provence, M.Poitrimol avait formé un pourvoi en cassation par l'intermédiaire d'un avocat. Cependant, la Cour de cassation devait déclarer ce pourvoi irrecevable, au motif que le condamné qui n'obéit pas à un mandat d'arrêt n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation.
A la différence des affaires Omar et Guérin, l'affaire Poitrimol posait non pas un mais deux problèmes juridiques différents :
- la question de la condamnation de M. Poitrimol en son absence par la Cour d’appel, sans que son avocat ait pu présenter à l'audience ses moyens de défense ;
- la question de l'irrecevabilité de son pourvoi en cassation au motif qu'il n'avait pas obéi au mandat d'arrêt décerné contre lui.
A une très courte majorité -cinq voix contre quatre-, la Cour européenne des Droits de l’Homme a considéré qu'il y avait eu en l'espèce un manquement aux exigences de l'article 6, tant au stade de la Cour d’appel que devant la Cour de cassation.
S'agissant de l'irrecevabilité du pourvoi pour des raisons liées à la fuite de M.Poitrimol, la Cour européenne a estimé que cette règle établie par la Cour de cassation "s'analysait (...) en une sanction disproportionnée, eu égard à la place primordiale que les droits de la défense et le principe de la prééminence du droit occupent dans une société démocratique".
Cette motivation permettait de penser que le constat de violation du droit d’accès de M. Poitrimol à la Cour de cassation se fondait sur les circonstances très particulières de la cause, relatives aux conditions dans lesquelles il avait été jugé par les juridictions du fond : la Cour d’appel d'Aix-en-Provence avait en effet rendu à l’encontre du requérant un arrêt réputé contradictoire, en refusant en outre à son avocat la possibilité de le représenter.
Selon la Cour européenne des droits de l’Homme, la décision de la Cour d’appel avait eu pour effet de priver "M. Poitrimol, non recevable à former opposition contre l'arrêt de la Cour d’appel, de sa seule chance de faire plaider en seconde instance sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit".
Or, comme le notait encore la Cour, en droit interne la possibilité pour le prévenu non comparant de se faire représenter en appel "dépend dans une large mesure du point de savoir s'il a fourni des excuses valables pour justifier son absence".
Dans cette perspective, selon la Cour européenne, "un contrôle juridique des motifs par lesquels une Cour d’appel a rejeté de telles excuses se révèl(ait) indispensable".
Selon cette motivation, l'irrecevabilité du pourvoi en cassation formé par M. Poitrimol avait donc été appréciée en prenant dûment en considération les conditions dans lesquelles celui-ci avait été jugé en deuxième instance. En d'autres termes, la lecture de l'arrêt Poitrimol permettait de penser que la Cour avait analysé l'irrecevabilité du pourvoi comme une "sanction disproportionnée", précisément parce que le requérant avait été privé de facto de la faculté de faire contrôler la légalité de la décision de la Cour d’appel, qui avait méconnu son droit à l'assistance d'un défenseur.
Cette interprétation de l'arrêt Poitrimol laissait donc entière la question de la compatibilité de la jurisprudence de la Cour de cassation avec la Convention dans l’hypothèse de personnes ayant participé aux audiences devant les juridictions du fond, et s'étant ensuite pourvues en cassation sans avoir déféré au mandat d’arrêt décerné contre elles.
Les arrêts Omar et Guérin apportent une réponse à cette question, encore que la réponse ne soit pas parfaitement claire.
II- La motivation des arrêts Omar et Guérin
Dans l’affaire Omar, comme dans l’affaire Guérin, les requérants ont été jugés contradictoirement, après avoir eux-mêmes participé à l’audience devant la Cour d’appel en étant assistés de leurs conseils. C’est seulement le jour du prononcé de l’arrêt les condamnant qu’ils n’ont pas comparu, et qu’ils ont alors fait l’objet d’un mandat d’arrêt, auquel ils n’ont pas déféré.
Plus particulièrement dans l’affaire Omar, aucun des trois requérants, à savoir MM. Cheniti, Kamal et Hassane Omar, ne déféra aux mandats d’arrêt, mais Cheniti Omar fut arrêté par la police sur son lieu de travail trois mois après le prononcé de l’arrêt le condamnant. Quant à Kamal et Hassane Omar, ils furent interpellés respectivement en avril et septembre 1994, soit postérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation déclarant irrecevable leur pourvoi. Les mandats décernés contre eux furent alors exécutés.
Dans l’affaire Guérin, le requérant se fit hospitaliser dans une clinique psychiatrique le 24 novembre 1992, c’est-à-dire le lendemain de l’arrêt de la Cour d’appel le condamnant, où il resta jusqu’au 16 décembre 1992. C’est à cette date en effet que les autorités de police exécutèrent le mandat d’arrêt décerné contre lui, en se rendant à l’établissement où il séjournait.
Dans ces deux affaires, la motivation de la Cour européenne est la même :
"La Cour ne peut que constater que l’irrecevabilité d’un pourvoi en cassation, fondée uniquement, comme en l’espèce, sur le fait que le demandeur ne s’est pas constitué prisonnier en exécution de la décision de justice faisant l’objet d’un pourvoi, contraint l’intéressé à s’infliger d’ores et déjà à lui-même la privation de liberté résultant de la décision attaquée, alors que cette décision ne peut être considérée comme définitive aussi longtemps qu’il n’a pas été statué sur le pourvoi ou que le délai de recours ne s’est pas écoulé".
La Cour poursuit son raisonnement en ajoutant :
"On porte ainsi atteinte à la substance même du droit de recours, en imposant au demandeur une charge disproportionnée, rompant le juste équilibre qui doit exister entre, d’une part, le souci légitime d’assurer l’exécution des décisions de justice et, d’autre part, le droit d’accès au juge de cassation et l’exercice des droits de la défense".
Cette motivation laisse le champ libre ‡ deux interprétations différentes :
- il est sans doute possible de considérer qu’il s’agit là d’une motivation de principe, qui a d’ailleurs été utilisée de façon rigoureusement identique dans les deux affaires. Il résulterait alors du raisonnement suivi par la Cour européenne que l’irrecevabilité d’un pourvoi présentée par une personne n’ayant pas préalablement déféré au mandat d’arrêt décerné contre elle constituerait dans tous les cas une sanction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal.
Il en serait ainsi que la personne ait bénéficié ou non d'un procès équitable avant de se pourvoir en cassation, et qu'elle ait ou non pris la fuite après la décision de condamnation.
Cette interprétation prolongerait ainsi l’appréciation portée par la Commission européenne des droits de l’Homme dans ces deux affaires. En effet, dans son rapport adopté le 6 mars 1997 sur la requête présentée par MM. Cheniti, Kamal et Hassane Omar et qui concernait le même grief, la Commission européenne a clairement interprété extensivement l'arrêt de la Cour en considérant que sa décision dans l'affaire Poitrimol "vaut non seulement pour les cas où un accusé a vainement tenté en appel de justifier son refus de comparaître et de se faire représenter mais qu'elle vise la disproportion de la sanction en tant que telle".
Dans l’affaire Guérin, la Commission a suivi le même raisonnement que celui qu'elle avait adopté dans son rapport sur la requête présentée par MM. Omar, et a conclu à la violation de l'article 6 par.1 de la Convention, au motif que M. Guérin "a subi une entrave disproportionnée à son droit d'accès à un tribunal et, partant, à son droit à un procès équitable".
- La motivation de la Cour dans les arrêts Omar et Guérin permet cependant d’avoir une approche plus nuancée de sa position. La Cour insiste en effet sur le fait que, dans ces deux affaires, l’irrecevabilité du pourvoi était fondée "uniquement", "en l’espèce", sur l’absence de déferrement au mandat d’arrêt. L’utilisation de ces termes n’est pas indifférente, et laisse penser que si la Cour de cassation avait elle-même motivé de façon plus détaillée ses décisions d’irrecevabilité des pourvois formés par MM. Omar et Guérin, elle n’aurait pas encouru les critiques de la Cour européenne.
En d’autres termes, les arrêts Omar et Guérin ne remettraient pas définitivement en cause la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation en matière d’irrecevabilité des pourvois formés par des personnes n’ayant pas obéi au mandat d’arrêt dont elles faisaient l’objet. Mais ils imposeraient une motivation plus développée de ses arrêts, afin de vérifier, au cas par cas, les conditions dans lesquelles les demandeurs n’ont pas déféré au mandat d’arrêt.
Il convient de rappeler à ce titre que selon la motivation de principe de la Cour de cassation, le pourvoi présenté par le demandeur n'ayant pas obéi à un mandat d'arrêt est déclaré irrecevable, à moins qu'il ne puisse justifier "de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile ‡ l'action de la justice".
Il suffirait alors, pour que la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière soit conforme aux exigences de la Convention, que la Haute juridiction admette plus largement les circonstances susceptibles de placer un demandeur dans l'impossibilité absolue de se soumettre au mandat d'arrêt dont il fait l'objet.
Cette analyse de la motivation de la Cour européenne est confortée par les développements ultérieurs de son raisonnement, qui figurent dans les paragraphes suivants, et où elle s’attache à l’examen des faits de l’espèce.
Ainsi, dans l’affaire Guérin, la Cour prend soin de préciser au paragraphe 46 les conditions dans lesquelles le requérant a été jugé en première puis en deuxième instance, avant d’être hospitalisé dans un établissement psychiatrique. La Cour note en particulier qu’"à tout moment il était loisible à la police de se saisir de sa personne, ce qu’elle fit d’ailleurs dès le 16 décembre 1992 dans la maison de santé où il se trouvait" ; La Cour conclut en indiquant qu’"eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause", le requérant a subi une entrave excessive à son droit d’accès à un tribunal.
De la même manière, dans l’arrêt Omar, la Cour mentionne au paragraphe 43 les conditions dans lesquelles les requérants ont été condamnés, et elle relève ici également qu’"à tout moment il était loisible à la police de se saisir de leurs personnes, ce qu’elle fit d’ailleurs en ce qui concerne M. Cheniti Omar, arrêté sur son lieu de travail le 27 mai 1995". La Cour conclut enfin en utilisant la même expression, à savoir qu"eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause", la Cour estime que les requérants ont subi une entrave excessive à leur droit d’accès à un tribunal.
Il apparaît donc clairement que la Cour européenne des droits de l’Homme ne s'est pas contentée, dans ces deux affaires Omar et Guérin, d'énoncer une position de principe, mais elle a également pris en considération le fait qu'aucun des requérants n'était, selon elle, en fuite au moment de la déclaration de son pourvoi.
La Cour compare d'ailleurs les présentes espèces à l’affaire Poitrimol, en relevant que si M. Poitrimol "avait quitté le territoire français et se trouvait en fuite à l’étranger avec ses deux enfants", en revanche ni MM. Omar, ni M. Guérin ne tentèrent "de se soustraire à l’exécution des mandats d’arrêt", ce qui du reste, concernant M. Guérin tout au moins, a été mis en doute par le Gouvernement français.
Or, on l’a vu, l’affaire Poitrimol est différente des affaires Omar et Guérin, en ce que M. Poitrimol n'avait comparu à aucune des audiences devant les juridictions du fond, et que cette circonstance avait influé sur l'examen de l'irrecevabilité du pourvoi.
Il apparaît donc possible d'analyser les arrêts Omar et Guérin comme des arrêts d’espèce où, à la différence de M. Poitrimol, les requérants ont été jugés contradictoirement mais n'ont pas, en revanche, pris la fuite à l'issue de leur condamnation.
Dans cette perspective, il faudrait alors considérer que la Cour européenne des droits de l’Homme n’a pas encore statué sur l’hypothèse dans laquelle le demandeur au pourvoi aurait participé en personne aux audiences à l’issue desquelles il aurait été condamné, mais aurait ensuite délibérément cherché à se soustraire au mandat d’arrêt décerné contre lui. Encore faudrait-il que dans une telle hypothèse la Cour de cassation constate expressément la volonté de fuite du demandeur.
Cette deuxième analyse de la motivation des arrêts Omar et Guérin semble bien avoir été celle du juge Pettiti, qui dans son opinion dissidente sur l’affaire Guérin, estimait que :
"En tout cas, l’interprétation la plus prudente de l’arrêt à partir du paragraphe 43 serait de considérer que la Cour a été surtout attentive au cas de force majeure et de bonne foi établis dans le dossier Guérin, et qu’elle n’a pas expressément statué sur l’opposabilité des mandats d’arrêt aux modalités d’exercice du pourvoi en cassation et de l’examen de celui-ci".
Quelle que soit l'interprétation que l'on retienne des arrêts Omar et Guérin, la chambre criminelle de la Cour de cassation sera sans aucun doute conduite à réexaminer sa jurisprudence relative à l'irrecevabilité des pourvois formés par des demandeurs faisant l'objet d'un mandat d'arrêt.
Dans l'hypothèse la plus exigeante, la chambre criminelle devra renoncer purement et simplement à cette jurisprudence traditionnelle, fondée sur des motifs essentiellement moraux.
Dans l'hypothèse la plus conciliante à l'égard de cette jurisprudence, la chambre criminelle devra motiver différemment ses arrêts, et s'attacher davantage aux circonstances de fait qui la conduisent à déclarer irrecevable le pourvoi.
Cette modification de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière ne devrait cependant pas poser de problèmes insurmontables, compte-tenu de l'évolution déjà constatée depuis plusieurs années, qui a été relevée par le juge Pettiti dans son opinion dissidente.
En effet, la Cour de cassation considère que la règle n'a plus lieu de s'appliquer dès lors que peut être présumée la bonne foi du requérant. C'est ainsi qu'est d'ores et déjà admis le pourvoi de celui qui prend le risque d'être arrêté, en indiquant son adresse exacte dans sa déclaration de recours, ou encore de celui qui intente personnellement le pourvoi, en se présentant au greffe avant toute exécution de mandat.
Si la Cour de cassation souhaite maintenir sa jurisprudence en la matière, il lui appartiendra néanmoins de l'infléchir encore un peu, à la lumière de ces deux arrêts récents de la Cour européenne des droits de l’Homme. Tel avait été d'ailleurs le point de vue défendu par le conseiller-rapporteur, Mme Verdun, dans le rapport qu'elle avait rédigé sur le pourvoi présenté par M. Guérin.
|