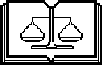|
Allégation
de torture
et
non-épuisement des voies de recours internes
L’affaire
Selmouni (arrêt du 28 juillet 1999)
par
Michèle
DUBROCARD
Sous-directeur
des droits de l’Homme,
Direction
des Affaires juridiques, Ministère des Affaires étrangères
Habituellement,
en France, les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’Homme
suscitent peu d’intérêt de la part des médias, et nombreux sont les
journalistes qui, aujourd’hui encore, confondent la juridiction européenne de
Strasbourg avec la Cour de justice des communautés européennes de Luxembourg.
Tel
n’a pas été le cas de l’affaire Selmouni c. France, qui a focalisé
pendant quelque temps l’attention des médias, et les circonstances de l’espèce
permettent aisément d’en comprendre les raisons : après la Turquie, la
France a été le deuxième pays, depuis l’entrée en vigueur de la Convention
européenne des droits de l’Homme, à faire l’objet d’une condamnation
pour "torture". Dans son arrêt rendu le 28 juillet 1999, la Cour a en
effet jugé que les sévices dont M. Selmouni se plaignait d’avoir fait
l’objet au cours d’une garde à vue dans les locaux d’un commissariat de
police, s’analysaient bien en actes de torture au sens de l’article 3 de la
Convention.
A
bien des égards cet arrêt est donc apparu comme un arrêt majeur. Outre le
fait que pour certains il illustre les dysfonctionnements de certains services
de la police nationale, il inaugure assurément une nouvelle interprétation,
par la Cour, des dispositions de l’article 3 de la Convention : je
rappellerai pour mémoire que les lésions relevées sur le corps de M. Selmouni
n'ont été évaluées qu'à cinq jours d’incapacité totale temporaire par
l’expert médical chargé de l’examiner, et que la Cour européenne n'a pas
contesté sur ce point l’appréciation des faits établie par la Cour
d’appel de Versailles. Dans leur arrêt, les juges de Strasbourg ont
d’ailleurs justifié leur décision en indiquant, je cite : "(...) le
niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’Homme
et des libertés fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement, une
plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux valeurs
fondamentales des sociétés démocratiques".
Mais
ce n’est pas de cet aspect là de l’arrêt Selmouni, celui relatif à
l’interprétation en l’espèce de l’article 3 de la Convention, que je
souhaite évoquer aujourd’hui devant vous, mais d’un autre aspect tout aussi
important, qui est celui de l’application qu’a faite la Cour de la règle de
l’épuisement des voies de recours internes.
Les
conditions d’application de cette règle, énoncées à l’actuel article 35
de la Convention, sont en effet fondamentales, car elles constituent l’une des
garanties essentielles du droit, pour un Etat, de se défendre devant la Cour.
En d’autres termes, on pourrait presque dire que les dispositions de
l’article 35 de la Convention sont aux Etats ce qu’est l’article 6 pour
toute personne, en lui assurant le droit à bénéficier d’un procès équitable
: en effet, et la Cour n’a pas manqué de le rappeler dans l’arrêt Selmouni
lui-même, le mécanisme de la Convention revêt un caractère subsidiaire par
rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’Homme, et c’est
pourquoi, je cite "la finalité de l’article 35 est de ménager aux Etats
contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées
contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la
Convention".
En
particulier, cette règle de l'épuisement des voies de recours internes est très
importante en matière judiciaire, où les principes conjugués de l'indépendance
de l'autorité judiciaire et de la présomption d'innocence empêchent l'Etat
français de se prononcer sur le caractère bien ou mal fondé de tout grief tiré
de la violation de la Convention, dès lors que les juridictions compétentes ne
se sont pas encore prononcées elles-mêmes. Je reviendrai ultérieurement sur
ce point essentiel.
A
la lecture de l’arrêt Selmouni, on peut se demander si le principe de
l'épuisement des voies de recours internes n’a pas été quelque peu malmené
pour permettre à la Cour de traiter de ce qui l’intéressait le plus dans
cette affaire, à savoir les allégations de mauvais traitements pendant une
garde à vue.
Que
s’est-il passé en l’espèce ? Je rappellerai très rapidement la
chronologie des faits :
-
M. Selmouni a été placé en garde à vue dans le cadre d'une affaire de trafic
de stupéfiants du 25 novembre 1991 à 20 heures 30, jusqu'au 29 novembre 1991
à 19 heures.
-
Lors de sa première comparution devant le juge d'instruction le 29 novembre,
immédiatement après la fin de sa garde à vue, il indiquait avoir été
victime de sévices pendant celle-ci, et le juge d'instruction désignait le
jour même un expert médical afin d'examiner dans les meilleurs délais le requérant.
Cette expertise avait lieu le 7 décembre suivant.
-
Parallèlement, une enquête préliminaire était diligentée par le parquet de
Bobigny, qui saisissait le 11 décembre 1991 la Direction de l'Inspection générale
des services de la Préfecture de Paris (IGS). Cette enquête était clôturée
par l'IGS le 30 avril 1992, mais au mois de novembre suivant, le parquet
sollicitait une enquête complémentaire et c'était alors l'Inspection générale
de la Police nationale qui était chargée, pour des raisons de compétence
territoriale, d'entendre M. Selmouni et son co-prévenu, M. Madi, l'un et
l'autre étant détenus au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis.
-
A la suite de l'exécution de cette enquête complémentaire, terminée le 1er décembre
1992, le parquet de Bobigny prenait le 22 février 1993 un réquisitoire
introductif contre X..., des chefs de coups et blessures volontaires avec arme
sur personne hors d'état de se protéger, et attentat à la pudeur.
-
Le 15 mars 1993, était enregistrée la plainte avec constitution de partie
civile de M. Selmouni qu'il avait déposée le 1er février.
-
Le juge d'instruction de Bobigny saisi de l'affaire agissait avec diligence,
entendait les policiers mis en cause et procédait notamment le 10 février 1994
à une parade d'identification au cours de laquelle M. Selmouni reconnaissait,
parmi les 10 policiers qui lui étaient présentés, les quatre fonctionnaires
qu'il accusait.
-
Sur le point de procéder à l'inculpation des quatre policiers, le juge
d'instruction sollicitait alors du ministère public, le 1er mars 1994, que soit
demandé un renvoi de l'affaire vers une autre juridiction dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice. Le 27 avril suivant, la chambre
criminelle de la Cour de cassation dessaisissait le juge d'instruction de
Bobigny au profit de celui de Versailles.
-
L'information était de nouveau ouverte le 21 juin 1994 par le procureur de la République
du tribunal de Versailles. Au cours de cette instruction les cinq policiers mis
en cause par MM. Selmouni et Madi étaient mis en examen au cours du premier
trimestre de l'année 1997. Ils étaient renvoyés devant le tribunal
correctionnel de Versailles le 21 octobre 1998.
-
L'audience devant le tribunal correctionnel de Versailles s'est tenue le 5 février
1999, et le 25 mars 1999, le tribunal déclarait les cinq policiers coupables
des faits qui leur étaient reprochés et les condamnait à des peines
d'emprisonnement ferme. Par ailleurs, il décernait un mandat de dépôt contre
M. Hervé.
-
Le 1er juilllet 1999, après des débats qui eurent lieu les 20 et 21 mai 1999,
la Cour d’appel de Versailles relaxait les policiers du chef d'attentat à la
pudeur, mais elle les condamnait pour coups et blessures volontaires. Elle
condamnait les policiers à des peines d'emprisonnement intégralement assorties
du sursis pour quatre d'entre eux. M. Hervé quant à lui était condamné à 18
mois d'emprisonnement dont 15 assortis du sursis, cette partie ferme
correspondant à la période de détention qu'il avait purgée à la suite du
jugement du tribunal correctionnel.
-
Les policiers ont formé un pourvoi en cassation, qui n'a pas encore été
examiné à ce jour par la Chambre criminelle.
Parallèlement
à cette procédure qui se déroulait devant les juridictions de l'ordre
interne, M. Selmouni a, vous le savez, déposé une requête devant la
Commission européenne des droits de l’Homme. Ce qu'il est d'ailleurs intéressant
de souligner, c'est que M. Selmouni a déposé cette requête dès le 28 décembre
1992, soit avant même qu'il ne dépose sa plainte avec constitution de partie
civile, et la Commission a en revanche "attendu" le 26 juin 1995 pour
la transmettre au gouvernement français. On peut déjà s'interroger sur les
raisons pour lesquelles la Commission n'a pas déclaré cette requête
manifestement irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes à
la date où elle l'a reçue.
Quoiqu'il
en soit, cette requête a prospéré et elle a fait l'objet d'un rapport de la
Commission en date du 11 décembre 1997, qui a conclu à l'unanimité à la
violation de l'article 3 de la Convention.
Le
3 décembre 1998, le gouvernement français adressait son mémoire écrit à la
Cour, et l'audience était fixée au 18 mars 1999. Cette date du 18 mars est
importante, car elle se situe pendant la période du délibéré du jugement du
tribunal correctionnel de Versailles. Dès lors, il était impossible pour le
gouvernement de présenter la moindre observation sur le bien-fondé du grief
tiré de la violation de l'article 3 de la Convention, sauf à porter atteinte
à la présomption d'innocence dont bénéficiaient les policiers.
S'il
était impossible au gouvernement français de présenter ses arguments au fond
sur les allégations de torture, il était en revanche parfaitement en mesure de
soulever l'irrecevabilité de ce grief, pour non-épuisement des voies de
recours internes, précisément en raison de l'existence de la procédure
pendante devant les juridictions nationales.
Il
est incontestable que la durée de cette procédure a été anormalement longue,
et le gouvernement français n'a jamais contesté devant la Cour l'existence
d'une violation sur le terrain de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Mais
il est tout aussi incontestable que cette procédure a néanmoins permis la
condamnation des policiers en première instance, puis devant la Cour d’appel,
même si un pourvoi en cassation est actuellement en cours d'examen. Si M.
Selmouni n'a pas obtenu, à la différence de l'autre partie civile, M. Madi,
des dommages-intérêts devant les juridictions nationales, c'est tout
simplement en raison d'un choix de son conseil, qui a préféré ne pas chiffrer
sa demande devant le tribunal correctionnel, et se réserver ainsi la faculté
de saisir ultérieurement les juridictions civiles, ce dont il lui a été
d'ailleurs donné acte.
L'affaire
Selmouni n'est pas la première affaire où la Cour européenne des
droits de l’Homme a dispensé une partie de l'obligation d'épuisement des
voies de recours internes. Toutefois, elle n'avait, jusqu'alors, admis la
recevabilité de telles requêtes qu'à titre exceptionnel, en raison de
l'existence de "circonstances particulières", pour reprendre
l'expression de la Cour.
C'est
ainsi que dans l'arrêt Akdivar c. Turquie du 16 septembre 1996, la Cour
avait considéré que l'un des éléments susceptibles de dispenser un requérant
d'épuiser les voies de recours internes était, je cite, "la passivité
totale des autorités nationales face à des allégations sérieuses selon
lesquelles des agents de l'Etat ont commis des fautes ou causé un préjudice,
par exemple lorsqu'elles n'ouvrent aucune enquête ou ne proposent aucune
aide".
En
l'occurrence, la situation qui prévalait au moment de la présentation de la
requête était une situation de graves troubles civils, rendant "vain
l'emploi de recours en justice". Quant à l'affaire Aksoy, qui
concernait également la Turquie, et où le requérant a également été
dispensé d'épuiser les voies de recours internes, la Cour avait stigmatisé,
je cite, "l'omission" par le procureur d'enquêter sur la nature, l'étendue
et la cause des blessures subies par le requérant, alors qu'en droit turc il
avait l'obligation de le faire.
Dans
l'affaire Selmouni, la Cour a été conduite à utiliser un autre critère,
puisque, de toute évidence, elle ne pouvait pas constater "la passivité
totale des autorités nationales face à des allégations sérieuses selon
lesquelles des agents de l'Etat ont commis des fautes ou causé un préjudice",
et elle reconnaît d'ailleurs dans l'arrêt que l'existence d'une enquête était
"avérée" au plan interne.
Il
fallait donc pour la Cour un nouveau critère susceptible de dispenser une
personne d'épuiser les voies de recours internes et elle l'a trouvé en considérant
en l'espèce que, je cite, "les autorités n'ont pas pris toutes les
mesures positives que les circonstances de la cause imposaient pour faire
aboutir le recours invoqué par le gouvernement". Elle en déduit que, je
cite encore, "le recours dont le requérant disposait n'était pas, en
l'espèce, normalement disponible et suffisant pour lui permettre d'obtenir réparation
des violations qu'il allègue".
Ce
critère appelle plusieurs remarques :
-Tout
d'abord, c'est un critère qui manque singulièrement de précision : en effet,
à partir de quand, de quel degré de négligence dans le fait de n'avoir pas
pris "toutes les mesures positives" que les circonstances de la cause
imposaient, un Etat ne sera plus autorisé à tenter de redresser la situation
dans son propre ordre juridique ?
-
Ensuite et surtout, au-delà du manque de précision de ce critère, c'est toute
la question du principe de subsidiarité qui régit la Cour qui est ici posée.
Lorsque la France a accepté la compétence des organes de la Convention pour
examiner les requêtes individuelles, elle n'entendait pas, de toute évidence,
substituer la compétence de la Cour européenne des droits de l'Homme à celle
de ses juridictions nationales.
Un
tel choix aurait porté atteinte au principe de souveraineté nationale et
aurait supposé une révision de notre Constitution sur ce point.
Je
voudrais sur ce point faire référence à une décision récente du Conseil
constitutionnel, rendue le 22 janvier 1999 sur le traité portant statut de la
Cour pénale internationale. Dans cette décision, le Conseil a été tout
naturellement amené à juger de la conformité de ce traité avec la
Constitution française, et en particulier avec le respect des conditions
d'exercice de la souveraineté nationale. Il a admis que la possibilité, pour
la future Cour, de se reconnaître compétente dans les cas de
"l'effondrement" ou de "l'indisponibilité" de l'appareil
judiciaire national ne méconnaissait pas les conditions essentielles d'exercice
de la souveraineté nationale. Mais, les expressions utilisées sont très
significatives à cet égard, il faut véritablement que le système national ne
soit plus en mesure de faire face à ses obligations juridictionnelles.
Or,
lorsqu'en l'espèce la Cour a entendu le gouvernement français dans sa
plaidoirie, soit le 18 mars 1999, il n'y avait alors aucune circonstance de
nature à faire craindre l'impossibilité pour les autorités judiciaires de
mener à bien leurs investigations et de juger les personnes mises en examen. Je
rappelle à cet égard que l'on se situait à cette époque dans l'attente
imminente du jugement du tribunal correctionnel de Versailles, après audience.
J'ajouterai
encore que dans son arrêt du 28 juillet 1999, la Cour ne s'est pas limitée à
l'examen de la procédure nationale jusqu'au jour de l'audience du 18 mars. En
effet, elle n'a pas hésité à faire référence expressément aux décisions
rendues ultérieurement par le tribunal correctionnel de Versailles, puis la
Cour d'appel, soit les 25 mars et 1er juillet 1999, sans d'ailleurs que
l'occasion ne fut donnée au gouvernement français de présenter ses
observations sur ces décisions.
-
Par cette observation, j'en arrive à ma dernière remarque : compte tenu en
France du principe de l'indépendance des autorités judiciaires vis-à-vis du
pouvoir exécutif, l'existence même d'une procédure pénale pendante au plan
interne a empêché le gouvernement français de porter toute appréciation sur
le caractère bien fondé du grief tiré de la violation de l'article 3 de la
Convention. La lecture de l'arrêt permet ainsi de constater la situation pour
le moins paradoxale dans laquelle s'est trouvé le gouvernement français :
D'un
côté, l'impossibilité pour lui de se défendre sur le fond et de présenter
ses observations sur les décisions rendues au plan interne puisqu'elles ont été
rendues postérieurement à l'audience devant la Cour de Strasbourg. De l'autre,
un arrêt qui considère fictivement que l'exigence relative à l'épuisement
des voies de recours internes a été satisfaite, et qui fonde sa décision sur
la réalité des faits allégués par le requérant en ayant notamment recours
aux décisions internes relatives aux mêmes faits...
Quelques
mots de conclusion
Finalement,
dans l'affaire Selmouni, la Cour a assimilé une procédure trop longue
à une absence totale de procédure.
On
peut éventuellement approuver en opportunité un tel raisonnement. On ne peut
que le regretter en droit. En effet, la Cour a ainsi créé une situation où
deux juridictions, l'une nationale et l'autre supranationale, ont été amenées
à juger de façon concurrentielle les mêmes faits, au même moment.
Indépendamment
de l'atteinte déjà mentionnée au principe de subsidiarité qui caractérise
le fonctionnement de la Cour, une telle situation ne témoigne pas à l'évidence
d'une bonne administration de la justice, et surtout elle viole le caractère équitable
de la procédure qui a opposé le requérant à l'Etat français, en privant en
partie celui-ci de la possibilité de présenter ses moyens de défense. En
effet, l'Etat ne pouvait pas contester la réalité des faits, ce qu'un
gouvernement fait en règle générale après une relaxe, et qui justifie
d'ailleurs le dépôt d'une requête devant la Cour européenne. Il ne pouvait
pas davantage contester la qualification des faits dénoncés par le requérant
en se référant à ceux établis par les juridictions du fond.
Les
dérogations à la règle de l'épuisement des voies de recours internes sont
aujourd'hui exceptionnelles, et elles doivent le rester, à moins de remettre
totalement en cause l'équilibre, qui résulte d'un accord conventionnel, entre
la compétence des juridictions nationales et celle de la Cour. En l'occurrence,
dans la présente affaire, la Cour ne s'est pas comportée comme un organe
subsidiaire mais comme un organe substitutif, selon des critères qu'elle s'est
elle-même forgée.
Débats
Jean-Paul
COSTA
Le
plaidoyer que nous venons d’entendre est un plaidoyer très brillant, mais il
ne m’a pas davantage convaincu que le premier plaidoyer du gouvernement français,
sinon j’aurais voté autrement. Avant que nous rediscutions de l’affaire
dans le débat général, je voudrais ajouter deux points à ce qui vient d’être
dit :
Mme
Dubrocard a choisi de ne parler que de la règle du non-épuisement des voies de
recours internes. Bien entendu j’attire l’attention, comme elle l’a fait
elle-même, sur le fait que l’arrêt Selmouni est très important du
point de vue de la qualification de torture. Il n’y a pas de doute, il y a
quelques années cette affaire, comme l’affaire Tomasi par exemple,
aurait donné lieu à une constatation de violation de l’article 3 par la Cour
uniquement sous le chef de traitement inhumain et dégradant. La Cour dans son
arrêt a décidé, délibérément, et elle s’en explique, d’élever le
standard. Elle cite d’ailleurs la Convention des Nations Unies sur la torture
et elle estime qu’il faut maintenant être de plus en plus vigilant et de plus
en plus sévère sur des agissements de ce type. Ceci mériterait à soi tout
seul un débat, voire un colloque, mais je comprends que Mme Dubrocard n’ait
pas pu parler de tout. C’est quand même une des dispositions importantes de
cette nouvelle jurisprudence de la Cour de Strasbourg.
Le
deuxième point, sans vouloir du tout répondre à ce stade à Mme Dubrocard :
je dirai simplement qu’à un certain degré de négligence, il a semblé à la
Cour, s’agissant d’allégations très graves, article 3, peut-être article
2 dans d’autres affaires, qu’une enquête trop lente s’apparente à une
absence d’enquête. Et je rappelle simplement la chronologie des faits. Les
faits se sont passés en 1991, Selmouni a porté plainte devant le juge
d’instruction immédiatement, il a été examiné par des médecins, il a
formellement porté plainte contre les policiers avec constitution de partie
civile le 1er février 1993. Il a fallu plus de 4 ans pour que ces policiers
soient mis en examen et plus de 5 ans pour que le tribunal correctionnel statue.
Il y a eu une accélération ensuite très forte puisqu’au contraire, il ne
s’est passé que 3 mois et quelques jours entre le jugement du tribunal
correctionnel et l’arrêt de la Cour d’appel. Je ne veux pas faire de
commentaires désagréables sur la justice de mon propre pays, mais en l’espèce
je crois qu’il y a eu des dysfonctionnements qui expliquent que l’entorse
faite par la Cour à la règle de non-épuisement des voies de recours internes
ne soit pas si exceptionnelle ni si incompréhensble.
Nous
avons entendu trois exposés très riches et très intéressants sur des
affaires extrêmement différentes, ce qui montre la variété de
l’intervention des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme, en
ce qui concerne la France, comme pour d’autres pays.
Antoine
BUCHET
Sur
l’affaire Selmouni, je voudrais faire une remarque et poser une
question.
Ma
remarque consiste à insister sur la situation paradoxale dans laquelle se
trouvait le gouvernement, qui ne pouvait pas se défendre sur le fond de
l’affaire, et qui ne pouvait pas non plus intervenir au plan interne pour accélérer
le traitement de ce dossier, dans la mesure où toute intervention dans des
dossiers individuels est désormais prohibée. C’est pourquoi le gouvernement
a très justement tenu à faire valoir la règle du non-épuisement des voies de
recours internes.
Autre
paradoxe que Michèle Dubrocard a souligné tout à l’heure : l’avocat de M.
Selmouni n’a réclamé aucun dommage et intérêt devant le tribunal
correctionnel et la Cour d’appel de Versailles. Nous n’étions pas très
loin, dès lors, de l’arrêt Hamer c. France, rendu en août 1996 :
faute pour le requérant d’avoir fait valoir son droit à indemnisation devant
les juridictions internes, n’était-on pas en présence d’une incompatibilité
ratione materiae avec l’article 6 de la Convention ? La réponse
à cette question n’est pas évidente, mais le moins que l’on puisse dire
est que, dans cette affaire, la Cour de Strasbourg a bel et bien pris la place
des juridictions internes pour constater les mauvais traitements en garde à
vue, alors que les policiers venaient d’être condamnés par la Cour
d’appel, puis pour allouer au requérant des dommages et intérêts, alors
qu’il n’en n’avait pas demandés devant les juridictions nationales.
Ma
question s’adresse à M. Costa. Je voudrais lui demander si l’on n’assiste
pas à la création de régimes spéciaux sur la règle du non-épuisement des
voies de recours internes, notamment pour l’article 3. Finalement, on peut se
demander si cette règle se module selon les griefs soulevés, sachant, autre
paradoxe de cette affaire, que finalement la décision des juridictions internes
a été jugée beaucoup trop sévère par les services de police en France. Tout
le monde nous a “ tiré ” dessus dans cette affaire, la Cour européenne
en nous disant qu’on n’avait rien fait, et les policiers en nous disant vous
en avez fait trop...
Jean-Paul
COSTA
En
ce qui concerne d’abord les policiers, je voudrais dissiper un malentendu. La
Cour a dit, et je crois qu’elle a raison de le dire, qu’à la limite, même
s’il y avait relaxe des policiers (imaginons que la Cour de cassation casse
l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles et que la Cour d’appel de renvoi
les relaxe), il n’en reste pas moins que la responsabilité internationale de
l’Etat français serait engagée car il y a un principe clair qui a été réaffirmé
par la Cour, qui est que lorsque quelqu’un entre en bonne santé dans un
commissariat de police pour une garde à vue, et quand il en sort “ amoché ”,
c’est à l’Etat qu’il appartient de prouver qu’il ne s’est pas
automutilé ou que ce n’est pas une dégradation de son état de santé
naturel qui a provoqué ce fait. On oublie souvent que la Cour européenne
n’est pas une juridiction pénale, ni nationale ni internationale, et que le
litige n’est pas entre Selmouni et les policiers, mais qu’il est entre
Selmouni et un Etat qui a la responsabilité de veiller à ce que même des
grands criminels, condamnés à 18 ans d’emprisonnement comme c’est le cas
de Selmouni, aient droit à un traitement humain et non dégradant.
En
ce qui concerne le principe de subsidiarité, je trouve que la remarque de Mme
Dubrocard est extrêmement juste et intelligente, à savoir que dans cette
affaire, pour la règle du non-épuisement des voies de recours internes, la
Cour européenne des droits de l’Homme a été plus sévère sur l’appréciation
de l’effectivité des voies de recours internes, et que le résultat est
qu’il y a un affaiblissement du principe de subsidiarité. Je voudrais faire
deux remarques sur ce point. D’une part, sur le problème du non-épuisement
en général, la Cour a écrit à la fin du paragraphe 75 de son arrêt : “ selon
les principes du droit international généralement reconnus, certaines
circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation
d’épuiser les recours internes qui s’offrent à lui (voir l’arrêt de la
Cour de Strasbourg Van Osten c. Belgique du 6 novembre 1980) ”.
Comme l’a dit Mme Dubrocard, l’arrêt Selmouni n’est pas innnovant
à cet égard. Sur le principe de subsidiarité, elle a touché encore une fois
de façon très perspicace un problème et la question d’Antoine Buchet le
repose tout à fait : est-ce que, lorsqu’il s’agit des articles 2 ou 3,
c’est-à-dire d’atteintes aux droits de l’Homme les plus fondamentaux (le
droit à la vie, le droit à ne pas être enlevé, à ne pas être torturé,
etc.), la Cour a raison d’être un peu plus laxiste à l’égard du principe
de subsidiarité, et un peu plus sévère quant à l’effectivité des voies de
recours internes ? Ma réponse est oui. Le principe de subsidiarité ne peut pas
s’appliquer de façon identique lorsqu’il s’agit de simples droits
processuels, par exemple l’article 6 § 1 en matière civile, ou quand il
s’agit de droits absolument intangibles et non dérogeables. Dans ce dernier
cas, il faut être particulièrement sévère parce que sinon il serait trop
facile pour un Etat de laisser traîner les mesures internes et de dire on n’a
pas épuisé les voies de recours internes, donc la requête est irrecevable.
Je
vais prendre un exemple qui concerne la Turquie. En matière d’article 2,
c’est-à-dire de disparitions, il est déjà arrivé à la Cour de Strasbourg
de dire : on ne peut pas condamner la Turquie pour violation de l’article
2 parce qu’on ne sait pas si la personne est morte ou pas. En revanche, cette
personne a disparu, il y a un faisceau d’éléments qui permettent à sa
famille de penser qu’elle est disparue dans des conditions telles qu’elles
engagent la responsabilité de l’Etat défendeur. Or l’Etat défendeur, soit
n’a pas fait d’enquête, soit a fait une enquête tellement lente ou
tellement peu diligente, qu’on n’arrive pas à le savoir, et d’ailleurs la
Commission européenne des droits de l’Homme a fait plusieurs fois des enquêtes
sur place pour essayer de savoir ce qu’il en était.
Autrement
dit, je réponds en effet nettement à la question d’Antoine Buchet. Je crois
que le principe de subsidiarité doit être modulable suivant l’intangibilité,
l’indérogeabilité, et la gravité des droits de l’Homme invoqués. Ceci
n’engage que moi, mais je pense que c’est au coeur du raisonnement de
l’arrêt Selmouni.
Auguste
TILLET (avocat général près la Cour d’appel de Paris)
Je
voudrais féliciter Mme Dubrocard pour le réquisitoire qu’elle vient de
prononcer.
Vous
disiez tout à l’heure M. le Juge que la Cour n’avait pas innové dans
l’affaire Selmouni. Il me semble cependant, que pour dispenser un requérant
de l’obligation de non-épuisement des voies de recours en matière d’allégation
de torture, la Cour avait retenu dans un arrêt rendu à l’encontre de la
Turquie, à titre de “ circonstances particulières ”, outre la
gravité des faits allégués, une pratique administrative constante consistant
en la répétition d’actes interdits par la Convention, et la tolérance de
ces faits par les autorités nationales. Or dans l’affaire Selmouni, si
les faits sont d’une incontestable gravité, il n’y a eu ni répétition des
actes dont il s’agit, ni tolérance de la part des autorités.
Il
est permis de se demander si la Cour, lorsqu’elle sera saisie de faits d’une
particulière gravité, même quand ils auront donné lieu à des poursuites
judiciaires, n’aura pas tendance dorénavant à considérer que les autorités
n’ont pas fait preuve d’une diligence suffisante et que le recours dont
disposait le requérant n’était pas, en conséquence, normalement disponible
et suffisant pour lui permettre d’obtenir réparation.
Jean-Paul
COSTA
Vous
posez une double question pertinente et très importante. Sur le premier point,
je ne suis pas d’accord avec vous. Jamais la Cour européenne des droits de
l’Homme n’a dit que pour qu’il y ait condamnation pour torture, pour
traitements inhumains et dégradants, il fallait qu’il y ait une pratique.
D’ailleurs, à mon avis, l’arrêt Selmouni c. France est un arrêt
tout à fait isolé. Il s’agit d’une bavure qui, malheureusement, touche
notre pays. Il y avait eu un Etat condamné, mais à deux reprises différentes,
dans deux affaires différentes, pour des faits de torture, Michèle Dubrocard
l’a dit, c’est la Turquie. Il aurait pu se faire que ce soit l’Italie,
l’Allemagne, la Suisse ou la Grande-Bretagne. Le hasard des choses et des requêtes
à Strasbourg a fait que c’était la France, et je ne m’en réjouis pas. Ce
n’est pas très agréable d’être juge élu au titre de la France dans une
affaire pareille. Mais encore une fois, ce n’est pas une question de pratiques
administratives, et jamais personne à la Cour n’a imaginé ni qu’il
s’agit de faits répétitifs, ni que les autorités françaises, et notamment
les autorités judiciaires, ne sont pas à même de réparer ce type
d’agissements.
Sur
le second point, je répète ce que j’ai dit, à savoir qu’il faut être
particulièrement sévère à l’égard de la règle du non-épuisement dans ce
genre d’affaires. Il faut l’être d’autant plus qu’il y a un autre
aspect que je n’ai pas indiqué, c’est que la notion de torture au sens de
la Convention européenne des droits de l’Homme, et d’ailleurs au sens de la
Convention des Nations Unies contre la torture, est assez autonome. Le nouveau
Code pénal en France parle de torture, mais dans un contexte bien différent.
Les actes de torture ou de barbarie peuvent être punis par des peines de 15 ans
d’emprisonnement, etc. Si on s’en tient à l’arrêt de la Cour d’appel
de Versailles, ce qu’il y a de tout à fait étonnant, c’est que les peines
infligées aux policiers sont très mineures, mais que les considérants de la
Cour d’appel sont accablants... On peut dire que d’une certaine façon, dans
le cas des motifs et des peines, on se trouve face à des coups et blessures
ayant entraîné quelques jours d’incapacité temporaire de travail, alors que
les considérants de la Cour d’appel sont des considérants qui pourraient
tout à fait justifier une punition de torture, même au sens du nouveau Code pénal.
La
Cour de Strasbourg, à mon avis évidemment, ne cherche pas à se substituer aux
autorités judiciaires des Etats, sauf s’il s’agissait d’Etats gravement défaillants,
et je ne pense pas que la France soit la Tchétchénie. En même temps, la
notion de torture étant une notion autonome, et surtout la Cour ayant décidé,
à tort ou à raison, dans l’affaire Selmouni d’élever le seuil, il
faut par conséquent être particulièrement vigilant à l’égard de ce type
d’accusations.
Pour
terminer avec cette affaire, et justement sur la qualification de torture, je
vais donner un exemple très simple qui a d’ailleurs déjà été souligné
par certains commentateurs de l’arrêt Selmouni. Dans l’affaire interétatique,
Irlande c. Royaume-Uni, qui a donné lieu à un arrêt de la Cour en
1978, le Royaume Uni a été condamné pour traitements inhumains et dégradants,
alors que ce qui ressort du dossier et de l’arrêt de la Cour de l’époque,
était beaucoup plus grave et beaucoup plus répété encore que dans
l’affaire Selmouni. Autrement dit, si on rejugeait cette affaire
notamment, il est probable que les violations de l’article 3 constatées en
1978 seraient qualifiées de faits de torture et non plus de traitements
inhumains et dégradants.
Michèle
DUBROCARD
Je
voudrais intervenir par rapport à ce que vous avez indiqué sur l’aspect
modulable du principe de subsidiarité. Si on admet la comparaison que j’ai
faite toute à l’heure entre, d’une part, l’Etat et l’article 35 de la
Convention, et, d’autre part, les individus et l’article 6 de la Convention,
le droit à un procès équitable est assuré à l’individu quelle que soit la
gravité des faits qu’on lui reproche, et je dirai encore mieux, plus les
faits qu’on lui reproche sont graves et plus il est assuré de garanties
importantes pour pouvoir défendre sa cause devant les juridictions. Si on
transpose ce principe pour les Etats, plus le grief opposé à l’Etat est
grave, plus l’Etat doit être en mesure d’assurer sa défense... et précisément
la règle de l’épuisement des voies de recours internes (article 35), c’est
la règle fondamentale qui permet à un Etat de redresser les violations qui lui
sont reprochées par le requérant. Je comprends bien l’intention qui anime
les juges de la Cour, mais je trouve dangereux d’accepter le caractère
modulable d’une règle de nature processuelle qui a pour but d’assurer l’équité
d’un procès. Quand on est devant la Cour européenne des droits de l’Homme,
on est dans le cadre d’un procès entre deux parties, d’un côté un
individu, et de l’autre, l’Etat. Je suis tout de même gênée de voir
qu’une règle processuelle puisse être examinée de manière “ souple ”.
Jean-Paul
COSTA
Je
ne suis pas convaincu. Je vais prendre un exemple. Dans l’affaire Selmouni,
personne n’a contesté que la durée de la procédure était déraisonnable au
sens de l’article 6 § 1. Suivant la gravité des atteintes autres aux droits
de l’Homme qui peuvent être constatées, la durée de la procédure peut
avoir des conséquences très différentes. Il y a de nombreux procès dans
lesquels la Cour européenne des droits de l’Homme, depuis des décennies,
constate une violation de l’article 6 pour dépassement du délai raisonnable,
mais finalement ce n’est pas très grave. Il arrive même qu’au titre de
l’article 41, la Cour dise que la constatation de la violation suffit à
assurer la réparation du préjudice moral allégué par le requérant. En
revanche, quand il s’agit d’atteintes graves aux droits de l’Homme, la durée
de la procédure doit être appréciée de façon très sévère. C’est
tellement vrai, d’ailleurs, que l’article L-780-1 du Code de
l’organisation judiciaire dit que la lenteur de la justice équivaut, ou est
assimilée, à un déni de justice. Le gouvernement français invoque souvent
cette disposition devant la Cour pour dire que nous avons en France un mécanisme
d’indemnisation du délai raisonnable qui ne justifie pas la recevabilité des
requêtes devant la Cour de Strasbourg, et peut-être un jour un tel
raisonnement sera accepté par la Cour. A mon avis, plus l’atteinte aux droits
de l’Homme est grave, plus le risque de déni de justice est grave, compte
tenu de la longueur de la procédure. Autrement dit, si dans cette affaire, le
juge d’instruction, et ensuite les mécanismes judiciaires et juridictionnels
avaient été rapides, je suis persuadé, mais je ne peux pas le démontrer,
qu’on aurait dit qu’il y avait non-épuisement des voies de recours
internes. C’est vraiment l’écoulement du temps qui fait que trop, c’est
trop...
Paul
TAVERNIER
J’aurais
pu parler sur les trois arrêts qui viennent d’être commentés car ils
suscitent tous les trois la discussion, mais je ne dirai rien sur l’affaire Chassagnou
puisque M. Fromageau est parti, ni sur l’affaire Zielinski & Pradal que
j’ai commentée par ailleurs dans les Mélanges en l’honneur du Professeur Gérard
Conac. Par contre, j’ai été très intéressé par l’intervention de Mme
Dubrocard. Je savais dans quel sens elle allait parler de cet arrêt,
puisqu’on en avait discuté au téléphone. Je dois dire que j’avais été
très surpris par la manière dont elle avait perçu l’affaire Selmouni.
Finalement,
Mme Dubrocard nous a présenté un plaidoyer intéressant, mais pour ma part je
suis plus proche des analyses de Jean-Paul Costa. Je ne me prononcerai toutefois
pas sur le fond car je suis dans une position difficile : je ne connais pas le
dossier et je suis en face de deux personnes qui le connaissent de l’intérieur.
Je peux tout de même me permettre de faire quelques remarques d’un huron se
trouvant ni au Palais Royal ni à la Cour de Strasbourg, mais simplement à la
Faculté Jean Monnet à Sceaux. En ce qui concerne la présentation qui a été
faite de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, je suis
tout à fait d’accord sur la modulation de la règle, et mon intervention ne
porte pas sur ce sujet, mais sur le glissement que Michèle Dubrocard opère
dans l’application de la règle.
En
effet, elle transforme cette règle, qui est une règle traditionnelle du droit
international public. Jean-Paul Costa l’a rappelé, la Cour s’est fondée
sur un principe de droit international public, ce qui est assez rare, mais la
Convention s’y réfère expressément, c’est un vieux principe. J’ai
commencé à m’intéresser à la Convention européenne des droits de l’Homme
grâce au professeur Pinto alors que j’étais étudiant en licence en droit. A
ce moment là, la France n’avait pas ratifié la Convention. Il n’y avait
pas d’affaires françaises ; il y avait à peine quelques affaires qui
commençaient à venir devant la Cour. La seule jurisprudence qui existait était
celle de la Commission. Normalement, dans le système initial, c’était la
Commission qui devait trancher les problèmes d’épuisement des voies de
recours. Donc il y a eu une dérive, c’est certain. Ce genre de problèmes
n’auraient jamais dû aller une deuxième fois devant la Cour. Je ne veux pas
intervenir là-dessus car cela nous entraînerait trop loin. J’espère
qu’avec la nouvelle Cour, la question ne se reposera plus dans les mêmes
termes étant donné la réforme du Protocole n° 11.
Michèle
Dubrocard réalise un glissement tout à fait curieux dans son raisonnement :
elle déplace le problème. Elle nous dit, comme Jean-Paul Costa l’a relevé :
il y a un procès entre la France et les requérants, et donc la France, ou le
gouvernement quel qu’il soit, a droit à un procès équitable. Le problème
ne se pose pas dans ces termes. La règle de l’épuisement des voies de
recours n’a pas cette finalité, c’est uniquement un principe de subsidiarité,
et pour ceci, je suis d’accord. Ce dernier existait bien avant Maastricht car
il s’agit d’un principe de droit international général, qui n’est pas
propre au droit communautaire. Michèle Dubrocard pose le problème sur un autre
terrain. C’est de bonne guerre... Mais je ne suis pas du tout d’accord. Je
pense au mauvais exemple donné aux nouveaux Etats (à la Russie, à la Slovénie,
bientôt à Monaco, ou à d’autres Etats) : ils pourront invoquer cette
argumentation, et la Cour risque d’être confrontée à des difficultés si la
France est suivie dans ce domaine.
J’ajoute
un dernier élément. Certes, je n’ai pas vu le dossier, mais il me semble
qu’il y a eu un certain nombre de pressions de la part des syndicats de
policiers dans cette affaire. Il y a même eu des grèves, on en a parlé dans
la presse..., et d’autre part, on a vu que la procédure n’a commencé à
avancer sur le plan interne, qu’à partir du moment où l’affaire est allée
à Strasbourg. Je ne peux pas me prononcer définitivement, mais ce sont des éléments
qu’il faut prendre en considération.
Michèle
DUBROCARD
Si
j’ai bien compris ce que vous avez dit en ce qui concerne le déroulement de
la procédure, je crois que beaucoup de personnes font ce constat, qui me paraît
erroné, sur le fait que la procédure a commencé à démarrer véritablement
à partir du moment où les organes de Strasbourg ont été saisis. Une fois
encore, qu’on ne se méprenne pas sur mes propos, cette procédure, je l’ai
dit, est longue, anormalement longue, elle a été longue de manière
inacceptable.
Quant
à la sévérité de la décision par rapport à l’article 6, je pense
qu’elle est tout à fait justifiée. La condamnation de la France est
amplement méritée, et elle aurait pu justifier certainement l’octroi, sur le
seul fondement de l’article 6, d’une somme très importante. Nous sommes
complètement d’accord sur ce point.
Mais
quand on regarde cette procédure, on s’aperçoit qu’au tout début elle a
été menée avec beaucoup de diligence. Le problème, lorsqu’on regarde la
chronologie des faits, c’est qu’à partir du moment où cette affaire a été
“ dépaysée ”, où elle est arrivée à Versailles, on a constaté
des lenteurs...
Paul
TAVERNIER
Pourquoi
? Il y avait probablement des pressions extérieures...
Michèle
DUBROCARD
Par
rapport à ce que vous indiquiez, ce n’est pas à partir du moment où
l’affaire est arrivée à Strasbourg qu’elle a commencé à être traitée,
bien au contraire. L’affaire est arrivée à Strasbourg en 1992. Elle a été
transmise aux autorités françaises en 1995 et l’accélération que l’on
connaît n’est intervenue qu’en 1998 et 1999.
Par
ailleurs, concernant la règle de l’épuisement des voies de recours internes,
il faut bien mesurer cette règle à l’aune de l’indépendance de
l’autorité judiciaire en France, qui fait que tant qu’une procédure
interne est en cours, le gouvernement ne peut rien dire sur le contenu de la
procédure judiciaire en matière pénale. A ce moment là, on arrive bel et
bien à une situation où par le jeu de la règle de l’épuisement des voies
de recours internes, le gouvernement, comme ce fut le cas dans l’affaire Selmouni,
n’a pas été en mesure de se défendre sur le fond du grief.
Paul
TAVERNIER
J’ajouterai
tout de même que la règle de l’épuisement des voies de recours internes est
une règle de droit international, il ne faut pas l’oublier, et donc que les
instances nationales n’aient pas pu intervenir en raison de l’indépendance
du juge, cela n’a aucune incidence sur le plan international et sur la
responsabilité internationale.
Jean-Paul
COSTA
Avant
de passer aux exposés suivants, j’aimerais savoir s’il n’y a pas de
remarques sur la très intéressante affaire Zielinski et Pradal et le
rapport de Me Delaporte.
S’il
n’y en a pas, c’est, il faut le croire, soit qu’il y a épuisement des
voies de recours oratoires de la salle, soit tout simplement que Me Delaporte a
fait un exposé extrêmement exhaustif, ce que je crois, et je le remercie
encore ainsi que Mme Dubrocard.
On
va reparler de l’épuisement des voies de recours internes avec Olivier
Bachelet, mais dans un contexte différent. Les deux exposés se situent dans le
contexte de la détention provisoire, critiquée par les requérants sous
l’angle de la durée, mais le premier exposé va surtout se centrer autour du
point de savoir si le recours en cassation constitue une voie de recours
interne.
|