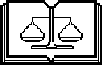|
La
détention provisoire mise en examen
•
Le recours en cassation et le non-épuisement
des
voies de recours internes
l’affaire
Civet (arrêt du 28 septembre 1999)
par
Olivier
BACHELET
Allocataire
de recherche à l’Université de Paris I
De
manière traditionnelle, le principe de souveraineté des Etats reconnu par le
droit international public constitue le fondement de la règle de l’épuisement
des recours internes.
Ainsi, toute action internationale en responsabilité d’un Etat, exerçant
sa protection diplomatique au profit d’un de ses nationaux devant une
juridiction internationale, n’est recevable que si toutes les voies de
recours internes de l’Etat défendeur susceptibles de mener à la réparation
du grief allégué ont été préalablement épuisées. En d’autres termes,
l’application d’un tel principe de subsidiarité doit permettre à l’Etat
mis en cause de redresser par lui-même la situation, à condition que ses
voies de recours internes soient adéquates, accessibles et efficaces.
C’est
dans cette perspective qu’a été établie la règle de l’ancien article
26 de la Convention européenne des droits de l’Homme, devenu l’article
35-1 suite à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11. En effet, si la
Convention est un instrument de droit international, elle est avant tout
destinée à s’appliquer au sein des ordres juridiques nationaux afin de
garantir et sanctionner efficacement les droits fondamentaux qu’elle protège.
La Cour de Strasbourg ne doit donc intervenir qu’en dernier ressort, s’il
est effectivement et définitivement constaté une défaillance de l’Etat
mis en cause menant à une violation caractérisée de la Convention. Le
corollaire de cette règle exige donc que l’Etat défendeur offre au requérant
un moyen de redresser une situation contraire à la Convention en lui
accordant un droit de recours effectif conformément à l’article 13 de la
Convention.
L’arrêt
Civet c. France, rendu le 28 septembre 1999 par la grande chambre de la
Cour européenne des droits de l’Homme, porte précisément sur cette notion
de recours internes effectifs et sur les conditions qui y sont attachées. En
l’espèce, le requérant avait été inculpé du chef de viols sur mineures
par ascendant légitime et placé en détention provisoire le 7 octobre 1993.
Il présenta plusieurs demandes de mise en liberté qui firent toutes
l’objet d’ordonnances de rejet de la part du juge d’instruction, confirmées
par la chambre d’accusation. Le requérant ne forma qu’un seul pourvoi en
cassation, à l’encontre de ces arrêts de la chambre d’accusation, qui
fut déclaré déchu en l’absence de dépôt dans les délais légaux d’un
mémoire exposant son argumentation. Finalement, il fut déclaré coupable des
faits reprochés le 27 juin 1996.
Le
requérant saisit alors les organes de Strasbourg sur le fondement de
l’article 5 § 3 de la Convention afin qu’ils constatent le caractère
excessif de la durée de sa détention provisoire et lui alloue une
satisfaction équitable. Toutefois, le gouvernement français opposa à cette
demande l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, fondée
sur l’article 35-1 de la Convention, au motif que le pourvoi en cassation
aurait dû être tenté en matière de détention provisoire à l’encontre
de chaque arrêt rendu par la chambre d’accusation.
Dans
sa décision, la Cour rappelle, tout d’abord, que la finalité de la règle
posée par l’article 35-1 est de ménager aux Etats contractants “ l’occasion
de prévenir et de redresser ” d’éventuelles violations de la
Convention. Elle précise, en outre, que ne sont concernés par cette règle
que les recours internes “ disponibles et adéquats ” et qu’il
appartient à l’Etat défendeur de démontrer ces caractères d’effectivité
et d’accessibilité. Dans cette mesure, la Cour indique que le pourvoi en
cassation fait, en principe, partie des voies de recours à épuiser. Or, elle
relève que le requérant n’a pas soulevé le moyen tiré de l’article 5
§ 3 de la Convention dans le cadre d’un pourvoi régulier (§ 41). Elle
ajoute que, même si la Cour de cassation – juge du droit – est liée par
l’appréciation souveraine de la chambre d’accusation, le pourvoi permet
de contrôler la motivation effective du maintien en détention au regard des
faits de l’espèce. Dans le cas contraire, la Cour relève, en citant
plusieurs arrêts de la Haute juridiction française, que la décision attaquée
encourt la cassation. Ainsi, elle considère que le pourvoi en cassation est
un recours permettant, à partir d’un examen de la procédure, de
s’assurer du respect de l’article 5 § 3 et admet l’exception de non-épuisement
des voies de recours internes présentée par le gouvernement français.
Comme
le notent plusieurs juges
dans leur opinion dissidente commune jointe à l’arrêt, cette décision
apparaît contestable au regard de plusieurs arguments qui peuvent être, tour
à tour, pris en considération.
I.
Tout d’abord, se pose le problème de la nature juridique du pourvoi en
cassation qui conditionne nécessairement son caractère de recours à épuiser,
ou non, au regard de l’article 35-1 de la Convention. En effet, dans le
droit de la Convention, comme en droit international public général,
l’expression “ voie de recours ” désigne “ toute voie
de droit susceptible d’aboutir à un résultat satisfaisant au regard (…)
de la violation alléguée ”.
Toutefois, la règle n’exige en principe que l’exercice de recours
ordinaires mais non de recours extraordinaires. Or, nous le savons, le pourvoi
en cassation constitue bien une voie de recours extraordinaire en droit
interne français puisqu’il n’est pas suspensif d’exécution et ne peut
être formé que pour des causes limitativement déterminées.
Néanmoins,
au regard de la jurisprudence des organes de Strasbourg, la notion de “ voie
de recours extraordinaire ” revêt une signification particulière et
autonome renvoyant aux voies de recours exceptionnelles, telles que l’action
en réhabilitation
ou le recours en révision.
De manière générale, la Commission considère que ne “ constitue pas
normalement une voie de recours devant nécessairement être épuisée ”
toute action judiciaire engagée pour la réouverture d’une instance close
par une décision rendue en dernier ressort. Dès lors, le pourvoi en
cassation, qui constitue le dernier recours juridictionnel avant qu’une décision
judiciaire ne soit considérée comme définitive, semble devoir être épuisé
au regard de l’article 35-1 de la Convention comme l’indique clairement
notre arrêt,
à condition qu’il soit utile et adéquat.
II.
Apparaît donc, ici, le second argument venant mettre en cause la solution
dégagée par la Cour de Strasbourg. En l’espèce, le pourvoi en cassation
était-il réellement utile pour le requérant ? Selon un auteur, “ les
recours inutiles sont ceux qui devraient être portés devant une juridiction
dont la jurisprudence bien établie ne laisse entrevoir aucune chance de succès ”.
Or, selon la Cour de Strasbourg, un pourvoi en cassation formé à
l’encontre d’une décision rejetant une demande de mise en liberté avait
toutes les chances de prospérer en droit interne français. Pour illustrer
son propos, elle cite longuement plusieurs extraits d’arrêts de cassation
de la Chambre criminelle allant en ce sens (§§ 31, 32 et 33).
Toutefois,
il est intéressant de souligner le motif récurrent de ces décisions qui se
fonde sur l’absence de réponse par la chambre d’accusation aux
argumentations du mémoire présenté devant elle invoquant la violation de
l’article 5 § 3 de la Convention. En effet, dans tous ces arrêts, la Cour
de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir motivé clairement
leur décision de maintien en détention provisoire, mais ne se prononce pas
pour autant sur la durée même de cette détention. Dans notre affaire, un
pourvoi éventuel formé par le requérant aurait donc eu une chance de succès
sur le terrain de la motivation des décisions rendues par la Chambre
d’accusation. Dans cette mesure, la présente solution est parfaitement
compréhensible puisque la Cour et la Commission estiment qu’en cas de doute
sur l’issue d’un recours celui-ci doit être exploré.
Toutefois,
comme nous venons de l’esquisser, une difficulté provient du fait que la
violation de la Convention alléguée par le requérant ne porte pas sur la
motivation des décisions, mais bien sur la durée excessive de sa détention.
Or, dans les arrêts cités, la Cour de cassation ne se prononce pas expressément
à ce sujet, ce qui mène à s’interroger sur l’adéquation d’un éventuel
pourvoi formé devant elle en la matière.
III.
En effet, nous savons que la Cour de cassation française statue en droit et
ne s’intéresse pas aux faits qui demeurent de la compétence des juges du
fond. Bien entendu, comme le note la Cour européenne, cette distinction entre
les “ faits ” et le “ droit ” ne doit pas être
entendue artificiellement dans la mesure où la Cour de cassation vérifie également
“ l’adéquation entre, d’une part, les faits établis par les juges
du fond et, d’autre part, la conclusion à laquelle ces derniers ont abouti
sur le fondement de ces constatations. ” (§ 43). C’est précisément
cette règle que viennent illustrer les arrêts cités par la Cour de
Strasbourg.
Néanmoins,
comme le notent certains juges dans leur opinion dissidente commune jointe à
l’arrêt, la Cour de cassation ne peut aller au-delà de ce contrôle de la
motivation dans la mesure où l’opportunité d’un maintien en détention
provisoire relève de l’ “ appréciation souveraine des juges du fond ”.
La Cour avait, d’ailleurs, déjà établi dans l’affaire Muller c.
France (arrêt du 17 mars 1997) que la question du caractère raisonnable
ou non de la durée d’une détention provisoire est une question de fait échappant
à la compétence de la Cour de cassation (§ 28).
Cette constatation est, de plus, reprise par la Commission qui, en formation
plénière, a conclu unanimement à la recevabilité de la requête.
En effet, contrairement à une de ces anciennes décisions,
la Commission souligne ici que “ la Cour de cassation considère que le
moyen tiré de l’article 5 § 3 de la Convention est soit un moyen de fait,
soit un moyen mélangé de fait et de droit ”
et “ qu’il échappe à sa compétence, ce point relevant de l’appréciation
souveraine des juges du fond ”.
En outre, afin d’étayer son argumentation, la Commission cite plusieurs
auteurs français allant dans le même sens.
Ainsi,
un pourvoi en cassation fondé sur la violation de l’article 5 § 3 de la
Convention ne semble pas adéquat puisqu’il ne permet pas de statuer sur la
matière même du grief allégué. Il s’agit, en effet, d’une voie de
recours ne permettant de remédier que de manière incidente à une violation
de la disposition en cause, à condition que la motivation des juges du fond
soit défaillante. Or, dans une situation similaire, la Cour européenne
elle-même avait considéré que le requérant ne mettant en cause, devant la
Cour de cassation, que l’insuffisance de la motivation d’un arrêt de la
Cour d’appel, sans invoquer directement la disposition de la Convention dont
la violation était alléguée, ne satisfaisait pas aux exigences de
l’ancien article 26, en particulier celle d’un recours exercé “ en
substance ”.
Le même raisonnement aurait pu s’appliquer ici dans la mesure où il semble
bien qu’en cas de contestation devant la Cour de cassation d’une durée de
détention provisoire, celle-ci ne puisse prospérer qu’en droit, au regard
de la seule motivation des juges du fond, et non en fait, à l’aune du “ délai
raisonnable ” prévu par l’article 5 § 3 de la Convention et
pourtant invoqué en substance. D’ailleurs la Commission reprend cette
argumentation en relevant que “ le requérant ne se plaint pas d’une
absence de réponse à ses conclusions, ni d’un non-respect des formalités
légales prévues à peine de nullité ou d’une erreur de droit dans
l’interprétation et l’application des dispositions du Code de procédure
pénale. Il invoque purement et simplement l’article 5 § 3 de la Convention
en contestant l’appréciation souveraine de la chambre d’accusation. Dès
lors, (…), le pourvoi en cassation n’était pas de nature à lui permettre
d’obtenir réparation de la violation qu’il allègue.”.
Le
pourvoi en cassation fondé sur une durée de détention provisoire excessive
“ en soi ” apparaît donc inefficace, puisqu’il se heurte à
l’ “ appréciation souveraine des juges du fond ” échappant
au contrôle de la Cour de cassation, et inadéquat dans la mesure où il ne
permet pas de constater une violation directe de l’article 5 § 3 de la
Convention. En la matière, le pourvoi en cassation semble, ainsi, ne pas
pouvoir être considéré comme une voie de recours à épuiser avant de
saisir les organes de Strasbourg.
Dans
cet arrêt, la Cour paraît donc avoir malencontreusement assimilé les effets
d’un recours portant exclusivement sur le droit, mais pouvant avoir –
s’il aboutit – des conséquences en fait, et ceux d’un recours portant
sur des éléments purement factuels. Cette solution est donc à déplorer
d’autant plus qu’elle a été rendue par la grande chambre de la Cour,
ayant vocation à unifier la jurisprudence de Strasbourg,
et à été réaffirmée très récemment.
Jean-Paul
COSTA
Je
vous remercie d’avoir présenté cette affaire et d’avoir critiqué le
point de vue de la majorité de la Cour de façon moins virulente et plus
courtoise, me semble-t-il, que celle des juges dissidents.
Un
mot sur cette affaire et un mot pour revenir sur l’exposé de Me Delaporte.
Sur
l’affaire Civet, il est exact qu’en droit pur les deux
raisonnements peuvent être faits. Le raisonnement qu’a fait la majorité de
la Cour, c’est qu’il fallait voir quel était le résultat auquel pouvait
aboutir un recours en cassation. Dès lors qu’il est très possible que même
en statuant en droit pur la Cour de cassation casse un arrêt d’une chambre
d’accusation, et que la chambre d’accusation de renvoi peut accéder à la
demande de mise en liberté de l’intéressé, il est difficile de dire que
le recours n’est pas adéquat et effectif. Je sais bien que cela n’est pas
admis par certains, c’est pour expliquer quelle a été la logique du
raisonnement principal de la majorité de la grande chambre de la Cour.
Sur
l’exposé de Me Delaporte, je voudrais revenir sur un point qui est
important. Comme il a été dit, la disposition de la loi qui avait une portée
rétroactive dans l’affaire Zielinski & Pradal était une
disposition qui résultait d’un amendement parlementaire. Elle a été déférée
au Conseil constitutionnel et celui-ci a considéré, sur ce point précis,
que la disposition législative en cause n’était pas contraire à la
Constitution. J’attire votre attention sur le fait que c’est une situation
assez symétrique de celle de l’arrêt Sarran et Lavancher. Dans cet
arrêt, le Conseil d’Etat a dit, mais en précisant qu’il s’agissait de
l’ordre juridique interne, que la Constitution prévalait sur le traité
international. En revanche, en écartant pour inconventionnalité la
disposition législative qui avait été déclarée conforme à la
Constitution par le Conseil constitutionnel, la Cour de Strasbourg a appliqué
un principe de droit international bien connu, et Paul Tavernier pourrait nous
le confirmer, qui est celui qu’en droit international les traités
l’emportent sur les règles de droit interne, dans la même sphère bien
entendu, fussent-elles de valeur constitutionnelle. Cela avait été
solennellement rappelé par un avis de la Cour internationale de Justice en
1988. C’est une règle de droit international bien connue. Ce qui fait
qu’on aboutit à une situation insoluble, et Hans Kelsen l’avait bien
examinée dans plusieurs de ses articles ou ouvrages : la logique de la hiérarchie
des normes n’est pas la même en droit interne et en droit international.
Cela veut dire finalement que tout dépend des conditions dans lesquelles les
juridictions sont saisies et se reconnaissent compétentes. Lorsqu’en
janvier 1975 le Conseil constitutionnel a décidé qu’il n’avait pas à
contrôler la conformité d’une loi ordinaire à une convention
internationale telle que la Convention européenne des droits de l’Homme (il
s’agissait de la décision sur l’IVG), le Conseil constitutionnel a
implicitement laissé aux juridictions judiciaires et administratives, et en définitive,
à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat, le soin, si elles
s’estimaient compétentes, de contrôler la conventionnalité des lois. La
Cour de cassation d’abord, le Conseil d’Etat quatorze ans plus tard, ont
admis d’exercer ce contrôle dans une situation un peu paradoxale où la
Cour de cassation et le Conseil d’Etat peuvent écarter des lois qui leur
paraissent contraires à la Convention européenne des droits de l’Homme,
mais en revanche, dans une hypothèse comme celle où le Conseil
constitutionnel a dit que cette loi était conforme à la Constitution, je
crois que la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ne peuvent rien faire.
On pourrait parler longuement sur cette affaire, mais je voulais seulement
rappeler ce problème de hiérarchie des normes.
Je
vais passer la parole à M. le juge Mouchard, conseiller à la Cour d’appel
de Rouen, que j’ai déjà rencontré à un colloque du CREDHO à Rouen, et
qui va nous parler encore de détention provisoire, mais hélas sur le fond,
sur la notion même de la durée excessive de la détention provisoire, en
commentant l’affaire Debboub alias El Husseini Ali du 9 novembre
1999.
•
La durée de la détention provisoire (article 5 § 3)
l’affaire
Debboub alias El Husseini Ali
(arrêt
du 9 novembre 1999)
par
Michel
MOUCHARD
Conseiller
à la Cour d’appel de Rouen
Par
arrêt en date du 9 novembre 1999, rendu à l’unanimité, la Cour a décidé
qu’il y avait eu violation par la France des dispositions de l’article 5 §
3 de la Convention à l’encontre de M. Ismaël Debboub.
Si
elle a condamné l’Etat défendeur à rembourser au requérant ses frais pour
un montant de 30.000F , elle a considéré que sa décision constituait une
satisfaction équitable suffisante quant au tort moral et matériel allégué.
Les
dispositions du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention, qui ne
concernent que les personnes arrêtées dans le cadre de la possibilité donnée
aux Etats par le paragraphe 1 c) du même article d’arrêter et détenir une
personne “en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente,
lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une
infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après
l’accomplissement de celle-ci” sont d’une importance tout à fait considérable
pour les praticiens du droit pénal et de la procédure pénale.
La
privation de liberté infligée à un individu non déclaré coupable, en ce
qu’elle porte une atteinte directe au principe de la présomption
d’innocence, n’a jamais été sans poser problème.
C’est
pourquoi la Convention l’a enserrée dans des limites qui se veulent strictes
en prévoyant la comparution de la personne arrêtée “aussitôt” devant un
“juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions
judiciaires”, et surtout pour le cas qui nous préoccupe, en proclamant son
“droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure”, la mise en liberté pouvant être subordonnée à une garantie
assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
Ces
dispositions ne signifient nullement que lorsqu’elle est libre, la personne
poursuivie ne peut se plaindre d’être jugée tardivement ; elle dispose aux
termes de l’article 6 du droit à être en tout état de cause jugée dans un
délai raisonnable, mais, lorsqu’elle est détenue, il appartient aux Etats
d’organiser leurs systèmes judiciaires de façon à ce que la détention pré-sententielle,
dite détention provisoire dans le système judiciaire français, ne soit pas
susceptible de durer au-delà d’un délai “ raisonnable”.
Il
va sans dire que la notion de délai raisonnable est susceptible de varier dans
d’importantes proportions pour des raisons tenant à la nature et aux
particularités de l’affaire considérée ainsi qu’à la personnalité de
l’individu poursuivi.
Il
ne faut pas s’étonner en conséquence de ce que la décision concernant la détention
provisoire de M. Debboub n’apparaisse pas comme un arrêt de principe et
n’ait pas l’attrait d’un renversement de jurisprudence, mais prenne plutôt
la forme d’une confirmation des principes déjà dégagés par la Cour et de
l’approfondissement de ceux -ci par les considérations portées sur une
affaire particulière.
M.
Ismaël Debboub, auquel il arrivait de se faire appeler également Ali Husseini,
s’est trouvé impliqué dans une affaire concernant l’aide apportée sur le
territoire français à des réseaux terroristes algériens, que les enquêteurs
avaient d’abord suivie sous la forme de l’enquête préliminaire, sur la
base de renseignements qui leur étaient parvenus puis, après l’ouverture
d’une information judiciaire à Paris le 17 janvier 1994, sur commission
rogatoire.
Dans
le cadre de cette information, les surveillances et interceptions téléphoniques
opérées permettaient aux policiers d’interpeller 95 personnes dont M.
Debboub le 8 novembre 1994 ; il était au terme de sa garde à vue prolongée
mis en examen et placé en détention provisoire, de même que 77 autres
personnes interpellées le 12 novembre 1994.
Il
ne devait être élargi que le 6 mai 1999, après avoir purgé une détention de
quatre ans, cinq mois et 24 jours au total dont quatre ans deux mois et dix
jours sous le régime de la détention provisoire, ayant été condamné le 22
janvier 1999 à la peine de six ans d’emprisonnement par le tribunal
correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs ayant pour but de préparer
un acte de terrorisme.
La
période à prendre en compte au titre de la détention provisoire ne posait pas
de problèmes en l’espèce, elle commençait au jour de son placement sous
mandat de dépôt et s’achevait au jour de sa condamnation par le tribunal
appelé à statuer sur sa culpabilité.
Dans
le cours de l’instruction, il avait été entendu, outre pour son
interrogatoire de première comparution au cours duquel lui avait été notifiée
sa mise en examen pour les faits pour lesquels il a été condamné et quelques
autres, tous de nature délictuelle, les 11 mai 1995, 23 novembre 1995,14 février,
21 juin, 17 décembre 1996, et une dernière fois le 4 mars 1997 ; un
interrogatoire prévu le 11 octobre 1995 avait été reporté à la demande de
l’avocat de M. Debboub qui n’avait pu avoir accès au dossier.
L’instruction
avait été marquée essentiellement par l’arrestation le 2 avril 1996, en
Grande-Bretagne, du chef du réseau qui était mis en examen par le juge
d’instruction en décembre 1996.
Les
juges chargés de l’instruction du dossier ont communiqué la procédure pour
règlement au procureur de la République qui a rendu son réquisitoire définitif
aux fins de renvoi et de non-lieu partiel le 4 mars 1998, l’ordonnance de
renvoi devant la juridiction de jugement de 138 personnes, dont le requérant,
est intervenue le 9 mars 1998, la juridiction a renvoyé l’affaire qui est
venue pour l’audience au fond le 1er septembre 1998.
La
procédure pénale française applicable à la période a laquelle M. Debboub a
été détenu, telle qu’elle résulte notamment des articles 144 et suivants
du Code de procédure pénale, permet au juge d’instruction de décider, après
débat contradictoire, de la détention provisoire par ordonnance motivée par
le fait qu’elle est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices
matériels, ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou victimes,
soit une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et les
complices, soit lorsqu’elle est nécessaire pour protéger la personne concernée,
mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, pour garantir le
maintien de la personne à la disposition de la justice ou mettre fin au trouble
qu’elle a causé.
La
décision de détention peut intervenir si la personne mise en examen encourt
une peine d’emprisonnement d’au moins un an en matière de délit flagrant,
ou de deux ans en matière d’enquête préliminaire. M. Debboub encourait une
peine de dix ans d’emprisonnement.
L’ordonnance
plaçant M. Debboub en détention était motivée par référence à ce que “
les faits d’une extrême gravité ont très sérieusement troublé l’ordre
public, que le mis en examen en raison de son engagement au sein de ce réseau
et de son niveau de responsabilité est susceptible de réitérer ses
agissements délictueux ; que, par ailleurs, vivant en France dans la
clandestinité, il n’offre aucune garantie de représentation”.
La
détention provisoire ne peut, en matière correctionnelle excéder quatre mois,
elle peut toutefois être prolongée par ordonnance comportant les mêmes motifs
que ceux prévus pour la mise en détention, une seule fois pour une durée de
deux mois au plus si la personne mise en examen n’a jamais été condamnée à
une peine d’emprisonnement supérieure à un an et n’encourt pas une peine
supérieure à cinq ans et, de quatre mois, puis plusieurs fois de quatre mois
après un débat contradictoire si la peine encourue est supérieure à cinq ans
ou si une condamnation à plus d’un an d’emprisonnement a déjà été
prononcée contre la personne .
La
personne mise en examen ne peut toutefois être maintenue en détention plus
d’un an lorsque la peine encourue ne dépasse pas cinq ans, et deux ans
lorsque la peine encourue, supérieure à cinq ans est inférieure à 10 ans
depuis la loi du 30 décembre 1996. Il n’existe pas de délai-butoir lorsque
la peine encourue est de dix ans ou de nature criminelle .
La
détention de M. Debboub a été prolongée, dans le respect de la législation
interne les 1er mars, 6 juillet et 31 octobre 1995, les 26 février, 2 juillet
et 25 octobre 1996, les 3 mars, 4 juillet et 12 novembre 1997.
Il
ne faut accorder aucun intérêt au fait qu’un délai supérieur à quatre
mois ait pu s’écouler entre deux ordonnances, le juge d’instruction ayant
la possibilité de prendre son ordonnance à l’intérieur du délai de quatre
mois, en précisant que la prolongation prendra son effet au dernier jour de détention
valide en vertu de la précédente ordonnance.
Il
a été maintenu en détention au moment où est intervenue l’ordonnance de
renvoi le 4 mars 1998, le tribunal correctionnel a nécessairement statué sur
ce maintien à plusieurs reprises, l’ordonnance de maintien du juge
d’instruction n’ayant d’effet que pour une durée de deux mois et
l’audience au fond ne s’étant ouverte que le 1er septembre 1998.
Après
son renvoi et avant sa comparution, M. Debboub a formé une demande de mise en
liberté à laquelle le tribunal correctionnel a répondu négativement en
motivant sa décision sur la nécessité d’empêcher toute pression sur les témoins
ainsi que le renouvellement de l’infraction, de garantir son maintien à la
disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant
qu’a provoqué l’infraction.
Invoquant
les dispositions de l’art 5 § 3 de la Convention, il a interjeté appel des
dispositions de la décision de prolongation du 2 juin 1996 qui considérait que
sa détention était nécessaire pour préserver l’ordre public du trouble
causé par l’infraction, pour mettre fin à celle-ci, en prévenir le
renouvellement et, garantir le maintien du mis en examen à disposition de la
justice.
Les
éléments de fait sous-tendant cette position du magistrat instructeur
reposaient sur son implication dans le réseau, révélée par les actes
d’instruction accomplis, qu’il y avait un rôle important par ses contacts,
qu’il devait être interrogé notamment sur les éléments découverts en
Grande Bretagne, et qu’il convenait en conséquence de l’empêcher de se
livrer à “toute entreprise qui serait préjudiciable à la manifestation de
la vérité”.
L’ordonnance
a été confirmée par la Chambre d’accusation de Paris pour laquelle “le
maintien en détention est l’unique moyen de garantir la représentation en
justice et d’éviter toute collusion avec les co-auteurs ou complices
activement recherchés” alors qu’il n’existe pas de violation du droit à
être libéré dans un délai raisonnable compte tenu de ce que l’affaire est
“d’une exceptionnelle gravité s’agissant de terrorisme et d’une grande
complexité eu égard au nombre important de personnes mises en examen et des
investigations nombreuses restant à effectuer tant en France qu’à l’étranger”.
Le
pourvoi de M. Debboub n’a pas été couronné de succès, la Chambre
criminelle de la Cour de cassation estimant dans son arrêt du 18 février 1997
que la Chambre d’accusation avait, “par des motifs exempts d’insuffisance
souverainement apprécié que la durée de la détention était raisonnable”.
Il
a interjeté appel de deux autres ordonnances de prolongation rendues le 25
octobre 1996 et le 3 mars 1997 sans plus de succès, la Chambre d’accusation
reprenant les motifs précédemment exposés ; il a été déchu du pourvoi formé
contre l’arrêt confirmant la seconde de ces décisions.
La
Chambre d’accusation a, par arrêt du 25 juillet 1997, confirmé une nouvelle
ordonnance de prolongation dont il avait interjeté appel, en considérant que
“la détention est l’unique moyen de garantir la représentation en justice
de l’appelant qui encourt une peine de dix ans d’emprisonnement, qui n’a
ni domicile, ni emploi en France, qui de nationalité étrangère appartient à
un réseau structuré et dispose de plusieurs identités” et que “la durée
de la détention n’apparaît pas excessive au regard de la gravité des faits
qui ont causé un trouble exceptionnel et durable à l’ordre public, de la
complexité de la procédure, du grand nombre des mis en examen ;” qu’une
mesure de contrôle judiciaire apparaît inopérante pour garantir la représentation
en justice”.
C’est
le 10 septembre 1997 qu’Ismaël Debboub a saisi la Commission européenne des
droits de l’Homme de sa demande fondée sur les dispositions de l’art 5 § 3
de la Convention, se plaignant de la durée de la détention provisoire qui lui
était infligée.
A
la suite de l’entrée en vigueur du protocole n° 11, l’affaire a été
examinée par la Cour.
Pour
le requérant, sa détention provisoire n’était pas justifiée par les nécessités
de l’instruction :
- sa clandestinité ne servait qu’à assurer la sécurité de sa
famille restée en Algérie à la merci des services de police et permettre son
retour très proche dans ce pays ;
- il disposait d’ailleurs d’une résidence en France, une personne
dont il remettait une attestation ayant accepté de l’héberger ;
- le magistrat instructeur n’avait pas fait preuve en ce qui le
concerne de diligences sérieuses puisqu’il ne l’avait convoqué que sept
fois en plus de trois ans et demi, soit moins de deux fois par an ;
- l’argument tiré du trouble à l’ordre public ne peut être invoqué
à l’appui d’une détention provisoire qui n’en finit plus, si elle est,
comme c’est le cas en l’espèce, l’alibi d’un juge d’instruction qui
après trois ans d’atermoiements s’avère incapable de la justifier par les
résultats qu’il obtient ;
- quant à la complexité de la procédure en raison du nombre des prévenus,
il considérait qu’il revenait au gouvernement français d’organiser la procédure
de façon à ce qu’elle soit compatible avec le respect de ses engagements résultant
de la Convention.
Le
gouvernement français qui n’estimait pas que les voies de recours internes
n’avaient pas été épuisées soutenait, au fond, que la détention
provisoire du requérant avait été justifiée par les circonstances particulières
de l’affaire.
Il
y avait tout d’abord des raisons plausibles de soupçonner le requérant
d’avoir commis des infractions.
De
plus, eu égard à la gravité des faits reprochés et à l’importance des
sanctions encourues, la détention était justifiée par le risque de fuite :
ainsi, M. Debboub se trouvait en état de clandestinité en France et, ayant été
condamné à plusieurs reprises, avait fait l’objet d’un arrêté
d’expulsion.
Il
faisait usage de fausses identités et n’avait en France aucune attache,
qu’elles soient familiales ou professionnelles.
Il
convenait aussi de faire de très nombreuses investigations compte tenu de la
complexité de l’affaire et des difficultés existantes pour interpeller et
mettre en examen plusieurs membres du réseau dont son principal responsable ;
il était donc indispensable d’empêcher M. Debboub de faire disparaître des
éléments de preuve ou de se concerter avec des complices encore en fuite ou
non identifiés.
Les
juridictions appelées à statuer sur la détention avaient également régulièrement
insisté sur le trouble à l’ordre public et le risque de réitération de
l’infraction.
Le
raisonnement suivi par la Cour est tout à fait classique en la matière et
exposé avec la clarté habituelle.
Il
incombe aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans chaque
cas, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas une
limite raisonnable.
Il
leur incombe à cette fin d’examiner toutes les circonstances de nature à révéler
ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public
justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle
de la liberté individuelle et d’en rendre compte dans leurs décisions.
C’est
donc sur la base des motifs de ces décisions et des faits non controuvés
indiqués par le requérant qu’il convient d’ apprécier s’il a existé ou
non une violation des dispositions de l’art 5 § 3 de la Convention.
D’autre
part, si l’existence et la persistance de raisons plausibles de soupçonner la
personne arrêtée d’avoir commis une infraction est la condition nécessaire
de la régularité de la détention, elle ne suffit plus au bout d’un certain
temps, et il faut alors que les autres motifs retenus par les autorités
continuent à justifier la détention et qu’elles aient apporté une diligence
particulière à la poursuite de la procédure.
La
Cour va donc se pencher successivement sur les divers motifs retenus tant par le
juge d’instruction que par la chambre d’accusation pour justifier la détention.
Elle
admet que les juridiction françaises aient pu, comme cela ressort des arrêts
de la chambre d’accusation de Paris, estimer qu’il y avait un risque que le
requérant ne s’enfuie en raison de ce qu’il était en situation irrégulière
en France, dépourvu de domicile et muni de faux papiers.
Elle
estime toutefois qu’un tel danger de fuite décroît nécessairement avec le
temps et que les décisions prises à l’encontre de M. Debboub ont omis
d’indiquer en quoi il y avait lieu de considérer qu’il persistait après
trois années de détention.
Elle
observe aussi que si l’arrêt du 25 juillet 1997 fait référence à
l’insuffisance d’un contrôle judiciaire, et que la question de savoir si
l’intéressé était susceptible de fournir des garanties adéquates de représentation
a donc été examinée, cette décision ne motive pas sa position, et les décisions
ultérieures n’ont plus soulevé ce point.
Quant
aux motifs tirés de la préservation de l’ordre public et de la nécessité
d’empêcher le renouvellement de l’infraction, elle estime qu’ils ne
pouvaient à eux seuls justifier une détention provisoire aussi longue.
Le
risque de collusion avec les co-accusés ou d’action sur les preuves pouvait légitimement
justifier la détention au début de la procédure. Il n’en allait plus de même
à partir du moment où les témoins avaient été entendus à de multiples
reprises. D’ailleurs dans leurs dernières décisions, tant la Chambre
d’accusation que le tribunal correctionnel statuant sur une demande de mise en
liberté, n’expliquaient pas les raisons précises pour lesquelles l’élargissement
du requérant aurait contribué à la réalisation de cette crainte.
Ainsi,
certains des motifs exprimés par les juridictions ayant prolongé la détention
ou refusé d’y mettre fin étaient à la fois pertinents et suffisants, mais
ils ont perdu en grande partie ce caractère au fil du temps “de sorte”, dit
la Cour “qu’il convient d’examiner la conduite de la procédure”.
La
Cour se dit consciente de ce que la célérité particulière, à laquelle a
droit un accusé détenu dans l’examen de son cas, ne doit pas nuire à la
qualité de la recherche de la vérité.
Elle
ne dénie pas à l’affaire dans laquelle se trouvait poursuivi M. Debboub une
certaine complexité, relative notamment au nombre des personnes poursuivies.
Elle
trouve, toutefois, dans le fait que le requérant n’ait été interrogé que
deux fois par an en moyenne pendant le cours de la procédure, alors qu’il
n’existe pas d’éléments pour dire qu’il ait par son comportement retardé
l’instruction, matière à penser que les autorités judiciaires françaises
n’ont pas agi en l’espèce avec toute la promptitude nécessaire .
Pour
être conforme à la Convention, la longue durée de privation de liberté subie
par le requérant aurait du reposer sur des justifications plus convaincantes
alors que les motifs retenus ont perdu de leur pertinence au fil du temps et,
par sa durée excessive, la détention de M. Debboub a enfreint les dispositions
de l’article 5 § 3.
On
le voit aisément, l’arrêt Debboub ne remet nullement en cause les
principes dégagés au fil du temps par la Cour de Strasbourg pour
l’application des dispositions de l’art 5 § 3.
Au
contraire, il constitue, en raison de son caractère récent une synthèse
efficace des éléments à prendre en considération.
En
ce qui concerne le délai en prendre en compte, tout d’abord, est examinée la
période qui s’écoule du placement en détention provisoire au premier
jugement statuant sur le fond, réaffirmant ainsi les termes de l’arrêt Wemhoff
c. RFA du 27 juin 1968, non démenti depuis.
Comme
elle le fait habituellement, la Cour se livre à une appréciation in
concreto, du cas d’espèce soumis, et rappelle dans l’arrêt la
formulation tirée de l’arrêt Neumeister c.Autriche du 27 juin 1968,
en mettant à la charge des autorités nationales de “veiller à ce que, dans
un cas donné, la durée de la détention ne dépasse pas la limite du
raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de
nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence
d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une
exception à la règle du respect de la liberté individuelle”.
Quant
aux motifs dont la pertinence doit être étudiée, sont repris en l’espèce,
le risque de fuite, la préservation de l’ordre public, la nécessité d’empêcher
le renouvellement d’une infraction et le risque de collusion entre les coaccusés
sur lesquels il a été statué à de multiples reprises.
De
même, la Cour s’attache particulièrement à la persistance dans le temps des
motifs pertinents de détention, et cela dans le droit fil de sa jurisprudence
constante maintes fois rappelée, notamment en ce qui concerne l’activité des
juridictions françaises dans les arrêts Lettelier c. France et Kemmache
c. France des 26 juin 1991 et 27 novembre 1991, mais position adoptée dès
l’arrêt Neumeister.
C’est
parce que le comportement du requérant n’a pas été la cause de la durée de
sa détention, que la complexité de l’affaire ne la justifiait pas alors, que
les autorités judiciaire nationales n’ont pas apporté la “diligence
particulière” nécessaire à la poursuite de la procédure, que la détention
a dépassé un délai raisonnable : ces exigences étaient déjà présentes
dans de nombreux arrêts dont ceux déjà cités mais aussi dans les décisions Tomasi
c. France du 27 août 1992 et I.A c. France du 23 septembre 1998.
Cet
arrêt tout à fait classique a le mérite de démontrer, par la rigueur avec
laquelle sont appréciés les motifs justifiant la détention et la persistance
de leur existence, qu’il n’existe pas pour la Cour européenne de détention
provisoire déraisonnable du seul fait de sa durée ; celle-ci doit toujours être
mise en regard des éléments la justifiant et des diligences accomplies pendant
qu’elle existe par les autorités judiciaires.
Ainsi,
une espèce qui présenterait une complexité tout à fait considérable, dans
laquelle le détenu résisterait avec succès aux investigations dont il
compromettrait par son comportement le succès, alors que les autorités
judiciaires feraient preuve tout au long de la phase pré-sentencielle des
diligences nécessaires, serait de nature, alors que comme le rappelle la Cour
dans l’arrêt Debboub faisant référence à sa décision Toth c.
Autriche du 12 décembre 1991 “la célérité à laquelle un accusé détenu
a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats
pour accomplir leur tâches avec le soin voulu” à justifier une détention
provisoire au terme extrêmement lointain et indéfini puisque se confondant en
fait avec le jugement sur la culpabilité.
On
ne peut à ce titre que partager les inquiétudes exprimées par le juge J. Crémona
dans son opinion dissidente dans l’arrêt Matznetter du 10 novembre
1969 “ si la longueur justifiable d’une instruction et celle d’une détention
préventive coïncidaient, on pourrait imaginer une affaire d’une complexité
si extrême qu’elle justifierait une détention de dix ans ou davantage par
exemple”
Seule
l’exigence du délai raisonnable pour le jugement, prévu à l’article 6 de
la Convention serait alors de nature à constituer une limite, peut-être
illusoire, les mêmes éléments étant pris en compte pour qualifier de
raisonnable ou non le délai dans lequel intervient le jugement, et la garantie
procédurale prévue par l’art. 5 § 3 serait possiblement vidée de son sens
alors qu’on s’accorde généralement à en faire une garantie autonome de
celle de l’article 6.
D’autre
part, le premier paragraphe de l’art. 5 dispose qu’une personne peut être
“arrêtée et détenue” dès lors qu’il y a “des raisons plausibles de
soupçonner qu’il a commis une infraction”.
La
Cour considère, dans l’arrêt Debboub, que si la persistance de ces
raisons “est une condition sine qua non de la régularité du maintien
en détention”, “au bout d’un certain temps elle ne suffit plus”; il
ressort de cette rédaction que l’existence des raisons plausibles de soupçonner
suffirait “un certain temps“ à justifier la détention, indépendamment de
tout autre élément ”.
Deux
décisions d’irrecevabilité rendues récemment dans des affaires concernant
la France, les arrêts Daugy du 23 mars 1999 et Richard du 12
octobre 1999 viennent nous rassurer sur ce point , la Cour y réaffirmant sa
position plus classique selon laquelle “l’existence d’indices graves de
culpabilité à l’égard d’un inculpé ne justifie pas, à elle seule, le
maintien en détention provisoire”.
Si
la pratique de la détention provisoire en France suscite régulièrement
d’importantes critiques, il est permis de penser que sa réglementation, au
regard des règles du droit positif interne, et la réforme en est d’une itérative
actualité, n’est pas moins favorable au respect de la présomption
d’innocence, à la prévention de la détention et à la limitation de sa durée
que celle issue des dispositions de la Convention.
En
effet, hors du cas de la garde à vue, limitée à une brève période, l’
“accusé” au sens de la Convention, prévenu ou mis en examen selon la
terminologie locale, ne peut être placé en détention provisoire que s’il
existe en l’espèce, en plus des “raisons plausibles de soupçonner”, un
des motifs visés à l’article 144 du Code de procédure pénale qui sont en
fait ceux que retient la Cour de Strasbourg ; sous certaines conditions
relatives à la peine encourue et à l’âge de la personne, le juge est de
plus tenu de soumettre, avant de prendre sa décision, la personne à une enquête
sociale.
De
même, la durée de la détention provisoire est limité par des textes qui
contiennent, depuis la loi du 30 décembre 1996, une référence explicite au
“délai raisonnable”(art 144-1CPP) et instituent des délais indépassables,
quelles que soient les circonstances, la complexité de l’affaire ou le
comportement du détenu : nul ne peut être, aux termes de l’article 145-2 du
CPP détenu provisoirement par un juge français plus de un an si la peine
encourue n’est pas supérieure à cinq ans et plus de deux ans si la peine
encourue est supérieure à cinq ans et inférieure à dix ans.
Les
mêmes textes interdisent d’ailleurs de recourir à cette pratique hors des
cas exceptionnels, encore que la définition de ce caractère soit laissée à
l’appréciation des juges, et les décisions relatives à la détention
doivent indiquer en quoi le contrôle judiciaire (les garanties que la
Convention permet d’imposer en cas de libération) n’est pas utilisable en
l’espèce.
M.
Debboub aurait peut-être été bien inspiré d’avoir une plus grande
confiance à l’égard de la qualité du droit local : pendant sa détention
est intervenue la réforme du 30 décembre 1996 qui a modifié la rédaction de
l’alinéa 1 de l’article 145 du CPP : les décisions de placement en détention
ainsi que de prolongation de celles-ci doivent “comprendre l’énoncé des
considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant du contrôle
judiciaire”.
Les
juridictions doivent également motiver leurs décisions sur ce point même
lorsqu’elles répondent négativement à une demande de mise en liberté si le
détenu soutient la suffisance du contrôle judiciaire à son égard. Or, la
Cour a relevé dans sa décision, que la Chambre d’accusation de Paris, dans
son arrêt du 25 juillet 1997, postérieur à l’entrée en vigueur de cette réforme
sur ce point, avait fait référence, sans la motiver à l’insuffisance d’un
contrôle judiciaire.
Un
pourvoi contre cet arrêt, sur lequel la Cour de cassation devait répondre dans
les trois mois de la réception du dossier à son greffe (art 567-2 CPP), était
certainement de nature à lui apporter une satisfaction plus rapide et plus réelle
que celle apportée par la Cour européenne.
On
met quelquefois bien longtemps à trouver bien loin moins que ce que l’on a
sous la main...
Débats
Jean-Paul
COSTA
Sa
dernière phrase consistant à dire que l’on va chercher bien loin ce que
l’on a à portée de la main m’a fait penser que je pourrais faire annuler
à titre rétroactif mon déménagement de Paris à Strasbourg, mais le métier
de juge à la Cour est trop passionnant pour que j’y renonce...
Auguste
TILLET (avocat général près la Cour d’appel de Paris)
Je
voudrais poser une question sur les motivations des arrêts de la Cour en matière
de durée de la détention provisoire.
La
Cour considère généralement que la pertinence des critères retenus pour
justifier une détention (gravité des faits et de la sanction encourue, impératifs
de l’ordre public, risque de pressions sur les témoins et coaccusés, danger
de fuite), s’atténue avec le temps et qu’après la clôture de
l’information, ces risques ont disparu et ne peuvent donc plus servir de
fondement à la détention.
On
peut se demander néanmoins, lorsqu’un prévenu est renvoyé devant une
juridiction et qu’il sait alors qu’il sera peut-être condamné à une
longue peine d’emprisonnement, si cette motivation de la Cour est valable dans
tous les cas et si, en pareil cas, le prévenu n’est pas susceptible de
vouloir encore se soustraire à l’action de la justice.
Jean-Paul
COSTA
Vous
avez raison de poser la question. Dans l’affaire Debboub, la réponse à la
durée de détention provisoire de cette personne, comme vous l’avez rappelé,
tout de même est très longue, c’est presque 4 ans et demi... Même s’il
est exact qu’il y a certains des éléments qui peuvent justifier le maintien
en détention provisoire, qui ne s’estompent pas nécessairement avec le
temps, il arrive un moment où, selon les paramètres de la Cour, la durée est
vraiment déraisonnable.
J’en
profite d’ailleurs pour répondre à une observation de M. Mouchard. La Cour
ne dit jamais si c’est à partir du 17 mars 1997 que le délai raisonnable
devient déraisonnable. Elle ne peut pas faire autrement. Elle juge ex post
et la notion de délai raisonnable est elle-même extrêmement contingente et
elle dépend beaucoup des circonstances de l’espèce. Ce n’est pas la même
chose qu’un législateur qui ex ante dit : vous ne pourrez pas
maintenir quelqu’un en détention provisoire au-delà de x mois ou de x années.
En réalité, le problème du délai raisonnable est le problème du tas de
sable : à partir de combien de grains de sable passe-t-on des grains de sable
au tas de sable ? C’est une notion extrêmement difficile à cerner...
Michel
MOUCHARD
En
l’espèce, l’argument que vous soulevez est tout à fait valable, mais le
problème est qu’il peut être renversé à l’infini...
M.
Debboub, homme intelligent, sait bien que le juge d’instruction le garde par
pure hargne, ou parce qu’il tient à avoir tous les inculpés sous la main...
Il se dit qu’il a deux solutions : essayer de prendre la fuite si par hasard
il le libère, ou essayer d’aller au tribunal pour être puni par la peine
qu’il mérite, c’est-à-dire celle qu’il aura fait en matière de détention
provisoire. On peut dire que c’est faux, qu’il n’y pense pas. Mais, moi,
je constate que M. Debboub va au tribunal où, en fait, il est libéré parce
qu’il est condamné à la durée d’emprisonnement accomplie sous le régime
de la détention provisoire. Il y a pas mal de personnes qui font cette critique
de la détention provisoire, qui disent que c’est un pré-jugement. Il est
vrai que d’une façon assez globale, les gens qui sont en détention
provisoire ont plutôt intérêt à y rester tranquillement ou rester à
disposition, et attendre que soit prononcée une peine qui la couvrira, plutôt
que de prendre la fuite, ce qui est toujours extrêmement ennuyeux... Donc, forcément,
l’approche du jugement peut inciter quelqu’un qui se dit qu’il va peut-être
être condamné à une peine plus considérable que le temps passé en détention
provisoire, à prendre la fuite, mais d’un autre côté, il y a une telle
habitude qui fait, qu’assez souvent, c’est la durée de la détention
provisoire qui est couverte par la peine prononcée, que le tribunal
correctionnel peut apparaître comme un tribunal libérateur... Le problème est
tout à fait différent en matière de Cour d’assises où du fait de
l’importance des peines qui sont régulièrement prononcées, le risque est
plus grand. Mais le fait que le délai raisonnable existe, que les magistrats
français soient habitués à la nécessité de le prendre en compte, qu’on le
leur rappelle dans le Code de procédure, qu’on fasse une loi qui en termes de
texte est, à mon avis, extrêmement favorable aux mises en examen, et qu’en définitive,
les détentions provisoires restent au même niveau, s’accroissent en durée,
qu’on continue à mettre en détention provisoire des gens pour des affaires
criminelles, par exemple sur des problèmes d’inceste alors qu’on leur
reproche des faits qui ont été commis il y a une dizaine d’années, et
qu’ils n’ont plus aucun contact avec la victime et qu’ils vont attendre
deux ans d’instruction en prison, plus deux ou trois ans avant de passer
devant la Cour d’assises, montre qu’il s’agit plutôt d’un problème
culturel que d’un problème pouvant être traité par des voies strictement
juridiques, qu’elles soient internes ou externes. Les arrêts de la Cour européenne
ont ce bénéfice, et cet avantage (avec parfois un côté un peu rébarbatif...
mais la précision poste par poste, de dire jusqu’à tel moment la détention
était raisonnable et puis lorsque tel témoin a été entendu, cela devient peu
raisonnable...), de mettre les pénalistes français en état de prendre de
bonnes habitudes. C’est pour cela que des décisions déclarées irrecevables,
parce que manifestement mal fondées, m’inquiétent quelque peu : comme
la détention provisoire en France apparaît être un phénomène culturel,
l’existence d’une jurisprudence assez fournie de la Cour européenne, avec
des arrêts très souvent de condamnation de la France, sert tout de même à résister
à l’ambiance, c’est-à-dire qu’on peut prendre des décisions en les
confortant par celles que vous prenez, alors que plein de gens feraient valoir
qu’ainsi on porte atteinte à la sensibilité, à l’ordre public, etc. et on
peut quelquefois libérer des détenus provisoires en se retranchant derrière
le droit européen et la jurisprudence de la Cour. Cette acceptation de longs délais,
qui bien sûr sont justifiés puisqu’il s’agit d’affaires criminelles ou
d’affaires de stupéfiants, ne facilitent pas toujours les choses ...
Jean-Paul
COSTA
Votre
intervention montre tout l’intérêt et toute la complexité de cette
question. Evidemment, dans un monde idéal, il ne devrait pas y avoir, ne fût-ce
que 24 heures, de détention provisoire, puisque c’est contraire à la présomption
d’innocence. Mais nous vivons dans un monde réel, et il faut appliquer soit
des textes de lois internes, dont la loi de 1996 dont vous disiez qu’elle est
très favorable, en tout cas plus favorable que par le passé en matière de détention
provisoire, soit les textes de la Convention européenne des droits de l’Homme
qui partent d’une intention favorable, mais qui sont plus vagues parce que la
notion de délai raisonnable est une notion de soft law , de droit mou ou
de droit fluide... On est obligé de faire avec ...
Nous
en arrivons maintenant à deux affaires qui sont importantes, même s’il ne
s’agit pas d’arrêts de grande chambre. La première est l’affaire Gozalvo,
qui rejoint un problème déjà discuté sous l’angle de la durée de la détention
provisoire, c’est la durée de la procédure. L’autre affaire, l’arrêt Baghli,
concerne le problème du maintien de l’éloignement forcé du territoire d’étrangers...
CEDH, arrêt Muller c. France du 17 mars 1997, Recueil 1997,
II. Dans cet arrêt, la Cour cite un arrêt de la Cour de cassation énonçant
: “Attendu que, pour répondre aux conclusions arguant d'une violation de
l'article 5 § 3 de la Convention au motif que la détention provisoire
aurait excédé un délai raisonnable, les juges énoncent "qu'en l'espèce,
ce délai raisonnable n'a pas été dépassé, au vu de la complexité de
l'affaire et de la multiplicité des faits reprochés à l'accusé " ;
Que cette appréciation de fait échappe au contrôle de la Cour de
cassation.”.
|