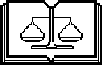|
|
Actes de la Septième Session d'information (arrêts rendus en
2000, Cahiers du CREDHO n° 7)
|
|
Affaire Morel |
Affaire Guisset
| Débats
| Affaire Maaouia
|
|
Le
champ d’application de l’article 6 CEDH en matière commerciale
Le
cas du juge commissaire devant le tribunal de commerce :
l'affaire
Morel (6 juin 2000)
par
Marie-Laure
Niboyet
professeur
à l’Université Paris X-Nanterre
L’attitude
très « compréhensive » adoptée par la Cour européenne dans
l’affaire Morel à l'égard du droit
français des procédures collectives surprendra tous ceux qui, en France,
s’apprêtaient déjà – à la faveur de la réforme en gestation du droit
des entreprises en difficulté et de l’organisation des tribunaux de commerce
- à modifier le droit interne pour le rendre conforme à ce qu'ils croyaient
devoir se déduire des principes d'équité.
Dans
la recherche d’un juste équilibre entre ces intérêts divers, je ne suis pas
sûre qu’ici l’arbitrage rendu par la Cour européenne soit le plus
judicieux.
L'affaire
Morel est relative à une procédure
de redressement judiciaire ayant débouché sur la liquidation judiciaire de
cinq sociétés de travaux de construction. Dans cette affaire, le
juge-commissaire, organe central des procédures collectives françaises, était
mis sur la sellette pour violation d’une part, du principe de l’égalité
des armes, par suite du défaut de communication de son rapport au gérant des
sociétés, et d’autre part, du principe d’impartialité du fait de la présence
de celui-ci dans la formation de jugement du tribunal appelé à statuer sur le
plan de redressement, présenté par l’administrateur, alors qu’il avait
participé activement à la phase d’observation.
Les
griefs dénoncés par le requérant à Strasbourg reprenaient exactement les
moyens qui avaient été rejetés en 1996 par la Cour de cassation
et ils ont été pareillement écartés par la Cour européenne. Il me semble néanmoins
que la motivation extrêmement circonstanciée de cet arrêt n’autorise pas à
en déduire la délivrance par la Cour de Strasbourg d’un blanc-seing
conféré à certaines pratiques de nos tribunaux de commerce. L’arrêt Morel
me paraît devoir être classé parmi les arrêts d’espèce.
I
• Sur l’absence de violation du principe d'égalité des armes
La
difficulté provient de l’éparpillement des textes énumérant les cas dans
lesquels le rapport préalable du juge commissaire est obligatoire et de leur
silence sur la forme que doit prendre ce rapport. Le plus grand flou règne en
effet sur la façon dont ce rapport est présenté en pratique : par écrit
et, en principe communiqué aux parties ; par oral à l’audience et donc
soumis à la critique des parties ; ou encore, en cours de délibéré et
couvert alors par le secret du délibéré.
Ainsi
notamment, ce rapport constitue-t-il une formalité substantielle, à défaut de
laquelle le jugement serait nul, en vertu de l’article 36 de la loi
(aujourd’hui art. L.621-27) en cas de saisine du tribunal (quelle que soit
d’ailleurs la personne qualifiée pour exercer cette saisine, contrairement à
la présentation proposée par le gouvernement dans cette affaire) en cours de période
d’observation afin de mettre un terme à celle-ci et d’ordonner la cessation
totale ou partielle d’activité, ou, selon l’article 145 (art. l. 621-141),
lorsque le plan de redressement est présenté par le débiteur dans la procédure
simplifiée dépourvue d’administrateur ; et il est même précisé que le
juge-commissaire doit émettre alors un avis motivé. En revanche, dans la procédure
générale au cours de laquelle le plan est présenté par l’administrateur
— comme en l’espèce —, l’article 61 de la loi (devenu art. 691-62) ne
prévoit pas le rapport préalable du juge-commissaire tandis que le décret en
fait une obligation générale (art. 24), dès lors que le tribunal statue sur
les contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire.
Des
avocats rompus aux audience des tribunaux de commerce m’ont confié qu’ils
n’avaient jamais entendu à l’audience de rapport du juge-commissaire et
encore moins obtenu communication d’un rapport écrit, y compris lorsque ce
rapport est obligatoire et constitue donc une formalité substantielle. Certes,
il ne faut pas généraliser mais c’est, sans doute, le signe d’un usage
assez répandu.
De
fait, la jurisprudence considère que ce rapport n’est soumis à aucune
condition de forme, et peut donc, dans tous les cas, être présenté oralement.
Le jugement doit seulement mentionner l’accomplissement de cette formalité,
sans être toutefois tenu de préciser en quelle forme le rapport a été fait.
On
peut donc trouver assez stérile l’argumentation développée par le requérant,
à partir du visa de l’article 36 et de la mention d’un “rapport” du
juge-commissaire dans le jugement, pour soutenir que ce rapport avait dû être
écrit et qu’il avait donc été tenu secret, aucune communication ne lui en
ayant été faite. Autrement dit, son argumentation était la suivante : puisque
le rapport était établi en application de l’article 36 (parce que le
tribunal a statué sur la liquidation de l’entreprise), il était nécessairement
obligatoire et écrit. Son défaut de communication constituait donc une
violation du principe de l’égalité des armes. Et le requérant d’invoquer
la jurisprudence de la Cour de Strasbourg qui veille au respect du principe
selon lequel toute pièce ou observation présentée au tribunal, même par un
magistrat indépendant, doit être communiquée aux parties, principe qui avait
été commenté ici, il y a deux ans, à propos de la présentation de
l’affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd,
par mon collègue François-Guilhem Bertrand,
et qui devrait s’appliquer au rapport du juge-commissaire, du moins si ce
rapport est obligatoire.
Mais
c’est là que le bât blessait. Le moyen était doublement inexact.
Inexact
d’abord, parce que la référence à l’article 36 dans les mentions du
jugement provenait d’une erreur de plume, la procédure à suivre en
l’occurrence étant celle de l’article 61 qui n’impose pas de rapport préalable.
Du moins, c’est ce qu’a soutenu le gouvernement français dans cette affaire
et c’est ce qu’a paru admettre à l’audience le requérant. La Cour a
constaté en conséquence que cette argumentation qui ne reposait que sur des
mentions erronées s’effondrait dès lors que l’erreur était constatée et
reconnue par les parties.
Mais
de toute façon, le moyen était juridiquement inopérant puisqu’en tout état
de cause le rapport pouvait avoir été présenté oralement, quel que soit le
fondement textuel de la production de celui-ci. Si donc le rapport du
juge-commissaire avait été présenté oralement, la communication s’était
faite à l’audience, comme l’avait admis la Cour de cassation en 1996. Et si
le rapport n’avait pris la forme que d’observations orales lors du délibéré,
il pouvait être assimilé à l’avis sur le mérite du pourvoi émis par le
conseiller-rapporteur devant la Cour de cassation, avis que la Cour européenne
a effectivement jugé couvert par le secret du délibéré dans l’affaire Reinhardt
précitée.
On
reconnaîtra toutefois que ces zones d’ombre du droit français, et notamment
l’absence de tout contrôle réel sur le respect de l’obligation faite au
juge-commissaire de présenter un rapport préalable, autorisent des pratiques
qui malmènent, quelque peu, les droits de la défense. Il est dommage que cette
vraie question ait été escamotée dans la discussion devant la Cour au motif
d’un acquiescement, du reste par la suite contesté,
du requérant à la thèse du gouvernement.
Il
serait donc utile de clarifier les règles en la matière en exigeant à tout le
moins que les juges précisent en quelle forme le rapport a été présenté
afin de permettre le contrôle de ces principes. Par ailleurs, l’assimilation
entre le juge-commissaire, personnage omnipotent de la procédure depuis son
origine, au conseiller-rapporteur devant la Cour de cassation est très
contestable. Quand le rapport est obligatoire et oral, il devrait nécessairement
être soumis d’une façon ou d’une autre à la critique des parties. Enfin,
l’exigence même de ce rapport n’est pas indifférente à l’appréciation
que l’on peut porter sur le deuxième grief articulé par le requérant.
II
• Sur l’absence d’atteinte au principe d’impartialité
Après
avoir, en vain, tenté de convaincre la Cour de la partialité personnelle du
juge-commissaire à son encontre, le requérant contestait ensuite
l’impartialité objective de celui qui avait siégé dans la formation de
jugement alors qu’il disposait de pouvoirs très étendus dans la phase
d’observation des sociétés. C’était la question essentielle soulevée par
cette affaire.
Le
juge-commissaire, qualifié par les auteurs de “pivot”,
“d’homme-orchestre”, de “personnage central de la procédure", détient de larges pouvoirs qui lui
permettent de porter de multiples casquettes :
•
un pouvoir général de surveillance du bon déroulement de la procédure et des
organes de celle-ci, dont il peut proposer le remplacement
•
une compétence de juge d’appui pour prendre des mesures urgentes ou
conservatoires
•
une compétence de juridiction gracieuse pour autoriser des actes graves tels
les licenciements ou des actes de disposition étrangers à la gestion courante
•
une compétence pleinement
juridictionnelle pour statuer sur l’admission des créances au passif de
l’entreprise.
Tous
ces pouvoirs lui procurent indéniablement une connaissance approfondie du
fonctionnement des sociétés en cause et du déroulement de la procédure. Il
est doté d’ailleurs de larges pouvoirs d’information auprès de multiples
organismes pour connaître la situation économique et financière de
l’entreprise.
Or,
le principe d’impartialité n’impose-t-il pas une séparation des fonctions
d’instruction et de jugement (arrêt Cubber
c/ Belgique du 2 oct. 1984) comme de celles de poursuite et de jugement (arrêt
Piersack c/ Belgique du 1e
oct. 1982), afin qu’à chaque étape distincte de la procédure un œil neuf
intervienne et que soient ainsi préservées - selon la formule consacrée - les apparences et la confiance que les tribunaux doivent inspirer aux
justiciables ?
On
connaît l’adage si souvent rappelé par la Cour : «Justice
must not only be done, it must be seen to be done».
A
cet égard, la Cour concède que la présidence du tribunal par le
juge-commissaire pouvait susciter des doutes chez le requérant mais l’analyse
minutieuse des circonstances de l’affaire l’a conduite à conclure que ces
doutes n’étaient pas en l’espèce objectivement justifiés.
Il
faut souligner la motivation extrêmement circonstanciée de l’arrêt Morel
qui suit une méthode déjà bien éprouvée par la Cour de Strasbourg mais qui
rend très délicate l’appréciation de la portée de cette décision, y
compris dans le domaine très spécifique du rôle du juge commissaire.
A
• Une méthode d’appréciation déjà éprouvée
Comme
la Cour l’a rappelé, il faut se départir de tout dogmatisme et de tout a
priori. La formule clé est donnée au paragraphe 45 : « la réponse à cette question varie suivant 'les circonstances de la
cause'».
D’emblée
sont ainsi balayés tous les précédents invoqués par le requérants et rendus
dans d’autres domaines, y compris sur d’autres aspects des procédures
collectives : les arrêts de la Cour de cassation de 1999 interdisant la présence
du rapporteur à la COB ou au Conseil de la concurrence pendant le délibéré ;
les arrêts de 92 et 93 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation
interdisant, dans le cadre de la procédure de saisine d’office aux fins de
poursuite en faillite personnelle du dirigeant, d’exprimer dans la convocation
une opinion personnelle, à l’encontre de la personne visée, susceptible de
constituer un risque de préjugé ou de parti pris ; ou encore un arrêt de
la Cour de Grenoble de 1997
ayant reproché à un magistrat d’avoir siégé comme président et
juge-commissaire dans les instances ayant prononcé le redressement judiciaire
puis la liquidation judiciaire d’une société et ensuite d’avoir présidé
le tribunal qui avait prononcé la mise en faillite personnelle du dirigeant.
Ainsi,
la Cour s’abstient-elle de tout jugement sur notre jurisprudence nationale en
la matière. On ne peut donc en induire ni désaveu ni approbation de cette
jurisprudence. Les circonstances sont simplement différentes du cas jugé. Le
contexte fortement teinté de coloration pénale de ces jurisprudences est
effectivement différent de celui – purement économique – de l’affaire Morel.
De
même sont indifférentes, aux yeux
de la Cour, les circonstances suivantes :
-
le simple fait d’avoir pris des décisions avant le jugement sur le fond ne
constitue pas en soi une atteinte à l’impartialité objective. Un magistrat
peut fort bien intervenir à des phases différentes de la procédure si ces décisions
n’ont pas le même objet. Il ne faut pas avoir une conception trop rigide du
principe de la séparation des fonctions. L’observation reprend une
jurisprudence abondante par laquelle
la Cour a admis dans des affaires intéressant la matière pénale, et même au
sujet de la détention provisoire, qu’un juge ayant pris des décisions limitées
pendant la période d’instruction puisse ensuite siéger dans la formation de
jugement, à la condition que ces premières décisions n’impliquent pas
d’avoir préjugé la question à trancher;
-
la connaissance approfondie du dossier par le juge - et notamment de données
préliminaires entrant en compte dans l’appréciation finale - n’implique
pas davantage un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au
moment du jugement sur le fond.
Quant
à l’influence qu’un juge peut exercer sur les autres, elle est tout
simplement en dehors du débat.
Tout
dépend, en définitive, d’un critère chronologique : à quel moment les
éléments du litige ont-ils été appréciés, avant ou lors de l’appréciation
finale, avant ou avec le jugement ?
Appliquée
au cas Morel, la seule question qui
importe (à la Cour) est celle de savoir si, « compte tenu de la nature et
de l’étendue des fonctions du juge-commissaire durant la phase
d’observation et des mesures adoptées, ce dernier fit preuve d’un parti
pris quant à la décision à rendre par le tribunal » (§ 47).
C’est
dire qu’il faut comparer très exactement l’objet des mesures prises par le
juge-commissaire et celui du jugement rendu et définir le moment auxquels ces
divers éléments sont intervenus.
Pour
la Cour, chacun des termes de la comparaison avait un objet distinct et se
produisait en un temps différent. Durant la phase d’observation, le
juge-commissaire n’avait pris que des mesures relatives à la gestion de
l’entreprise. Le tribunal, quant à lui, devait apprécier la viabilité à
plus ou moins long terme du plan de continuation proposé par le requérant, en
se plaçant à la fin de la phase
d’observation.
C’est
donc au vu des circonstances de la cause, qu’elle conclut à l’absence de
violation de l’article 6-1. C’est aussi au vu de ces circonstances particulières,
et de l’appréciation qui en a été faite par la Cour, qu’il convient de
mesurer la portée — qui me semble très relative — de cet arrêt.
B
• La portée toute relative de l’arrêt
Les
décisions prises en l’espèce étaient nombreuses et de nature différente.
La
plupart relevait de la catégorie des mesures conservatoires (séquestre de
compte, désignation d’experts). Elles ne soulevaient pas de difficulté. Mais
il y avait eu aussi des autorisations de ventes et surtout des autorisations de
licenciement pour disparition de postes (14 personnes licenciées).
Ces
dernières mesures sont déjà plus litigieuses car elles impliquent — pour en
déterminer l’utilité, voire la nécessité — une appréciation portée sur
la situation économique et financière des sociétés. Il en serait de même si
l’autorisation du juge-commissaire était sollicitée pour la poursuite de
contrats en cours. De plus, ce sont des mesures susceptibles d’engager
l’avenir de l’entreprise. C’est pourquoi l’on parle de « véritable
magistrature économique » du juge-commissaire.
Mais
ces mesures sont prises et appréciées pendant la période d’observation au
vu de la situation actuelle de l’entreprise. Elles n’impliquent aucune
projection dans l’avenir, aucun regard prospectif sur la viabilité de son
redressement, même s’il peut y avoir des points de contact.
D’ailleurs,
dans l’affaire Morel, le plan a été
refusé, semble-t-il, exclusivement pour insuffisance de garanties financières
du débiteur, déficience qui avait été soulignée par l’administrateur dans
son rapport et qui était sans lien aucun avec les mesures prises par le
juge-commissaire. La solution est donc convaincante au regard des circonstances
de l’affaire.
Mais,
que faudrait-il décider dans des circonstances faisant apparaître un lien plus
étroit entre les décisions préliminaires du juge-commissaire et le jugement
sur le plan ? Spécialement dans les hypothèses où il doit donner un avis
préalable, comme par exemple dans la procédure simplifiée sur le plan de
continuation proposé ?
La
question n’a pas été débattue sous cet angle dans l’affaire Morel, mais elle avait fait l’objet de décisions contrastées des
juridictions nationales. Et la doctrine était plutôt sceptique sur la
conformité de notre droit à l’article 6.
La
Chambre commerciale en 1992,
suivie par les Cours de Paris et de Besançon
avait estimé que la présence au tribunal du juge-commissaire ne portait pas
atteinte au principe de l’impartialité, même si le tribunal ne pouvait
statuer sans avoir au préalable pris connaissance de son rapport, mais la Cour
de Versailles a estimé qu’un juge-commissaire ne peut à la fois donner son
avis et juger ensuite. Il est vrai que cette
jurisprudence est intervenue sur un aspect différent du droit de la faillite,
l’hypothèse de procédures de sanctions contres les dirigeants.
De
fait, dans de telles hypothèses, il a bien forgé son appréciation avant le
jugement. La délimitation chronologique entre les diverses appréciations
n’est plus respectée et l’atteinte au principe d’impartialité est
patente.
Mais
l’idée qu’on ne peut à la fois donner un avis sur une affaire et la juger
ensuite est transposable à tous les domaines dans lesquels le juge-commissaire
doit être préalablement consulté et même, peut-être, au-delà, compte tenu
de l’étroitesse de la collaboration qui s’instaure entre l’administrateur
et le juge-commissaire qui travaillent le plus souvent la main dans la main.
Certes,
on pourrait faire valoir les nécessités de rapidité et d’efficacité qui
impriment à la procédure en cette matière des spécificités auxquelles la
Cour européenne peut être sensible. Il est certes utile que le
juge-commissaire, qui a la meilleure connaissance du dossier et qui a fait vivre
la procédure depuis son origine, puisse donner son avis. Mais il importe aussi
d’éviter tout risque de confusion des rôles, d’éviter surtout que ce
personnage central ne puisse être sensible à des influences extérieures pour
accepter des offres de reprise de l’entreprise en difficulté, ou du moins
puisse être suspecté de l’être.
C’est
pourquoi il faut être prudent dans l’interprétation de l’arrêt Morel qui ne remet nullement en cause la jurisprudence française récente
qui a fait une application stricte du principe d’impartialité pour interdire,
dans une matière assimilée au droit pénal, la présence du rapporteur devant
la COB ou le Conseil de la concurrence lors du délibéré. Certes les Etats
disposent toujours d’une marge d’appréciation, spécialement en matière économique
ou dans des contentieux spécialisés qui pourrait expliquer la solution Morel.
Quoi
qu’il en soit, même si une latitude est laissée aux Etats, on peut former le
vœu que la France en fasse un bon usage et qu’on ne revienne pas sur des
intentions de réforme salutaire, ne
serait-ce que pour restaurer la confiance — aujourd’hui bien écornée —
dans le déroulement des procédures collectives devant les tribunaux de
commerce.
Michele
DE SALVIA
Il
s’agit d’une impartialité dans un cadre civil. Toute la jurisprudence de la
Cour a été élaborée par rapport aux espèces pénales.
|
|
Le
champ d’application de l’article 6 CEDH en matière financière
Le
cas de la Cour de discipline budgétaire et financière :
l’affaire
Guisset (26 septembre 2000)
par
David
Rochon
Doctorant
à l’Université de Paris XI
Il
apparaît presque naturel qu'après le contentieux pénal, disciplinaire,
administratif, ou fiscal, le droit de la Convention européenne des droits de
l’Homme vienne affecter à son tour le contentieux des juridictions financières.
Pour sembler aller de soi, ce nouveau développement n'en est pas moins problématique
tant les préoccupations qui président au contrôle juridictionnel des finances
publiques et la philosophie dont procède la Convention sont éloignées. La décision
Guisset en est l’illustration :
donnant lieu à une condamnation de la France pour violation de l'article
6‑1 de la Convention en raison de l'absence de publicité des débats et
de la durée déraisonnable de la procédure devant la Cour de discipline budgétaire
et financière.
Cette
affaire soulève une question plus générale, celle de la conciliation des
exigences de la Convention européenne des droits de l’Homme avec l’action
des juridictions financières. Ancien ambassadeur de France aux Emirats arabes
unis, M. Guisset avait méconnu des règles élémentaires du droit budgétaire
en contractant en 1980 et 1981, au nom de l'ambassade de France et de sa propre
initiative, un emprunt destiné au financement d'un centre culturel français à
Abou Dhabi. Le montage financier dont il était le concepteur était à la fois
ingénieux, commode et économe des deniers de la France, il n'en demeurait pas
moins parfaitement irrégulier, dans la mesure où seul le Ministre des Finances
était susceptible de souscrire un tel engagement. Ayant eu connaissance de manière
incidente de ce manquement, la Cour des comptes décidait en février 1984 de
renvoyer M. Guisset devant la Cour de discipline budgétaire et financière,
juridiction compétente pour juger des infractions commises par les
ordonnateurs. Celui‑ci n'en était pas cependant pas avisé à l'époque.
Ayant quitté les Emirats arabes unis, il était nommé ambassadeur de France en
Bolivie jusqu'en 1986, date à laquelle il cessait ses fonctions diplomatiques
sans recevoir de nouvelle affectation ; il ne conservera que son traitement
de base sans nouvel avancement jusqu'à sa mise en retraite en 1997. En février
1987, le Procureur général de la Cour des comptes avait demandé l'ouverture
d'une instruction, ce dont M. Guisset avait été informé quelques mois plus
tard. Entendu par le rapporteur à deux reprises, en juin et juillet 1987, il était
renvoyé par une décision du Procureur général près la Cour des comptes en
date du 15 novembre 1988 devant la Cour de discipline budgétaire et financière.
Le 7 février 1989, M. Guisset en était avisé et pouvait prendre connaissance
du dossier.
Après
avoir présenté sa défense, il était condamné à deux mille francs d'amende
par la Cour dans un arrêt notifié le 3 octobre 1989. Sur pourvoi du requérant,
cet arrêt était finalement cassé le 29 décembre 1993 par le Conseil d'Etat
pour non réponse à une fin de non-recevoir soulevée par le requérant. Pris
sur renvoi, le second arrêt de la Cour de discipline budgétaire en date du 12
avril 1995, tout en constatant la violation des règles budgétaires, décidait
de ne pas entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. Guisset qui était
donc relaxé. Celui‑ci s'estimant néanmoins victime en raison de son
maintien dans une position statutaire peu conforme à ses aspirations, saisit la
Commission européenne des droits de l'Homme qui conclut le 9 mars 1998 à l'applicabilité de
l'article 6 §1 à la procédure devant la Cour de discipline budgétaire et
financière et déclare la requête présentée par M. Guisset partiellement
recevable.
La
Cour, saisie de deux réclamations ayant trait l'une à la longueur du délai de
la procédure, l'autre à l'absence de publicité des audiences devant la Cour
de discipline budgétaire et financière, constate la violation de l'article
6§1, tant en ce qui concerne le délai excessif de la procédure que
l'absence de publicité des audiences et condamne la France. Ce faisant, elle
retient une application particulièrement exigeante de l’article 6-1 de la
Convention, à la lumière de laquelle on doit s’interroger sur les conditions
d’action des juridictions financières dans leur ensemble et la pérennité du
système juridictionnel de contrôle des finances publiques.
I
• L’application exigeante de l’article 6-1 à la procédure devant la Cour
de discipline budgétaire et financière
A
• Une applicabilité légitime
Dans
sa décision, la Cour se borne à constater de manière laconique
l’applicabilité de l’article 6-1, estimant que « la Cour de
discipline budgétaire et financière doit être regardée comme décidant du
bien-fondé d’accusations en matière pénale » au sens de la Convention », en prenant acte du
revirement intervenu dans la jurisprudence du Conseil d’Etat à ce sujet.
Relativement
prévisible, cette solution est parfaitement cohérente avec la jurisprudence
antérieure de la Cour, qui fait dépendre l’applicabilité de l’article 6
de la nature du litige et non de celle de la juridiction. La question de
l’applicabilité de l’article 6-1 n’était plus réellement contestée
devant la Cour, mais avait été âprement débattue devant la Commission. Pour
conclure que la Cour de discipline budgétaire était saisie du « bien-fondé
d’accusations en matière pénale », la Commission a très classiquement
fait référence tant à la nature de l'infraction qu'à la nature et au degré
de gravité de la sanction. A ces fins, elle souligne à la fois le caractère général
de la norme sanctionnée, la nature préventive et répressive de la sanction et
enfin la gravité de la peine encourue.
S’agissant
de la norme sanctionnée, elle possède selon la Commission un caractère général
dans la mesure ou elle s’applique indistinctement à tous ceux qui sont
susceptibles de se trouver en situation de commettre l’infraction.
S'agissant
de la nature de l'infraction, le caractère à la fois préventif et répressif
de la sanction lui paraît établi puisqu'il s'agit de prévenir toute gestion
irrégulière des deniers publics et d'en réprimer les auteurs. Du reste la
Cour de discipline budgétaire a vocation à prononcer des amendes qui n’ont
pas un caractère de réparation mais de sanction.
S’agissant
de la gravité de la sanction, là encore la cause est entendue puisque celle-ci
peut aller jusqu'à deux fois le montant brut annuel du traitement de la
personne poursuivie. Si ces sanctions ne sont pas, ainsi qu’il a été souvent
souligné, particulièrement lourdes, on ne saurait affirmer non plus qu’il
s’agit de sanctions de principe.
Cette
solution remet en cause la position traditionnelle des juridictions françaises
pour qui la question de l'applicabilité de l'article 6 au contentieux devant la
Cour de discipline budgétaire et financière avait appelé de longue date une réponse
négative.
La position tant du Conseil d’Etat que de la Cour de discipline budgétaire
et financière était fondée sur la nature spécifique
des sanctions prononcées par la CDBF : ni disciplinaires, ni pénales,
échappant au régime des unes et des autres et susceptibles de se combiner avec
elles. Ainsi par exemple relevait-t-on habituellement le fait qu’elles étaient
exclues en raison de leur nature particulière des lois d’amnistie.
Cette altérité fait tout l'intérêt de la sanction budgétaire,
susceptible de constituer tantôt une alternative à la répression pénale que
celle‑ci ne fusse pas souhaitée ou plus possible, tantôt un moyen
d’alourdir celle‑ci pour souligner la gravité de la faute. Aussi le
Conseil d’Etat avait-il rappelé notamment dans un arrêt du 30 octobre 1991, M.
Dussine et M. Gautier, que « les amendes prononcées… par la Cour de
discipline budgétaire et financière n’interviennent pas dans le cadre
d’une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ni dans
celui d’une accusation en matière pénale » au sens de l’article 6-1
de la Convention. De nouveau saisi d’un pourvoi dans l’affaire Guisset, il avait maintenu cette solution jusqu’à la décision
contraire de la Commission.
B
• Une application exigeante
L’article
6 déclaré applicable, sa violation est sanctionnée sur deux plans, celui du délai
de la procédure tout d’abord, jugé déraisonnable, celui du défaut de
publicité des audiences ensuite.
Le
délai de la procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière
est jugé non raisonnable. Même en retenant comme elle le fait pour point de départ la date
la plus favorable aux prétentions du Gouvernement français, à savoir la
notification à la personne poursuivie du « reproche d'avoir accompli
l'infraction », c'est-à-dire en l'occurrence non la date de déféré devant
la Cour de discipline budgétaire et financière, le 15 février 1984 mais celle
de la notification le 11 février 1987 à M. Guisset par le Procureur général
qu'une instruction était ouverte à son encontre, le requérant n'est jugé définitivement
que huit ans plus tard et le délai considéré comme déraisonnable.
On
sait que le caractère « raisonnable » du délai s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard, notamment, à la complexité
de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
nationales compétentes. La Cour de Strasbourg apparaît dans cette affaire
comme particulièrement exigeante dans son appréciation. Si l’on ne doit pas
surestimer la complexité de l’affaire, on peut néanmoins souligner que
celle-ci a donné lieu à un pourvoi en cassation, un renvoi et un nouveau
pourvoi en cassation. D’autre part, il semble que le requérant ait assumé
une part de responsabilité dans la longueur de la procédure, utilisant à
plein les délais qui lui étaient laissés pour la préparation de sa défense.
Le
deuxième aspect de la procédure devant la CDBF sanctionné par le juge de
Strasbourg est l'absence de publicité des audiences. Expressément prévu par
le code des juridictions financières,
le secret des audiences présente un double intérêt : préserver la réputation
de la personne poursuivie et assurer aux audiences une certaine sérénité.
Cette règle apparaît surtout comme un héritage, celui du principe
traditionnel d’absence de publicité des audiences devant les juridictions de
l’ordre administratif. Cependant, la contrariété
entre l’article L. 314-15 du code des juridictions financières et le principe
de l’article 6 de la CEDH ne faisait pas beaucoup de doute.
Celui-ci stipule en effet :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ».
C’est
pourquoi le débat devant la Commission et la Cour porta moins sur le principe
de la publicité que sur la possibilité pour le requérant de se prévaloir
d’un quelconque préjudice, dans la mesure où il était difficile d’établir
en quoi cette absence de publicité lui avait nuit. Cohérente eu regard de la
philosophie démocratique sur laquelle repose la Convention, la justice s'exerçant
sous le regard du public étant supposée s'exercer sous le contrôle du peuple,
la solution retenue soulève néanmoins des objections dès lors que le défaut
de publicité constitue aussi une protection du requérant et qu'il n'est pas établi
qu'elle lui ait porté préjudice.
Ainsi,
alors que l’applicabilité de l’article 6-1 apparaissait légitime et prévisible,
son appréciation en l’espèce fait l’objet d’une lecture particulièrement
exigeante de la part de la Cour de Strasbourg. Il convient d’en mesurer la
portée non seulement sur la situation de la Cour de discipline budgétaire et
financière mais également à la lumière de son incidence sur l’action des
juridictions financières dans leur ensemble.
II
• La difficile conciliation des exigences de la CEDH avec l’action des
juridictions financières
Bien
que frontalement contraires à la solution historiquement retenue par le juge
français, les conséquences de la position du juge européen dans cette affaire
n’en ont pas moins été très rapidement tirées. L’essentiel des
ajustements a même été effectué dès la décision de la Commission et sans
attendre l’arrêt de la Cour. Cependant, au delà des seules incidences sur la
Cour de discipline budgétaire et financière qui pourront rester réduites, se
pose un problème général de conciliation des exigences de la Convention européenne
des droits de l’Homme avec l’action des juridictions financières. Longtemps
anecdotique, la question de l’applicabilité de l’article 6 de la CEDH est
en effet désormais, comme le relève Gilbert Orsoni,
la plus fréquemment posée au Conseil d’Etat lorsqu’il intervient en
cassation des arrêts de la Cour des comptes.
A
• Les conséquences sur la CDBF pourront rester réduites
L'applicabilité
de l'article 6 §1 à la procédure devant la CDBF n'est plus désormais contestée
par les juridictions françaises. La
décision de la Commission dans l’affaire Guisset
a conduit le Conseil d’Etat à faire évoluer sa jurisprudence sans attendre.
Dans sa décision de section du 30 octobre 1998, M.
Lorenzi, la haute juridiction
administrative conclut à l'applicabilité de l'article 6 à la procédure
devant la Cour de discipline budgétaire et financière. Dans l'affaire Lorenzi, la Cour de discipline budgétaire et financière par une décision
du 13 octobre 1993, avait en effet encore une fois affirmé que « quand elle
est saisie d’agissements pouvant donner lieu aux amendes prévues par la loi (
... ), la Cour de discipline budgétaire et financière doit être regardée
comme décidant du bien fondé d' « accusations en matière pénale ». Le
Conseil d'État, saisi d’un pourvoi en cassation invoquant le non respect des
exigences de l'article 6‑1 de la CEDH en matière de publicité des
audiences, accueille ce moyen et opère un complet revirement, posant pour
principe que la Cour « doit dès lors siéger en séance publique sans que
puisse y faire obstacle... l'article 23 de la loi du 25 septembre 1948 qui prévoit
que « les audiences de la Cour ne sont pas publiques ».
Un
certain nombre d’aménagements ont été apportés afin de garantir la
conformité de la procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière
aux exigences de la Convention. On doit ainsi constater que les préoccupations
liées au respect de l’article 6 constituent aujourd’hui le principal
vecteur d’évolution de la procédure devant la Cour. Celle-ci a procédé à
un véritable aggiornamento en matière
de publicité des audiences jusqu'en 1996 et alors même que le code des
juridictions financières prévoit expressément la solution contraire, la Cour
reconnaissait aux personnes poursuivies la possibilité d’exiger une audience
publique et les informait de ce droit, tandis que depuis 1999, la Cour siège
systématiquement en audience publique.
Ces
aménagements laissent néanmoins subsister un certain nombre de difficultés.
•
La question de la durée de la procédure devant la Cour de discipline budgétaire
et financière reste un point d’achoppement important. Le problème ne saurait
être facilement résolu dans la mesure où l’on se heurte à des difficultés
de nature structurelle liées à la composition de la Cour. Celle-ci comporte
six magistrats : le Premier Président de la Cour des comptes, le Président
de la section des finances du Conseil d’Etat, deux conseillers d’Etat, et
deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, le Procureur général près
la Cour des comptes faisant office de Procureur. Amenée à jouer un rôle de
plus en plus important pour répondre aux attentes nouvelles en terme de moralité
publique, la Cour serait en réalité difficilement capable de faire face à une
augmentation significative de son contentieux. Or, le projet de réforme de la
Cour, transmis le 16 juillet 1996 au Premier Ministre, au Garde des Sceaux et au
Ministre de l’Economie et des Finances, qui allait dans le sens d’une plus
grande célérité de la juridiction en prévoyant notamment une augmentation du
nombre de membres, la création de sections, l’élargissement du vivier des
rapporteurs, n’a pas connu d’aboutissement.
•
La possibilité d’un cumul des sanctions prononcées par la Cour avec les
sanctions de nature pénale ou disciplinaire pourrait de la même façon s’avérer
problématique.
La possibilité d’un tel cumul était fondée sur le caractère sui
generis des sanctions budgétaires et par l’autonomie reconnue à la procédure
devant la Cour. La qualification de sanction à caractère pénal au sens de
l’article 6 de la CEDH n’a certes pas d’incidence directe en raison de
l’autonomie de la définition de la matière pénale en droit européen ;
elle rend cependant plus pressantes les interrogations sur la pertinence et la légitimité
d’un tel cumul. On doit toutefois
souligner que la possibilité d’un cumul de sanctions joue un rôle irremplaçable
lorsqu’il s’agit de définir la place et la fonction de la Cour de
discipline budgétaire. La vocation de la sanction prononcée par la CDBF
n’est pas en effet de se substituer à une autre répression, mais de
souligner la gravité d’une faute et de caractériser clairement l’existence
d’une violation du droit budgétaire. C’est pourquoi le niveau des amendes
susceptibles d’être prononcées est relativement modeste et les sanctions
effectivement prononcées en général modérées. La répression de
l’infraction budgétaire vise à l’exemplarité, non à l’exclusivité ;
elle se veut complémentaire et non redondante.
•
La problématique du respect des
droits de la défense et des principes issue de l’article 6 de la Convention
est aujourd’hui au cœur du débat. A la lumière de ces préoccupations il ne
semble pas possible de faire l’économie d’une réflexion sur
l’organisation d’une juridiction dont la crise identitaire est avérée.
Inversement on ne comprendrait pas que la question du respect de la Convention
européenne ne soit pas abordée si l’on entend penser la réforme des
institutions de contrôle des finances publiques que sont la Cour des comptes et
la Cour de discipline budgétaire et financière. Gilbert Orsoni évoquait à la suite de l’affaire Labor
Metal la possibilité d’un « autre mode
de fonctionnement » de la Cour des comptes dont les membres seraient spécialisés
dans la gestion de fait et resteraient extérieurs à la délibération sur le
rapport public. Pourquoi ne pas envisager une intégration complète de la CDBF
au sein de la Cour des comptes, comme chambre spécifiquement chargée de la répression
des irrégularités commise par les ordonnateurs ? Le premier Procureur général
de la Cour des comptes, s’est déclaré publiquement favorable à l’intégration
pure et simple de la Cour de discipline budgétaire et financière à la Cour
des comptes, et ses propos ont été relayés par le premier président Joxe
lors d’une audition devant la représentation nationale. Il est vrai que le
maintien d’une juridiction formellement distincte de la Cour des comptes
contribue à un alourdissement souvent injustifié des procédures. C’est
notamment le cas lorsque, comme en l’espèce, la saisine de la Cour de
discipline budgétaire et financière intervient après une procédure qui
s’est conclue par une déclaration de gestion de fait.
B
• L’incidence de la CEDH sur le jugement des comptes reste plus incertaine
L’intervention
de la décision Guisset clarifie la
situation de la Cour de discipline budgétaire et financière. La question de
l’applicabilité de l’article 6 au jugement des comptes des comptables
publics, patents ou de fait, reste en revanche entière.
L’exclusion
de principe de l’applicabilité de l’article 6 à la procédure de jugement
des comptes est maintenue par les juridictions françaises. L’exclusion de la
procédure de jugement des comptes du champ d’application de l’article 6 de
la Convention européenne peut se prévaloir de solides justifications. Le juge
des comptes ne juge pas selon une formule bien connue le comptable, mais le
compte. Cela signifie que la mise en cause de la responsabilité du comptable
s’effectue selon un mécanisme de responsabilité objective qui ne laisse
aucune place, au niveau juridictionnel tout au moins, à la prise en considération
du comportement personnel du comptable
Le juge des comptes « ne peut légalement fonder les décisions qu’[il]
rend dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle que sur les éléments
matériels des comptes soumis à son contrôle, à l’exclusion notamment de
toute appréciation du comportement personnel des intéressés »
C’est pourquoi le Conseil d’Etat continue d’exclure l’applicabilité de
l’article 6 aux procédures de jugement des comptes du comptable patents comme
de fait : « La Cour des comptes, lorsqu’elle juge les comptes des
comptables publics, en vertu de l’article 1er de la loi du (…) 22
juin 1967, ne statue pas en matière pénale et ne statue pas sur des
obligations à caractère civil ».
Cette
exclusion, fermement maintenue par les juridictions françaises, entend trouver un
certain appui sur la position des organes de Strasbourg. Dans l’affaire Muyldermans
c/ Belgique,
le rapport de la Commission avait posé le principe d’une distinction entre
liquidation des comptes et jugement de l’action du comptable, laissant
entendre « qu’une contestation relative à la liquidation du compte
d’un comptable en tant que tel ne tomberait pas en principe dans le champ
d’application de l’article 6 de la Convention »
Dans cette affaire, la Cour ne concluait pas à l’applicabilité de
l’article 6, mais seulement parce que la Cour des comptes belge tenait compte
du comportement personnel du comptable pour apprécier l’étendue de sa
responsabilité.
On
assiste néanmoins à une relativisation progressive mais certaine de la portée
de cette exclusion dont on peut se demander si elle ne porte pas en germe une
« normalisation » complète de la procédure de jugement des comptes
publics, au risque peut-être d’accroître la « coloration pénale »
du contrôle juridictionnel des finances publiques qui pourrait perdre sa
singularité.
•
L’extension aux amendes prononcées contre les comptables de fait
Les
amendes prononcées par les Chambres régionales des comptes et la Cour des
comptes à l'encontre des comptables de fait ne pouvaient faire l'objet d'un
traitement différent au regard de l'article 6 de la Convention de celui des
amendes encourues devant la Cour de discipline budgétaire et financière.
L'article L.313-14 du Code des juridictions financières prévoit en effet
expressément que ces sanctions ont des caractères identiques. Aussi le Conseil
d'Etat a-t-il logiquement estimé dans l'affaire SARL Deltana Perrin que le juge
financier statue sur le bien-fondé d'accusations en matière pénale lorsqu'il
prononce la condamnation d'un comptable de fait à une amende. Fort opportunément
les décrets n° 95-945 du 23 août 1995 et 96-334 du 18 avril 1996 ont imposé
la publicité des séances au cours desquelles la Cour et les Chambres régionales
des comptes statuent à titre définitif sur une amende.
Fort
opportunément, les décrets n° 95-945 du 23 août 1995 et 96-334 du 18 avril
1996 ont imposé la publicité des séances au cours desquelles la Cour et les
Chambres régionales des comptes statuent à titre définitif sur une amende.
•
L’extension indirecte à la déclaration de gestion de fait
Relative
à une affaire de gestion de fait, la décision d’assemblée, société
Labor Métal du 23 février 2000 a amené le
Conseil d’Etat à remettre en cause « l’impartialité structurelle »
de la Cour des comptes dans des termes identiques à ceux employés par la Cour
européenne de Strasbourg dans l’affaire Procola.
La haute juridiction administrative s’est fondée non directement sur
l’article 6 de la Convention, mais sur les principes généraux des droits de
la défense. Ce faisant, le juge administratif confirme la solution de principe
rappelée quelques années auparavant dans la décision Nucci
du 6 janvier 1995 :
l’inapplicabilité en matière de gestion de fait de l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’Homme, pour la tempérer aussitôt par
une application indirecte, à travers la référence aux principes
d’impartialité et au respect des droits de la défense.
En réalité, si l’article 6 demeure formellement inapplicable à la
procédure conduisant à la déclaration de gestion de fait, il n’en est pas
moins matériellement très largement appliqué par l’appel à des
principes qui empruntent comme on a pu le constater dans la décision Labor
Metal jusqu’à leur formulation, aux arrêts
de la Cour européenne de Strasbourg. C’est pourquoi il peut paraître assez
vain de distinguer, en l’état de la jurisprudence, le prononcé des amendes
pour lequel l’article 6 est reconnu applicable, du reste de la procédure.
Cette solution semble résumer à elle seule toute l’ambiguïté de la notion
de gestion de fait, dont le caractère répressif fait question. La « coloration
pénale »
de l’ensemble de la matière est assez évidente, puisque au contraire du
jugement des comptes du comptable patent, la déclaration de gestion de fait
implique de la part du juge une appréciation du comportement de la personne
poursuivie.
•
L’extension possible au jugement des comptes du comptable patent.
Le
contrôle de régularité des opérations financières publiques repose en
France sur un principe, celui de la séparation des ordonnateurs et des
comptables. Le régime de responsabilité objective et illimité des comptables
publics constitue le corollaire de ce principe. Cette responsabilité est basée
sur une logique qui n’est pas une logique de sanction mais une logique de
garantie. Un certain nombre d’éléments permettent cependant de nuancer la
singularité de la responsabilité du comptable public et la rapprochent d’un
mécanisme de sanction. En premier lieu, on doit constater que le caractère
objectif et automatique de la sanction n’est pas exclusif de l’idée de
faute du comptable puisque celui-ci sera déchargé de sa responsabilité s’il
établit qu’il n’a pas commis de faute. Surtout, la possibilité, largement
employée en pratique, d’atténuation ou d’exonération a posteriori,
en particulier à travers des remises gracieuses en faveur du comptable prononcées
par le Ministre des finances, conduit en réalité à une appréciation de son
comportement et de la gravité de son manquement. Mais s’agissant du comptable
patent, c’est surtout la qualification de sa responsabilité au regard de la
notion de contestation portant sur des droits et obligations à caractère civil
qui, comme dans l’affaire Muyldermans,
pose problème, dans la mesure où la mise en cause de la responsabilité du
comptable entraîne pour lui des conséquences patrimoniales évidentes et
importantes.
La
singularité du contrôle juridictionnel des finances publiques continue d’être
l’une des raisons de son efficacité ; ce contrôle a su maintenir une
identité et une logique propre. Si des avancées dans le sens d’une meilleure
prise en compte des droits de la défense et du respect des libertés
individuelles paraissent tout à fait favorables, on peut en revanche exprimer
quelques réserves quant à la mise en avant inconditionnelle de la dimension répressive
dans le contrôle des finances publiques. D’autant plus que si la référence
à l’article 6 de la Convention est en principe favorable à la personne
poursuivie, la reconnaissance de la dimension répressive des procédures
n’est pas dépourvue d’ambiguïtés. L’application n’en est pas nécessairement
plus protectrice et la décision Guisset
en fournit un exemple s’agissant de la publicité des audiences, susceptible
dans de nombreux cas de s’avérer autrement plus préjudiciable à la personne
poursuivie que les amendes susceptibles d’être prononcées par cette
juridiction et dont le niveau reste relativement modeste.
CE 25 juin 1948 Brillaud,
Rec., p.292, D1949, somm, p. 21 « la publicité n’est exigée devant
les juridictions administratives qu’à la condition qu’un texte législatif
ou réglementaire impose cette règle de procédure ».
|
|
Débats
Michele
DE SALVIA
Si
j’ai bien compris, la Cour n’a pas suivi la jurisprudence du Conseil d’Etat...
Les
quatre interventions auxquelles nous venons d’assister soulignent la technicité
du travail de la Cour et la France n’est qu’un pays parmi 41 Etats.
Me
Michel PUECHAVY
Je
voudrais apporter une précision à propos de l’affaire Morel dans laquelle j’étais l’avocat du requérant. Je n’ai
jamais dit à l’audience que l’article 36 de la loi du 25 janvier 1985 n’était
pas applicable. Il est vrai que dans l’arrêt, il est écrit que l’agent du
gouvernement a soulevé, pour la première fois à l’audience, une erreur de
plume dans la rédaction du jugement du Tribunal
de commerce qui viserait à tort l’article 36. C’est un moyen qui a
été soulevé à la dernière minute et auquel je n’ai pas pu répondre. Mme Tulkens
m’avait demandé si l’article 61 de la même loi était applicable en
l’espèce. Oui, parce qu’il s’agissait d’un plan de redressement présenté
par le requérant, l’article 61 était donc bien applicable. En revanche,
contrairement à ce que dit la Cour et ce que laisserait entendre votre analyse,
l’article 36 s’appliquait également car lorsqu’un plan de redressement
est refusé par le Tribunal de commerce, on tombe automatiquement dans une procédure
de liquidation judiciaire et, dans ce cas, l’article 36 s’applique. Tous les
arrêts de la Cour de cassation, dans des affaires impliquant le rejet d’un
plan de continuation et la conversion en liquidation judiciaire, visent
l’article 36 de la loi. Monsieur Derrida est du même avis et il est un éminent
spécialiste des procédures collectives.
Or,
aux termes de l’article 36 un rapport doit être présenté par le
juge-commissaire et ce rapport est visé à juste raison dans le jugement. M.
Morel avait sollicité la communication de ce rapport au Président du Tribunal
qui lui a refusé au motif qu’il était enfermé « dans le secret du délibéré ».
Ni la Cour d’appel ni la Cour de cassation n’ont contesté l’existence de
ce rapport, cette juridiction ayant considéré que le rapport était oral. Mais
dès lors qu’un document fait l’objet d’un visa, il est difficile
d’admettre qu’il est oral ! Or, que l’agent du gouvernement vienne
nous dire à l’audience qu’il s’agit d’une erreur de plume alors que le
principe du respect du contradictoire est en cause, n’est pas digne d’un débat
de ce niveau (ce n’est pas la première fois qu’un agent du gouvernement
nous fait le coup à l’audience). J’estime beaucoup M. Ronny Abraham qui
effectue un travail considérable pour la défense des droits fondamentaux, mais
la moindre des choses, c’est de permettre à l’adversaire de répondre à un
argument soulevé à l’audience. J’ai fait une demande de renvoi devant la
Grande Chambre qui malheureusement a été rejetée. Il n’y a donc pas eu
erreur de droit du requérant comme le prétend la Cour qui a trouvé ainsi le
moyen de liquider purement et simplement la question pour s’en débarrasser.
C’est, comme vous l’avez dit, un « arrêt d’accident »
Marie-Laure
NIBOYET
Et
malheureux pour l’intéressé...
Me
Michel PUECHAVY
Un
mot sur l’impartialité : Monsieur Morel, qui se défendait lui-même devant
le Tribunal de commerce de Nanterre est une personnalité difficile qui avait présenté
de nombreuses requêtes. Il existait une animosité entre lui et le
juge-commissaire. Celui-ci —et cela ne ressort pas des pièces du dossier— a
volontairement liquidé son affaire par des licenciements, par la vente
d’immeubles alors qu’il était possible de poursuivre l’exploitation.
Monsieur Morel s’est trouvé démuni et la liquidation ne pouvait qu’être
prononcée. Donc, il y avait manifestement une volonté délibérée de mettre
fin à l’activité de la société de Monsieur Morel qui n’apparaît pas à
la lecture des pièces, une volonté de ce juge-commissaire puisqu’ultérieurement
il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Voilà les
observations que je voulais faire et les précisions que je voulais donner parce
que quand on lit le dossier, on a une vision un peu différente...
Marie-Laure
NIBOYET
Je
suis ravie de votre présence et de pouvoir engager une discussion avec vous car
je peux vous dire que je me suis véritablement arrachée les cheveux pour
essayer de démêler l’exactitude des faits dans cette affaire. Sur le premier
point, la question du rapport, il y a une contradiction entre ce qu’a dit la
Cour de cassation en 1996, puisqu’elle a estimé que de toute façon ce
rapport pouvait être présenté oralement et que rien ne démontrait qu’il ne
l’avait pas été (ce qui était une façon de présumer que la formalité
avait été accomplie), et ce qu'a soutenu le gouvernement devant la Cour de
Strasbourg en considérant que, puisque ce n’était pas une hypothèse dans
laquelle le rapport était obligatoire, on pouvait même imaginer que le rapport
n'ait pas été présenté à l’audience, mais qu'il ait été couvert par le
secret du délibéré. Je crois que vous aviez fait une demande de communication
du rapport qui a été rejetée par le tribunal au nom du respect de ce secret
du délibéré. Personnellement, et c’est ce que j’ai essayé de démontrer,
je crois que la confusion la plus grande règne sur la question de savoir quand
le rapport est obligatoire ou non. Je suit tout à fait d’accord avec vous.
La
critique qu’il faut adresser, au-delà du cas particulier de l’affaire Morel,
c’est une critique du droit français. La jurisprudence décide qu’en toute
hypothèse (article 36 ou autre), le rapport peut être présenté oralement à
l’audience, mais encore faudrait-il s’assurer que ce rapport a été présenté
et qu’il y a effectivement un débat contradictoire sur le rapport. Je
n’arrive pas à comprendre comment on peut tolérer que la loi impose un
rapport sans permettre le contrôle du respect de cette formalité par le juge
d'appel, et même, pourquoi pas, la Cour de cassation si elle était saisie de
cette question précise de la forme en laquelle le rapport doit être présenté.
Il y a une atteinte au principe de contradiction, et je suis tout à fait
d’accord avec vous. Pour ce qui est de l’impartialité subjective, là je
n’ai absolument rien à dire, puisque cela dépend de faits qui échappent à
ma connaissance.
Michèle
DUBROCARD
Je
voudrais apporter quelques précisions concernant cette affaire. J’étais
moi-même présente à l’audience. C’est un dossier que j’ai
personnellement suivi dans les services de l’agent du gouvernement, en
collaboration d’ailleurs étroite avec le ministère de la Justice. Il n’y a
pas eu de « coup » de la part de l’agent du gouvernement à
l’audience mais tout simplement, vous venez de le dire, les faits étaient
extrêmement complexes. Il était très difficile de comprendre les tenants et
les aboutissants de l’affaire, et nous avons pensé avec toute notre
conscience, in fine, qu’en réalité
l’explication à cette confusion résultait effectivement d’une erreur
commise par les rédacteurs du jugement du tribunal de commerce. Il nous a semblé
que tout prenait un sens plus éclairé, dès lors qu’on s’appuyait sur
l’article 61 et non plus sur l’article 36. Je vous laisse maintenant libres
de penser le contraire, et de considérer qu’en réalité c’était bien
l’article 36 qui s’appliquait, mais nous avons pensé, nous, in
fine, après avoir vu et revu l’affaire, au moment de l’audience, que
c’était l’explication la plus plausible. Il n’y a donc pas eu de
recherche délibérée de faire un « coup » ou un « effet de
manche » à l’audience. Pas du tout. A nous-mêmes notre vérité nous
est apparue très tardivement. Par ailleurs, je rappellerai qu’à l’audience
devant la Cour européenne des droits de l’Homme, on laisse toujours la
possibilité aux parties de répliquer aux arguments de l’adversaire.
|
|
Le
champ d’application de l’article 6 CEDH en matière d'éloignement des étrangers
Le
cas de l'interdiction du territoire :
l’affaire
Maaouia (5 octobre 2000)
par
Gilbert
Bitti
Service
des affaires européennes et internationales, ministère de la Justice
Conseil du Gouvernement devant la Cour européenne des droits de l'Homme
Au
ministère de la Justice nous sommes chargés des affaires judiciaires et nous
préparons les mémoires pour le ministère de la Justice. Ces mémoires sont
ensuite envoyés au ministère des Affaires Etrangères qui est l’agent du
gouvernement français, le ministère de la Justice ayant la qualité de
conseil.
Introduction
• Faits et procédure devant les
juridictions internes
Le
requérant, M. Nouri Maaouia est un citoyen tunisien né le 1er mai
1958 en Tunisie. Il vit en France depuis 1980.
Le
1er décembre 1988, il est condamné par la Cour d’assises des
Alpes-Maritimes à la peine de six années de réclusion criminelle pour vol
avec arme et violences volontaires avec arme suivies d’une incapacité supérieure
à huit jours, pour des faits remontant à 1985. Il est mis en liberté le 14
avril 1990.
Le
8 août 1991, le Ministre de l’Intérieur prend un arrêté d’expulsion à
l’encontre de M. Maaouia, en se fondant sur l’avis favorable de la
Commission prévue à l’article 24 de l’ordonnance de 1945 rendu le 30
janvier 1991, après avoir constaté que le requérant a commis un vol avec port
d’arme et des violences volontaires à l’aide ou sous la menace d’une arme
et que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour
l’ordre public.
Le
14 septembre 1992, le requérant se marie avec une ressortissante française,
invalide à 80%. Celle-ci a la charge d’une petite fille abandonnée par sa mère
et auprès de laquelle M. Maaouia joue un rôle important notamment d’un point
de vue financier.
Le
7 octobre 1992, l’arrêté d’expulsion du 8 août 1991 est notifié à M.
Maaouia qui s’est rendu à la Préfecture des Alpes Maritimes pour solliciter
la régularisation de sa situation. Cette notification est suivie d’une
sommation d’embarquer pour la Tunisie le 9 octobre 1992.
Le
9 octobre 1992, présenté à l’embarquement d’un vol à destination de
Tunis, le requérant refuse de se soumettre à l’exécution de l’arrêté
d’expulsion du 8 août 1991.
Ces
faits vont en fait entraîner de multiples contentieux que l’on va ici résumer
du fait de leur complexité.
Le
refus de M. Maaouia d’embarquer dans le vol à destination de Tunis entraîne
des poursuites pénales à son encontre pour soustraction à l’exécution
d’un arrêté d’expulsion. Le 19 novembre 1992, le tribunal correctionnel de
Nice le condamne à un an d’emprisonnement ferme et à dix ans
d’interdiction du territoire français pour s’être soustrait à l’exécution
de l’arrêté d’expulsion du 8 août 1991. C’est cette condamnation à dix
d’interdiction du territoire français qui va donner lieu au contentieux
devant la Cour européenne des droits de l’Homme. M. Maaouia et le ministère
public interjettent appel de ce jugement devant la Cour d’appel
d’Aix-en-Provence respectivement les 23 et 25 novembre 1992.
Remis
en liberté par cette Cour d’appel le 23 mars 1993, M. Maaouia soutient à
l’audience du 5 avril 1993 qu’il est marié à une ressortissante française,
que sa femme souffre d’un grave état dépressif et qu’il a reconnu sa
petite fille âgée de 4 ans, actuellement confiée à sa grand-mère.
Par
arrêt du 7 juin 1993, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, après avoir relevé
que le requérant « reconnaît n’avoir pas ignoré que la commission spéciale
des expulsions des étrangers s’était réunie le 30 janvier 1991 sur son cas », confirme le jugement du tribunal correctionnel de Nice et décerne
mandat de dépôt à son encontre.
Le
9 juin 1993, M. Maaouia forme un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt
de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Par arrêt du 1er juin
1994, la Cour de cassation rejette le pourvoi du requérant au motif « qu’il
ne résulte ni du jugement entrepris ni d’aucunes conclusions régulièrement
déposées, que M. Maaouia ait, devant les premiers juges, avant toute défense
au fond, présenté une exception d’illégalité visant l’arrêté
d’expulsion pris contre lui ».
Entre-temps,
par ordonnance du 27 août 1993, le président du Tribunal de grande instance,
saisi par le Préfet des Bouches-du-Rhône, constatant que la condamnation pénale
qui a conduit au prononcé de l’interdiction du territoire du requérant a
fait l’objet d’un pourvoi toujours pendant devant la Cour de cassation et
que le tribunal administratif est d’autre part saisi d’une requête en
annulation de l’arrêté d’expulsion du 8 août 1991, assigne M. Maaouia à
résidence.
En
effet, le 7 décembre 1992, le greffe du tribunal administratif de Nice a
enregistré une requête présentée au nom de M. Maaouia, tendant à
l’annulation de l’arrêté d’expulsion pris par le Ministre de l’Intérieur
le 8 août 1991.
Par
jugement du 14 février 1994, le tribunal administratif annule l’arrêté
d’expulsion du 8 août 1991 au motif « qu’aux termes de l’article 23
de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l’entrée et au séjour
des étrangers en France l’expulsion peut être prononcée par arrêté du
ministre de l’intérieur si la présence sur le territoire français d’un étranger
constitue une menace grave pour l’ordre public ; que d’après
l’article 24 de la même ordonnance l’expulsion ne peut être prononcée que
si l’étranger a été préalablement avisé et s’il a été convoqué par
une commission siégeant sur convocation du préfet ; considérant que le
requérant n’a jamais reçu la convocation devant la commission et qu’il
n’a pu de ce fait être entendu par ladite commission ; considérant que
mise en demeure de produire en défense par le président du tribunal
administratif le 24 juin 1993, le ministre de l’intérieur n’a pas déféré
à cette demande et est censé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant ;
qu’ainsi faute pour l’administration d’avoir régulièrement convoqué M.
Maaouia devant ladite commission le requérant a été privé de la possibilité
de présenter ses arguments, qu’ainsi l’arrêté en date du 8 août 1991 du
ministre de l’intérieur est entaché d’un vice de procédure et doit de ce
fait être annulé ».
Le
14 mars 1994, le jugement d’annulation de l’arrêté du 8 août 1991 est
notifié au Ministre de l’Intérieur et à M. Maaouia.
Fort
du jugement du Tribunal administratif de Nice, le conseil de M. Maaouia saisit
le 12 août 1994 le Procureur général près la Cour d’appel
d’Aix-en-Provence d’une requête en relèvement de l’interdiction du
territoire national pour dix ans, prononcée par le tribunal correctionnel de
Nice le 19 novembre 1992, faisant valoir notamment qu’il est marié à une
française. C’est la longueur de cette procédure en relèvement du territoire
français qui va être mise en cause devant la Cour européenne.
En
effet, par courrier du 6 juillet 1995, le conseil de M. Maaouia rappelle au
Procureur général près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence les termes de sa
demande en relèvement de l’interdiction du territoire présentée dans sa
requête du 12 août 1994 et sollicite l’audiencement de l’affaire.
Par
courrier du 12 juillet 1995, le Procureur général près la Cour d’appel
d’Aix-en-Provence sollicite du procureur de la République près le Tribunal
de grande instance de Nice qu’il lui communique son avis sur le mérite de la
requête de M. Maaouia tendant au relèvement de son interdiction du territoire
national et qu’il lui fasse parvenir les renseignements utiles sur la
situation actuelle de ce dernier, ainsi que toutes observations de nature à
permettre à la cour d’apprécier la suite à donner à cette demande. Le même
jour, le Procureur général près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence informe
le conseil de M. Maaouia de son intention d’adresser sans délai un rappel aux
autorités administratives concernant l’enquête sur la situation de son
client et de l’aviser rapidement de la date d’audience.
Le
19 septembre 1995, à la suite des instructions du procureur de la République
près le Tribunal de grande instance de Nice, en date du 20 juillet 1995,
l’adjoint administratif du commissariat central de Nice fait parvenir les résultats
de l’enquête effectuée au sujet de M. Maaouia.
Le
9 octobre 1997, le conseil du requérant adresse un nouveau courrier au
Procureur général près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence lui rappelant
d’une part, le préjudice subi par M. Maaouia qui se voit refuser la régularisation
de sa situation du fait de l’existence de l’interdiction du territoire
national et, d’autre part, les démarches effectuées ces deux dernières années
aux fins de voir l’affaire enfin audiencée. Il sollicite à nouveau l’audiencement
de l’affaire.
Le
17 octobre 1997, le Procureur général près la Cour d’appel d’Aix-en-provence
sollicite de la direction de la réglementation de la police générale à Nice
son avis sur le mérite de la requête introduite par M. Maouia le 12 août
1994. Par courrier du 27 octobre 1997, le Préfet des Alpes Maritimes, répondant
à cette demande, fait savoir au Procureur général que M. Maaouia était
inconnu de ses services.
Par
courrier du 3 novembre 1997, le Procureur général près la Cour d’appel
d’Aix-en-Provence fait savoir au conseil de M. Maaouia que l’affaire est
appelée à l’audience du 26 janvier 1998. Le même jour, il sollicite du Préfet
des Alpes Maritimes son avis sur le mérite de la requête de M. Maaouia et dépose
ses réquisitions en faveur du relèvement de l’interdiction du territoire
national.
Le
6 novembre 1997, le Procureur général demande au greffier du tribunal
administratif de Nice de lui confirmer le caractère définitif de la décision
du 14 février 1994 portant annulation de l’arrêté d’expulsion du 8 août
1991.
Par
courrier du 13 novembre 1997, le Préfet des Alpes Maritimes en réponse à la
sollicitation du Procureur général du 3 novembre 1997, fait savoir qu’il est
favorable au maintien de la mesure d’interdiction du territoire, compte tenu
des faits qui l’ont motivée, à savoir la soustraction à l’exécution de
l’arrêté d’expulsion.
Le
25 novembre 1997, le greffier du tribunal administratif de Nice confirme le
caractère définitif du jugement du 14 février 1994.
Le
7 janvier 1998, le conseil de M. Maaouia dépose au greffe de la Cour d’appel
d’Aix-en-Provence ses conclusions en vue de l’audience du 26 janvier 1998.
Par
arrêt du 26 janvier 1998, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence fait droit à
la demande du requérant et ordonne le relèvement de l’interdiction du
territoire, aux motifs que par jugement définitif du 14 février 1994, le
Tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté d’expulsion du 8 août
1991.
Le
requérant va également déposer de nombreuses demandes et recours devant le Préfet
des Alpes Maritimes et le Tribunal administratif de Nice aux fins d’obtenir la
régularisation de sa situation. Celle-ci n’interviendra qu’au mois de
juillet 1998.
Il
dépose également le 19 juillet 1994 une demande en révision de l’arrêt du
7 juin 1993 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui sera accueillie le 19 février
1996 par la commission de révision des condamnations pénales mais finalement
rejetée par la chambre criminelle de la Cour de cassation, siégeant comme cour
de révision, le 28 avril 1997.
• Procédure devant les organes de
Strasbourg
Dès
le 30 décembre 1997, le requérant a introduit devant la Commission européenne
des droits de l’Homme, en application de l’ancien article 25 de la
Convention, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du
Protocole n° 11, une requête contre la France, estimant que sa cause n’avait
pas été entendue dans un délai raisonnable.
Cette
requête a été transmise à la Cour européenne le 1er novembre
1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n˚ 11, en application de
l’article 5 paragraphe 2 de ce Protocole, et a été distribuée à la troisième
Chambre de la Cour européenne. Par une décision du 12 janvier 1999, celle-ci
a, à l’unanimité, décidé d’ajourner l’examen du grief concernant la
durée de la procédure en relèvement de l’interdiction du territoire français
et déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Il
convient de souligner que dans ses observations, le Gouvernement français a
soulevé à titre principal l’irrecevabilité ratione
materiae de la requête présentée par M. Maaouia, en raison de
l’inapplicabilité de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’Homme aux procédures en relèvement de l’interdiction du
territoire national. En revanche, en ce qui concerne la durée de cette procédure,
le Gouvernement n’a pas contesté son caractère excessif, s’en remettant
ainsi « à la sagesse de la Cour » sur le fond du grief. Ainsi, la
seule question débattue dans cette affaire était l’applicabilité de
l’article 6.
Eu
égard à l’importance de la question, et sans doute aussi à la nécessité
pour la nouvelle Cour de fixer rapidement sa jurisprudence sur ce point, la
troisième Chambre a décidé le 1er février 2000 de se dessaisir de
l’affaire au profit de la Grande Chambre de la Cour européenne, aucune des
deux parties ne s’y étant opposée conformément à l’article 30 de la
Convention. La Grande Chambre a rendu sa décision finale sur la recevabilité
le 22 mars 2000, déclarant à l’unanimité la requête recevable, tous moyens
de fond réservés, y compris bien entendu la question de l’applicabilité de
l’article 6 de la Convention.
Par
courrier du 13 avril 2000, le Gouvernement a sollicité une audience dans cette
affaire en application de l’article 59 paragraphe 2 du Règlement intérieur
de la Cour. Cette audience a eu lieu le 5 juillet 2000. Par arrêt du 5 octobre
2000, la Grande Chambre de la Cour européenne, par 15 voix contre 2, a décidé
que l’article 6 de la Convention n’était pas applicable. La motivation de
l’arrêt semble avoir donné lieu à une discussion difficile entre les juges
puisque 5 juges faisant partie de la majorité ont cependant voulu exprimer leur
opinion de manière séparée.
L’applicabilité
de l’article 6 étant le seul problème soulevé en l’espèce, on
s’interrogera successivement sur le fait de savoir si la procédure en relèvement
du territoire français pouvait être considérée comme impliquant une décision
sur des droits et obligations de caractère civil (I) ou sur le bien-fondé
d’une accusation en matière pénale (II).
I • Droits et obligations de caractère
civil
Il
n’était pas contestable, et le Gouvernement français ne le contestait
d’ailleurs pas, qu’il existait en l’espèce une contestation qui portait
sur un droit. Ceci est une condition sine qua non de l’application de
l’article 6 (dans son volet « civil »).
En l’espèce, d’une part il existait bien une contestation puisque le requérant
estimait que compte tenu de l’annulation de l’arrêté d’expulsion, sa
condamnation pénale à une interdiction du territoire français pour
insoumission à cet arrêté était infondée, d’autre part cette contestation
portait sur un droit, puisqu’en application des articles 702-1 et 703 du Code
de procédure pénale, le requérant avait effectivement le droit de demander le
relèvement de son interdiction du territoire.
Toute
la question portait sur le caractère civil du droit en cause. En effet, pour
que l’article 6 de la convention soit applicable, il fallait démontrer que la
procédure était déterminante pour un droit de caractère civil et non pas
simplement qu’elle pouvait avoir des répercussions sur un tel droit.
Le
Gouvernement français, rappelant la jurisprudence constante de la Commission
européenne des droits de l’Homme, soutenait que les procédures relatives à
l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers échappaient au
champ d’application de l’article 6 de la Convention, dans son volet civil,
puisque les actes contestés à l’occasion de telles procédures étaient des
actes régis par le droit public et manifestaient l’exercice de prérogatives
de puissance publique.
Et même si le requérant faisait valoir que la contestation relative à son éloignement
comportait des conséquences quant au respect de l’un de ses droits de caractère
civil, à savoir le droit au respect de sa vie familiale, les dispositions de
l’article 6 de la Convention ne pouvaient être tenues pour applicables.
En
l’espèce, en introduisant une demande en relèvement de sa condamnation à
une interdiction du territoire, le requérant sollicitait essentiellement des
juridictions répressives qu’elles reviennent sur la sanction initiale
qu’elles avaient prononcée : le simple fait que la mesure
d’interdiction du territoire, et donc son éventuel relèvement, pouvait avoir
des conséquences sur sa vie familiale, ne pouvait conduire la Cour européenne
à conclure que l’objet principal de la procédure revêtait un caractère
civil.
L’arrêt
rendu par la Grande Chambre de la Cour européenne sur ce point est intéressant
à un double titre : il permet tout d’abord de voir comment la nouvelle
Cour tente d’affirmer sa « différence » par rapport aux « anciens »
organes de la Convention européenne, à savoir l’ancienne Cour et la défunte
Commission européenne ; il permet ensuite de voir les faiblesses de la
motivation de la Cour européenne qui marque sa différence de manière
maladroite.
Les
paragraphes 34 et 35 de l’arrêt contiennent ici deux réflexions intéressantes
qui démontrent que la nouvelle Cour européenne permanente veut exercer un
droit d’inventaire sur la jurisprudence que les organes de Strasbourg ont
constitué pendant plus de 40 années. Tout d’abord au paragraphe 34, la
nouvelle Cour rappelle la jurisprudence traditionnelle de l’ancienne Cour sur
l’autonomie des notions de « droits et obligations de caractère civil »
ou « bien-fondé d’une accusation pénale » pour conclure par
cette phrase « la Cour confirme cette jurisprudence en l’espèce ». On ne
peut pas être plus clair mais en revanche on peut se demander d’où la
nouvelle Cour européenne tire ce droit d’inventaire qu’elle s’octroie et
qui n’est pas sans créer une certaine incertitude juridique :
faudra-t-il attendre des confirmations sur tous les arrêts rendus par
l’ancienne Cour européenne ? Il aurait été sans doute plus judicieux
de faire évoluer la jurisprudence de l’ancienne Cour européenne, sans
affirmer haut et fort cette volonté de s’affranchir du passé.
Par
ailleurs, on semble détecter une véritable méfiance à l’égard de la
Commission européenne puisque d’emblée au paragraphe 35, il est précisé
que la Cour ne s’est jamais prononcée sur la question de l’applicabilité
de l’article 6 paragraphe 1 aux procédures d’expulsion d’étrangers. Suit
cette petite phrase assassine : « La Commission, quant à elle
( !), a toujours considéré que la décision d’autoriser ou non un étranger
à rester dans un pays dont il n’est pas ressortissant n’impliquait aucune décision
sur ses droits et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d’une
accusation pénale dirigée contre lui, au sens de l’article 6 paragraphe 1 de
la Convention ». La Cour européenne ne reprend pas dans ce paragraphe la
motivation de la Commission européenne, pour la bonne et simple raison que dans
les paragraphes 36 à 38 de son arrêt, la Cour européenne décide de justifier
sa décision par une motivation bien différente et de notre point de vue bien
moins convaincante que celle de la défunte Commission européenne des droits de
l’Homme.
En
effet, pour la nouvelle Cour européenne, la raison de la non-application de
l’article 6 paragraphe 1 ne réside pas dans le fait que les mesures d’éloignement
des étrangers relèvent de l’exercice de prérogatives de puissance publique,
mais dans le fait qu’en adoptant 34 ans après l’article 6 de la Convention,
l’article 1er du Protocole n° 7, les Etats ont ainsi voulu
restreindre le champ d’application de l’article 6, ce qui est pour le moins
une drôle de façon de vouloir adopter de nouvelles mesures visant à assurer
la garantie collective des droits de l’Homme si l’on en croit le préambule
de ce Protocole n° 7.
Il
est en effet incompréhensible de vouloir justifier une restriction au champ
d’application d’un article de la Convention par un texte bien postérieur à
la Convention et qui en vertu de son propre article 7 constitue des articles
additionnels à la Convention. C’est ce qu’affirme le Juge Loucaides
dans son opinion dissidente : « Les
Protocoles ajoutent aux droits des individus. Ils ne les restreignent pas ni ne
les abolissent ».
On
ne peut qu’approuver cette opinion empreinte d’une logique évidente. Il est
regrettable que la nouvelle Cour européenne ait manifestement voulu ici faire
preuve d’originalité vis-à-vis de la jurisprudence fournie de la Commission
européenne. Il est encore plus regrettable qu’elle ait voulu exercer son
droit d’inventaire à l’égard de l’ancienne Cour européenne en
contredisant la jurisprudence Burghartz.
Dans cette affaire, le Gouvernement suisse contestait notamment l’applicabilité
de l’article 8 de la Convention au motif que depuis l’entrée en vigueur du
Protocole n° 7, l’article 5 de ce Protocole, relatif à l’égalité de
droits et de responsabilités de caractère civil entre époux, régirait seul,
en qualité de lex specialis, l’égalité
de ceux-ci dans le choix de leur nom. La Cour européenne a répondu très sèchement
à cette argumentation par une motivation de principe parfaitement justifiée :
« la
Cour souligne qu’en vertu de l’article 7 du Protocole n° 7, l’article 5
s’analyse en une clause additionnelle à la Convention et en particulier aux
articles 8 et 60. Par conséquent, il ne saurait se substituer à l’article 8
ni en réduire la portée ».
Il
aurait été préférable que la nouvelle Cour européenne des droits de l’Homme
reprenne la jurisprudence de la Commission européenne et affirme que les
mesures relatives à la police des étrangers ne relèvent pas de la matière
civile au sens de l’article 6 de la Convention, puisqu’il s’agit de
l’exercice de prérogatives de puissance publique plutôt que d’adopter une
jurisprudence qui n’a guère de sens et qui fait jouer aux Protocoles un rôle
contre-productif totalement contraire à leur vocation. C’est une arme donnée
aux Etats pour combattre l’évolution progressive de l’interprétation donnée
aux articles de la Convention par la jurisprudence de Strasbourg. On va voir que
la motivation relative à la matière pénale n’est guère plus convaincante.
II • Le bien-fondé d'une accusation
en matière pénale
Sur
ce point, le Gouvernement français présentait une double argumentation portant
d’abord sur la nature de la mesure d’interdiction du territoire français,
puis sur la décision prise par le juge en l’espèce, s’agissant d’une
requête en relèvement de la peine d’interdiction du territoire français.
En
premier lieu donc, le Gouvernement rappelait que la Commission européenne des
droits de l’Homme avait considéré que tant une mesure d’expulsion
qu’une mesure d’interdiction du territoire
ne constituait pas une peine.
En
effet, dans l’affaire Giuseppe
Renna, le requérant, qui avait été condamné par les juridictions
pénales, pour trafic de stupéfiants, à une peine d’emprisonnement assortie
d’une interdiction définitive du territoire français, invoquait les
dispositions de l’article 7 de la Convention, relatives à la non-rétroactivité
de la loi pénale. Dans sa décision la Commission européenne a affirmé que
« selon sa jurisprudence, la mesure d’expulsion consistant dans
l’interdiction définitive du territoire français doit être assimilée à
une mesure de police à laquelle le principe de non-rétroactivité énoncé à
l’article 7 de la Convention ne s’applique pas ». Elle a ajouté
« qu’une mesure d’expulsion peut être prise non seulement à la suite
d’une condamnation pénale mais également comme mesure administrative à
l’encontre de personnes dont la présence sur le territoire n’est pas
souhaitable » pour conclure que l’article 7 de la Convention n’était
pas applicable à un tel litige et déclarer le grief irrecevable.
De
manière logique, le Gouvernement français plaidait donc que dans la mesure où
les contours de la matière pénale étaient nécessairement identiques, qu’il
s’agisse d’appliquer les dispositions de l’article 7 ou celles de
l’article 6, la solution dégagée dans l’affaire Giuseppe
Renna devait valoir dans l’affaire Maaouia et donc
conduire la Cour européenne à considérer que l’article 6 paragraphe 1 ne
pouvait s’appliquer à une telle mesure de police des étrangers.
En
second lieu, et de manière nettement plus convaincante, le Gouvernement
rappelait que selon la jurisprudence constante des organes de Strasbourg, les
termes « décider du bien-fondé d’une accusation en matière pénale »
visent un processus complet d’examen de la culpabilité ou de l’innocence
d’un individu accusé d’une infraction.
Or
en l’espèce, la demande en relèvement de l’interdiction du territoire
national ne permettait pas de discuter le bien-fondé d’une accusation en matière
pénale puisqu’elle portait non pas sur la sanction elle-même mais sur son exécution.
Et en conséquence, la juridiction saisie, à savoir la Cour d’appel d’Aix-en-provence,
ne s’était nullement prononcée sur la culpabilité de M. Maaouia quant au délit
de soustraction à l’exécution d’une mesure d’expulsion, mais avait
simplement examiner la possibilité de dispenser l’intéressé de l’exécution
de la peine d’interdiction du territoire. Il suffisait d’ailleurs de noter
que le requérant n’avait plus la qualité d’accusé à l’époque de
l’introduction de sa requête, puisqu’il avait fait l’objet d’une
condamnation définitive. Le caractère définitif de cette condamnation était
d’ailleurs une condition nécessaire pour l’introduction de la demande.
Il
en résultait logiquement que la procédure de relèvement de l’interdiction
du territoire portait sur l’exécution de la sanction et non sur le bien-fondé
d’une accusation en matière pénale, l’article 6 étant en conséquence
inapplicable dans son volet pénal.
C’est
malheureusement la première partie du raisonnement que la Cour européenne va
retenir en précisant qu’à ses yeux une peine d’interdiction du territoire
français ne devait pas être considéré comme une peine. Et de manière plus
surprenante encore, la Cour européenne va utiliser l’argument du droit comparé
en retenant que l’interdiction du territoire n’est en général pas une
peine dans les Etats membres du Conseil de l’Europe.
Là
encore la motivation retenue par la Cour européenne nous paraît très déficiente :
il n’y a aucune logique à dépénaliser arbitrairement pour la soustraire à
la protection de la Convention, une mesure d'interdiction du territoire qui en
droit français est à l’évidence une peine, et plus précisément une peine
complémentaire facultative.
Le
but de la Convention, dont le préambule rappelle « la conception commune
et le commun respect des droits de l’Homme des Etats membres », mais
aussi « leur patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de
respect de la liberté et de prééminence du droit », est très
certainement d’assurer un standard minimal commun qui empêche les Etats
membres, en dépénalisant certaines infractions, de soustraire ainsi certaines
mesures aux garanties de l’article 6 de la Convention. L’article 53 de la
Convention issu du Protocole n˚ 11 réaffirme cette idée que la Convention
constitue un minimum et non un maximum. Et il est très certainement légitime
de recourir au droit comparé pour fixer ce standard minimal commun : en
revanche, le recours au droit comparé pour soustraire à la protection de
l’article 6 le prononcé d’une mesure qui devrait en bénéficier eu égard
à la qualification qu’elle reçoit en droit interne nous paraît contraire à
une protection efficace des droits de l’Homme. L’autonomie des notions
« d’accusation en matière pénale » et de « droits et obligations de caractère civil »
devrait conduire à fixer ce standard minimal commun mais certainement pas à dépénaliser
au regard de la Convention ce qu’un Etat a décidé de soumettre à son
empire, même s’il n’y était pas obligé.
Il
eût été bien préférable, comme le relève le Juge Costa dans son opinion
concordante, que la Cour retienne le second argument développé par le
Gouvernement français, à savoir que la procédure de relèvement de
l’interdiction du territoire portait sur l’exécution de la peine et non sur
le bien-fondé d’une accusation en matière pénale.
L’explication
du choix de cette motivation paraît cependant simple même s’il est très
insatisfaisant : le but de la nouvelle Cour européenne, réunie en Grande
Chambre, était bien plus global que de statuer sur la seule requête de M.
Maaouia et le paragraphe 40 qui contient sa conclusion est très éclairant ;
la Cour y déclare très simplement et de manière générale que « les
décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers »
ne relèvent pas de l’article 6 de la Convention. On y comprend la volonté de
la Cour d’expulser de son contentieux toute la police des étrangers,
contentieux à la fois très sensible pour les Etats, mais aussi contentieux qui
aurait pu devenir un contentieux de masse, propre à effrayer une Cour européenne
dont la réforme n’a pas permis de trouver une solution aux milliers de requêtes
qui s’accumulent, à un rythme encore plus élevé que devant l’ancienne
Commission européenne des droits de l’Homme.
Conclusion
On
ne peut que regretter la motivation de la nouvelle Cour européenne dans cette
affaire qui apparaît trop souvent déficiente. Or il ne faudrait pas que la
Cour européenne oublie que si elle juge les juridictions internes sur leur
motivation, c’est aussi sur sa motivation qu’elle est et sera jugée. On
peut certes comprendre la difficulté d’un délibéré à 17 juges dont les
cultures juridiques sont très diverses, sans oublier les difficultés
linguistiques.
Cette
difficulté est sans doute à l’origine d’une motivation minimale et parfois
trop générale, le « compromis » entre les juges étant
manifestement obtenu sur une motivation a minima.
Mais
les juges de la nouvelle Cour européenne auraient sans doute tort d’ignorer
qu’ils risquent, en cédant à cette difficulté, de mettre en cause toute
l’autorité de la Cour européenne…et l’enjeu est trop crucial pour
parvenir à un résultat aussi désastreux. Il serait bon de méditer sur cette
intéressante réflexion d’un haut magistrat français : « la cause
principale de disparition des organisations internationales, c’est le suicide ».
Michele
DE SALVIA
Il
s’agit d’une affaire pour laquelle une des Chambres s’est dessaisie pour
la Grande Chambre. Etant donné que j’ai signé l’arrêt, je voudrais donner
quelques précisions. Il y a trois domaines, mais je ne peux pas confirmer ou
infirmer, dans lesquels la nouvelle Cour semble s’être posée des questions.
Tout d’abord celui de l’applicabilité de l’article 6 aux procédures
d’expulsion, relèvement, etc. et d’extradition aussi ; ensuite celui de
l’applicabilité de l’article 6 aux procédures
fiscales, et une affaire est pendante
; enfin l’applicabilité de l’article 6 et les modalités d’application de
l’article 6 au contentieux de la fonction publique. Dans cette affaire, ce que
l’on peut relever, c’est qu’il y avait une jurisprudence constante de la
Commission et c’est sur cette base que les travaux préparatoires du Protocole
numéro 7 ont été conçus et que les Etats se sont décidés.
Les
Etats ont donc été amenés à prévoir l’article 1 du Protocole numéro 7 en
partant de cette interprétation de la Commission, ce qui pose au demeurant un
autre problème, celui de « l’effet pervers » que peuvent avoir
les Protocoles additionnels de façon à exclure l’applicabilité de la
Convention. Le plus bel exemple a été celui du Protocole numéro 4, qui n’a
pas été ratifié par le Royaume-Uni, relatif à la libre circulation des
personnes et notamment des nationaux. Dans les années 70, il y a eu des
milliers d’affaires présentées à la Commission par des porteurs de
passeports britanniques : les Asiatiques de l’Est africain qui étaient plus
ou moins contraints par la politique d’africanisation à quitter le pays, mais
qui ne pouvaient pas entrer sur le territoire du pays dont ils avaient le
passeport, et le gouvernement britannique a dit à la Cour : mais il y a eu un
Protocole numéro 4 qui garantit ce droit, et cela veut dire qu’il n’est pas
garanti par la Convention. Là, il y a eu une parade de la Commission qui a dit :
c’est vrai, mais je considère que c’est un traitement dégradant, et donc
elle a constaté une violation de la Convention.
|
|
|