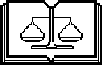|
Liberté
de religion et abattage rituel de la viande
L'arrêt
Cha'are Shalom Ve Tsedek c/ France
du
27 juin 2000
par
Patrice
Rolland
Professeur
à l'Université de Paris XII (Saint-Maur)
Parce
que l'abattage rituel israélite déroge aux règles ordinaires en cette matière,
il est soumis en France à un agrément ministériel. Celui-ci est accordé de
fait à une association, l'ACIP, qui regroupe une grande majorité de la
communauté juive. L'association requérante qui pratique l'abattage rituel de
la même façon que l'ACIP, entend cependant le faire elle-même au motif que
cette dernière n'a pas les mêmes exigences de contrôle post
mortem et qu'ainsi la viande qu'elle atteste n'est pas "glatt".
C'est le refus d'agrément, dont la légalité a été reconnue par le juge
administratif, que l'association requérante a porté devant la Cour
La
décision rendue par la Cour, en Grande Chambre, se présente de façon très
classique quant à la structure du raisonnement. Après avoir estimé qu'il n'y
avait pas d'ingérence, la Cour a considéré que la discrimination n'était pas
établie. Ce faisant, la décision prend le contre-pied de l'avis de la
Commission qui, dans son rapport du 20 octobre 1998, avait à une très large
majorité (14 voix contre 3) estimé qu'il y avait eu une discrimination. Quant
à la minorité de la Cour, elle s'est renforcée pour estimer qu'il y avait une
violation de l'article 14 : le refus de reconnaître une ingérence étant
acquis par 12 voix contre 5 et celui de la discrimination par 10 voix contre 7.
Mais alors que la Commission avait exclusivement examiné la question de la
discrimination sans se demander s'il y avait eu une ingérence, la Cour va
prendre la question depuis le départ. Estimant que le mécanisme de l'agrément
en vue de pratiquer l'abattage rituel ne constituait pas une ingérence, elle en
déduit qu'il n'y a pas à rechercher la légitimité des motifs de la décision
administrative de refus d'agrément. Sans être tout à fait conséquente avec
son raisonnement principal, la Cour envisagera cependant le cas où il y aurait,
malgré tout, ingérence, pour répondre de sa légitimité au regard des
principes de la Convention (§ 84). Il
n'y a pas non plus de violation de l'article 14 car la différence de traitement
est de faible portée et que, si elle existait, elle serait objective et
raisonnable.
Il
y a donc une véritable discussion sur le problème de la discrimination. La façon
dont la Cour élargit l'approche de l'affaire l'a conduit à dégager quelques
principes généraux sur les rapports de l'État et des religions. Au-delà des
considérations de fait liées à l'affaire, il est donc possible de
s'interroger principalement sur trois questions : se demander s'il y a une ingérence
conduit à examiner le rapport entre la liberté religieuse et la neutralité de
l'État ; se demander s'il y a discrimination exige qu'on s'interroge sur le
pluralisme (religieux) et ses éventuelles limites ; toutes ces réponses sont
elles-mêmes commandées par la conception que se fait la Cour de l'étendue de
son contrôle juridictionnel.
Y
a-t-il eu une ingérence ? : liberté religieuse et neutralité de l'État
À
cette question correspondent trois attitudes différentes : la Commission ne l'a
même pas soulevé ; la Cour a estimé qu'il n'y avait pas eu d'ingérence et
que par conséquent le contrôle de sa légitimité du but de la mesure ne se
posait pas (§ 84) ; la minorité de la Cour a considéré qu'il y avait eu ingérence
du simple fait du refus d'agrément ce qui veut dire, à y regarder de plus près,
qu'il y a ingérence du seul fait de la discrimination. Pour décider ou non de
l'existence d'une ingérence, il fallait répondre à deux questions
sous-jacentes.
La
liberté religieuse et la neutralité de l'État exigent-elles une abstention de
ce dernier ?
Pour
comprendre les indications que donne la Cour, il est nécessaire de partir d'une
question plus générale : pourquoi faudrait-il un agrément plutôt qu'un libre
accès aux abattoirs (dans le respect des règles d'hygiène et de
fonctionnement du service public) ? Autrement dit, l'abstention de l'État ne
serait-elle pas la meilleure garantie de cette neutralité religieuse que la
France invoque par ailleurs à juste titre ? La Cour rappelle à cette occasion
un certain nombre de principes qui sont autant d'éléments de réponse à cette
question.
Une
action positive de l'État, plutôt qu'une abstention ou une ignorance, peut
bien mieux conduire à une garantie effective de la liberté religieuse. La Cour
note, par exemple, que "le décret de 1980, loin de restreindre l'exercice
de la liberté de religion, vise ... au contraire à en prévoir et en organiser
le libre exercice" (§ 76). L'opinion
dissidente souligne son accord sur ce point. Contrairement aux apparences, le
silence de la loi n'est pas nécessairement le meilleur moyen de respecter la
liberté. De même, la Cour note qu'un régime dérogatoire, appelant donc un mécanisme
d'agrément, peut avoir pour but de contribuer à l'intérêt général.
De
façon plus générale, la Cour rappelle le principe selon lequel
"l'organisation par l'État d'un culte concourt à la paix religieuse et à
la tolérance" (§ 84). Aucune liberté ne peut se passer d'une
organisation juridique et par là d'une intervention des pouvoirs publics. C'est
à la lumière d'une telle constatation qu'il faut considérer les actions de l'État
dans le domaine religieux.
Pour
classique et justifié que soit le rappel de ces principes généraux, il
n'indique pas concrètement et par soi quelles actions positives de l'État sont
compatibles avec la liberté de l'individu et la neutralité de la puissance
publique. Ainsi, une procédure d'agrément n'est pas en soi une ingérence
puisqu'elle contribue à organiser cette liberté et donc à la faire exister ;
mais la question subsiste entière de savoir quels peuvent être les conditions
concrètes et les motifs légitimes de refus ou d'accord de l'agrément.
Qui
fixe le contenu et les limites de la liberté religieuse ?
Cette
question se situe elle-même à la croisée de deux problèmes : jusqu'où
peut-on pousser la logique interne d'une liberté ? On pourrait, en effet,
partant du principe du droit individuel, lui donner toute son extension. Ceci
reviendrait à laisser le soin aux croyants d'établir toutes les conséquences
qu'ils attachent à leur liberté religieuse et à voir celles-ci consacrées ou
reconnues d'office par les pouvoirs publics : par exemple ici, procéder soi-même
à un abattage rituel considéré comme plus orthodoxe que d'autres. Par
ailleurs, la Cour a rappelé l'existence d'un principe de neutralité
interdisant à l'État de porter des jugements sur les questions religieuses qui
rejoint absolument l'un des aspects fondamentaux de la laïcité de l'État français
invoquée à juste titre par le gouvernement : "Le droit à la liberté de
religion tel que l'entend la Convention exclut toute appréciation de la part de
l'État sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités
d'expression de celles-ci." (Manoussakis, 26
septembre 1996, § 47). Comment peut-on combiner ce principe avec l'obligation
d'un agrément pour accomplir un rite dont personne ne nie le caractère
essentiel, ou avec celui d'une action ou décision des pouvoirs publics nécessitant
qu'ils prennent parti dans des questions religieuses ? L'opinion dissidente
insiste fortement sur ce point. À ses yeux, la priorité doit revenir, dans les
missions de l'État, à l'organisation de la tolérance et au respect du
pluralisme. Il ne s'agit pas de chercher à éviter un débat religieux (en
donnant le pas à la majorité de la communauté sur la minorité), encore moins
de prendre parti dans celui-ci. Ceci reviendrait à protéger un groupe contre
un autre. Le principe essentiel, aux yeux de la minorité de la Cour, est donc
qu'il faut laisser aux religieux le soin de juger de la gravité de l'ingérence
dans leur droit. Concrètement, dans cette affaire, il s'agit de savoir dans
quelle mesure il est possible de dissocier l'abattage de la fourniture de la
viande rituelle et de considérer le second aspect comme accessoire et non
couvert par la liberté religieuse.
La
Cour répond à la question de savoir jusqu'où peut aller la liberté. Elle
rappelle d'abord quelques principes généraux et fondamentaux concernant le
contenu et l'extension de la liberté religieuse, droits qui ne posaient pas de
problèmes dans le cas présent. Toute communauté de fidèles a droit à un
statut juridique qui lui permette d'exercer les droits garantis au nom des fidèles
(§ 72) ; elle doit donc, dans le cas présent, avoir le droit de contester le
refus d'agrément (§ 74). C'est la consécration d'un droit à l'existence
collective, et non seulement individuelle, d'une religion ou d'une conviction.
La Cour rappelle, par ailleurs, ce que comprend le droit de manifester sa
religion : le culte, l'enseignement, les rites, les pratiques. "Il
n'est pas contesté que l'abattage rituel est un "rite", ... qui vise
à fournir aux fidèles une viande provenant d'animaux abattus conformément aux
prescriptions religieuses, ce qui représente un élément essentiel de la
pratique de la religion juive" (§ 73). La Cour en déduit explicitement
que ceci fonde un droit au recours sur le fondement de l'article 9 puisque
"l'abattage rituel (doit) être considéré comme relevant d'un droit
garanti par la Convention, à savoir le droit de manifester sa religion par
l'accomplissement des rites.." (§ 74).
Sur
le fondement de ces principes incontestables et qui ne faisaient pas l'objet de
véritables problèmes dans cette affaire, la question se pose de savoir jusqu'où
va la liberté religieuse et qui en détermine les contours exacts. En pratique,
il faut se demander jusqu'où va le droit des croyants en ce qui concerne
l'abattage rituel. La Cour reconnaît deux choses : l'abattage rituel est une
manifestation essentielle de la liberté religieuse, mais le rite est
suffisamment accompli dès lors qu'on peut se procurer de la viande rituelle
"glatt" et il n'exige pas
qu'on procède soi-même à l'abattage. La Cour prend donc parti sur le contour
exact du rituel et accepte de juger de ce qui est encore attaché à la liberté
religieuse et de ce qui n'en fait plus partie. Sans hésitation, elle tranche en
considérant que la mesure qui interdit à l'association de procéder elle-même
à l'abattage est moins importante que le fait de pouvoir s'en procurer :
"... le droit à la liberté religieuse... ne saurait aller jusqu'à
englober le droit de procéder personnellement à l'abattage rituel et à la
certification qui en découle" (§ 82). La minorité considère au
contraire que le juge n'a pas à se substituer à l'appréciation des fidèles dès
lors qu'il s'agit de questions religieuses (op. diss. p. 27). Le gouvernement
français ne veut pas s'immiscer dans une controverse dogmatique mais il accepte
de donner priorité à l'interprétation d'une autorité religieuse (le Grand
Rabbin de France) sur d'autres, ce qui revient à une immixtion de fait dans ce
débat (§ 66). Mutatis mutandis, la même
question se pose lorsque le gouvernement français qualifie de purement
commerciale et financière l'activité de l'association, alors qu'on pourrait
aussi bien faire valoir que la taxe d'abattage constitue une partie importante
des ressources qui permettent à l'association de soutenir ses activités
religieuses.
Y
a-t-il eu discrimination ? : le pluralisme et ses limites
Le
respect du pluralisme est une obligation évidente rappelée depuis longtemps
par la Cour comme conséquence du caractère démocratique de l'ordre européen
institué par la Convention. La question précise est plutôt de savoir dans
quelle mesure l'État est tenu de donner au pluralisme religieux la totalité de
son extension et de ses moyens d'expression. Dans cette affaire, le point en débat
était de savoir si l'État devait reconnaître les mêmes droits à la moindre
communauté religieuse minoritaire ou dissidente par rapport à la communauté
majoritaire. Le gouvernement invoquait ainsi son droit de juger de la représentativité
d'une association au sein de la communauté juive et son droit d'éviter une
multiplication des agréments dérogatoires.
Le
pluralisme a-t-il des limites ?
L'obligation
de pluralisme, dans ce contexte religieux, est renforcée par la neutralité de
l'État. La Cour a d'ailleurs implicitement confirmé l'importance de ce
pluralisme lorsqu'elle reconnaît le droit pour une "communauté de fidèles"
de se constituer juridiquement (§ 72) et qu'elle admet qu'un organisme
religieux qui se constituerait ultérieurement a le droit de demander l'agrément
accordé à d'autres antérieurement (§ 78). On a interprété la solution de
la Cour comme une limite au pluralisme. L'État ne serait pas
obligé de donner aux groupes minoritaires la totalité des droits accordés aux
grands groupes religieux. Le gouvernement français avait plaidé que la
multiplication des agréments au profit de communautés religieuses sans représentativité
suffisante risquerait de porter atteinte au bon fonctionnement du service
public.
On
peut noter tout de même un certain manque de cohérence concrète dans cette
affaire entre l'obligation de pluralisme et la neutralité de l'État. Il y a
bien un monopole de fait de l'abattage rituel confié à l'association
majoritaire dans la communauté juive. Ceci correspond en pratique à une prise
de position de l'État français sur les conditions d'abattage rituel orthodoxe,
qui retient l'interprétation du Grand Rabbin de France. Il est ainsi conduit à
prendre indirectement parti dans une querelle purement religieuse alors qu'il
affirme à juste titre ne pas devoir et ne pas vouloir le faire.
Pluralisme
et discrimination
Il
n'y a de discriminations que si les associations concernées sont dans la même
situation. De très nombreux arguments de fait semblent montrer que les deux
associations n'étaient pas dans une situation vraiment différente. La
Commission avait longuement examiné ce problème. La minorité de la Cour
reprend un certain nombre d'arguments : même statut d'association cultuelle et
mêmes activités religieuses, même technique d'abattage, même perception
d'une taxe d'abattage, même respect des règles d'hygiène (op. diss. p.
28-29).
Mais la question est peut-être de savoir si, en matière religieuse, le
pluralisme ne conduit pas à avoir des critères de nature un peu différente
concernant la similitude des situations, en particulier concernant la représentativité
et le nombre des fidèles appartenant à la communauté.
La
Cour examine très rapidement la question de la discrimination alors que la
totalité de l'avis de la Commission portait sur ce seul point. Elle conclut que
"la différence de traitement qui en est résultée est de faible portée"
(§ 87). Cette conclusion se déduit de l'effet limité du refus d'agrément
à supposer qu'il constitue une ingérence. On aurait ainsi une sorte
d'application de l'adage de minimis non
curat praetor.
Le
contrôle juridictionnel du but de l'ingérence
Alors
que la Cour avait exclu qu'il y ait eu une ingérence, elle accepte cependant
d'envisager l'hypothèse d'une ingérence et d'en contrôler la légitimité.
Cette remarque de la Cour pourrait presque être traitée comme un obiter
dictum. C'est pourtant le véritable terrain sur lequel la question aurait dû
être placée et traitée : y a-t-il des limites d'ordre public à la liberté
religieuse et en particulier à la liberté des rites ? l'État français en
rapporte-t-il la preuve ?
La
Cour se contente en pratique d'un contrôle juridictionnel "minimum"
En
apparence, la Cour effectue un contrôle classique du but de la mesure, ici d'un
refus d'agrément. Deux finalités générales pouvaient justifier sans peine la
mesure prise par le gouvernement français : la protection de l'ordre public, et
en particulier de l'hygiène et de la santé publique, et d'autre part, comme
l'indique la Cour en prenant appui sur la mission générale de tout État, le
fait d'organiser l'exercice d'un culte qui a pour effet de contribuer à la paix
religieuse et à la tolérance.
En
réalité, deux raisons ont conduit la Cour à ne pratiquer qu'un contrôle
minimum. Elle a d'abord reconnu que l'État dispose d'une marge d'appréciation.
La formule est, en un sens, banale car il est très rare qu'une décision puisse
être réduite à une compétence liée. Mais, dans cette affaire, la Cour répond
à un argument du gouvernement français. Celui-ci avait souligné que deux éléments
relevaient de sa marge d'appréciation, échappant donc à un contrôle de la
Cour : la qualification des activités de l'association requérante, en
l'occurrence jugées purement commerciales, et d'autre part, l'appréciation de
la représentativité de l'association qui n'aurait eu qu'une faible audience
dans la communauté juive en France (§ 69). Le gouvernement en déduisait son
droit de ne pas favoriser la prolifération des titulaires d'un agrément dérogatoire
aux règles ordinaires de l'abattage des animaux. Mais la raison essentielle de
ce judicial restraint tient au constat
de la difficulté de la matière : la marge d'appréciation est justifiée aux
yeux de la Cour "notamment pour ce qui est de l'établissement des délicats
rapports entre l'État et les religions" (§ 84). Le juge européen établit
ici en pratique ce qu'on appelle en droit administratif français un contrôle
minimum dont l'effet est de réduire le contrôle juridictionnel à l'erreur
manifeste d'appréciation. La Cour énonce, en effet, que la mesure prise par l'État
"ne saurait être considérée comme excessive ou disproportionnée"
(§ 84). Le résultat est qu'on aboutit à un contrôle purement abstrait et
formel des motifs d'ordre public et de santé ou hygiène publique invoqués par
le gouvernement. À aucun moment le gouvernement n'indique précisément en quoi
la prolifération des agréments porterait effectivement atteinte à ces buts
d'ordre public ou au bon fonctionnement des abattoirs. La minorité de la Cour
(op. diss. p. 29) a repris l'argument de la requérante qui faisait remarquer
sans être contredite que les agréments étaient bien plus nombreux pour les
associations musulmanes qui ne sont pas fédérées de la même façon que les
associations israélites. Les pratiques d'abattage étant identiques, la
discrimination devenait patente en l'absence des preuves d'une atteinte
effective ou d'un risque suffisant d'atteinte à l'hygiène publique par les
pratiques de cette association.
Il
est difficile de comprendre pourquoi la Cour a adopté, dans cette affaire, le
principe d'un contrôle restreint des motifs de la décision administrative. Le
droit administratif français a établi le contrôle de l'erreur manifeste
d'appréciation lorsque la difficulté d'appréciation était d'ordre technique
ou matérielle. On ne voit pas la difficulté particulière que représente l'établissement
de rapports juridiques ; ou alors c'est tout régime de liberté et dans quelque
domaine que ce soit qui présente ce type de difficulté. À moins que la Cour
ne veuille prendre en compte une difficulté proprement politique. C'est
l'interprétation que donne J.F. Flauss
: le "profil bas "de la Cour vient de ce qu'elle ne veut pas
"mettre à mal les options constitutionnelles ou/et législatives retenues
par les États en matière d'exercice de la liberté religieuse".
Il y aurait une crainte de la Cour à intervenir dans des équilibres acquis au
fil de l'histoire. De fait, on a déjà pu noter un certain conformisme de la
Cour à l'égard de certaines solutions nationales
en matière religieuse où les principes sont irréprochables mais où la marge
d'appréciation laissée aux autorités nationales paraissait trop importante
compte tenu du caractère fondamental de la liberté en cause.
Conclusion
Le
débat ne semble pas avoir été placé par la Cour sur le bon terrain
juridique. Elle-même n'est pas exempte de contradiction lorsqu'elle renonce
logiquement à examiner le bien fondé du refus d'agrément puisqu'il ne
constituait pas une ingérence et
qu'elle traite tout de même de la question au cas où il y aurait eu ingérence.
Elle a donc bien senti une difficulté. Il aurait fallu, partant du principe de
neutralité de l'État par rapport aux débats et questions religieuses, éviter
de discuter et de qualifier les activités de l'association requérante ; ceci
conduisait, en effet, nécessairement à entrer dans des débats et
qualifications qui relevaient du débat religieux interne à la confession israélite.
Le véritable terrain sur lequel il fallait situer le débat du point de vue de
l'État est celui de la protection de l'ordre public. Là est la véritable
mission de tout État face à n'importe quelle liberté. Aucune d'entre elles, y
compris les plus fondamentales, ne peuvent échapper au respect de l'ordre
public. L'argument du gouvernement français était de ce point de vue
imparable. Mais il était nécessaire, en contrepartie, que le juge effectue un
contrôle complet des motifs sous peine de laisser au gouvernement une marge
d'appréciation telle qu'elle risque de porter atteinte voire de nier concrètement
la liberté en cause.
Il
faut donc conclure avec la Commission et la minorité de la Cour qu'il y a bien
eu discrimination. L'association requérante ne se distinguait pas de celle qui
avait reçu l'agrément ni quant à la technique d'abattage qui ne faisait donc
courir pas plus de risques pour l'hygiène publique, ni quant à la méthode de
financement de son activité d'abattage rituel et à sa finalité religieuse
(entretien des différentes œuvres cultuelles et culturelles de l'association).
Le gouvernement n'a apporté aucune preuve d'un risque particulier propre à
cette association. Le principe de non-prolifération des agréments n'a qu'une vérité
abstraite et ne peut venir en concours avec la liberté religieuse dont
l'abattage rituel fait partie. Le véritable enjeu était de mesurer la portée
de la discrimination subie par les deux associations en raison d'un agrément
accordé ou refusé. Elle est effectivement faible si on se place seulement du
point de vue pratique (la possibilité de se procurer de la viande "glatt").
Par contre, du point de vue symbolique, c'est une véritable discrimination. Or,
c'est ce dernier point de vue qui doit l'emporter lorsqu'il s'agit de liberté
religieuse dès lors que l'ordre public matériel est respecté.
|