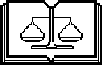|
1999,
une année de transition pour la nouvelle Cour de Strasbourg
par
Paul
TAVERNIER
Professeur
à l’Université de Paris XI
Directeur
du CREDHO - Paris Sud
La
nouvelle Cour européenne des droits de l’Homme a été installée
solennellement le 3 novembre 1998. Dès le lendemain elle adoptait son nouveau règlement
et elle pouvait donc commencer à fonctionner. Elle rendit ses premiers arrêts
le 21 janvier 1999 dont un important arrêt contre la France, l’arrêt Fressoz
et Roire (affaire du Canard enchaîné).
L’année
1999 apparaît à bien des égards comme une année de transition pour la
juridiction issue du Protocole n° 11. Celui-ci opéra une profonde
transformation du système institutionnel de contrôle de la Convention de Rome,
tout en laissant intactes les dispositions de fond. Il contient d’ailleurs des
clauses organisant la transition des anciens organes (Commission et Cour) à la
nouvelle Cour. Il est intéressant d’examiner comment ces clauses se sont
appliquées et de vérifier si la transition s’est effectuée dans de bonnes
conditions (II). De plus, on pouvait s’interroger sur l’attitude que la
nouvelle Cour adopterait vis-à-vis de la jurisprudence de l’ancienne Cour. On
constate que les arrêts rendus en 1999 s’inscrivent dans la perspective du
respect de l’acquis antérieur ; certains préfigurent sans doute des évolutions
et d’autres prennent fermement position plaçant délibérément la Cour au
premier plan des juridictions européennes. A cet égard l’année 1999 apparaît
également comme une année de transition (III). Mais, avant d’examiner ces
deux points, il convient de donner quelques informations d’ordre quantitatif
et statistique (I).
I
• L’expansion quantitative de l’activité de la Cour en 1999
Durant
l’année 1999, la Cour de Strasbourg a rendu 177 arrêts contre 106 en 1998.
Il est vrai que l’ancienne Cour avait arrêté son activité fin octobre, mais
elle avait accéléré son rythme de travail pour ne pas léguer à la nouvelle
Cour un “ stock ” d’affaires trop important.
On
peut d’ailleurs remarquer que l’activité de la nouvelle Cour ne peut pas se
mesurer seulement au nombre des arrêts rendus puisque la juridiction
strasbourgeoise a hérité des compétences de l’ancienne Commission. D’après
les statistiques fournies par la Cour, pour la période du 1er janvier au 31 décembre
1999, 20 399 dossiers provisoires ont été ouverts, 8 396 requêtes ont été
enregistrées, 3 489 ont été déclarées irrecevables ou rayées du rôle, 1
517 communiquées au gouvernement et 658 déclarées recevables (environ 7,8%
des requêtes enregistrées). Pour la France, les chiffres sont les suivants :
2586 dossiers provisoires, 868 requêtes enregistrées, 276 requêtes
irrecevables ou rayées du rôle, 119 communiquées au gouvernement et 51 déclarées
recevables (moins de 6% des requêtes enregistrées). On constate une
augmentation considérable du nombre des dossiers provisoires ouverts en 1999 :
20 399 contre seulement 16 218 en 1998 et 4 044 dix ans auparavant, en 1988.
Cette augmentation ne s’explique pas uniquement par l’ouverture de la
Convention à de nouveaux Etats comme la Russie (1 787 dossiers provisoires). La
France se trouve dans le peloton de tête, en compagnie de l’Italie,
championne toutes catégories (3 652 dossiers provisoires) et la Pologne (2 898
dossiers provisoires). Les citoyens européens et les étrangers n’ont donc
pas boudé la nouvelle Cour ; ils semblent au contraire attendre beaucoup
d’elle.
En
ce qui concerne les arrêts, la Cour a rendu seulement 37 arrêts pendant le 1er
semestre et 140 au second avec un rythme accéléré durant les trois derniers
mois : 29 arrêts respectivement en octobre et en novembre et 40 au mois de décembre,
soit autant pendant le dernier mois de l’année que pendant les six premiers
mois. Dès le 5 janvier 2000, juste après la trêve de Noël et du Jour de l’An,
la Cour a rendu son premier arrêt dans l’affaire Beyeler c. Italie,
faisant ainsi la preuve qu’elle est bien désormais une juridiction permanente
(article 19 nouveau).
23
Etats ont fait l’objet au moins d’un arrêt alors que 18 Etats ont échappé
en 1999 à la censure de la Cour.
Nombre d’arrêts par
pays en 1999 :
71
arrêts :
Italie
23
arrêts :
France
19
arrêts :
Turquie
14
arrêts :
Royaume-Uni
13
arrêts :
Portugal
6
arrêts :
Grèce
3
arrêts :
Allemagne, Autriche, Espagne Pologne
2
arrêts :
Belgique, Malte, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Slovaquie
1 arrêt :
Andorre, Bulgarie, Chypre, Hongrie, Liechtenstein, République tchèque,
Saint-Marin
êt
: Andorre, B
Là
encore la France se trouve dans le peloton de tête, il est vrai loin derrière
l’Italie, et juste devant la Turquie.
La
Cour a rendu 63 arrêts en grande chambre et 114 en chambre de 7 juges. Il est
vrai que l’article 5 § 5 du Protocole n° 11 prévoit que “ les
affaires pendantes devant la Cour dont l’examen n’est pas encore achevé à
la date d’entrée en vigueur du présent Protocole sont transmises à la
grande chambre de la Cour, qui se prononce sur l’affaire conformément aux
dispositions de ce Protocole ”. 53 arrêts ont été rendus en grande
chambre sur ce fondement alors que 87 affaires étaient pendantes devant la Cour
au 1er novembre 1998. Certains arrêts concernant plusieurs requêtes, une seule
affaire n’avait pas encore donné lieu à un arrêt fin 1999 :
l’affaire Sutherland c. Royaume-Uni. En ce qui concerne la France, 6
affaires étaient pendantes et 6 arrêts ont été rendus en grande chambre sur
la base de l’article 5 § 5 du Protocole et une autre affaire (Pellegrin)
a donné lieu également à une décision d’une grande chambre, alors que la
Cour a été saisie après le 1er novembre 1998.
Sur
les 177 arrêts de 1999, 53 étaient susceptibles de renvoi au titre de
l’article 43 nouveau (soit près de 30%) ; 11 arrêts concernent la France (près
de 48% des arrêts français). Toutefois aucun arrêt n’a donné lieu à
renvoi devant la grande chambre durant cette première année de fonctionnement
de la nouvelle Cour. Cela confirme le caractère exceptionnel de cette procédure,
comme le prévoit expressément l’article 43 qui, on le sait, était au coeur
du compromis politique ayant permis l’adoption du Protocole n° 11. Les
craintes émises par certains à l’époque n’apparaissent pas justifiées,
pour le moment du moins. En revanche, peu de juristes s’étaient penchés sur
la portée des dispositions transitoires insérées dans le Protocole n° 11.
II
• L’application des dispositions transitoires du Protocole n° 11
Le
Protocole 11 contient deux dispositions transitoires : les articles 5 et 6.
L’article 6, introduit très tardivement dans la négociation, consacre la
survie partielle des déclarations d’acceptation de la compétence de
l’ancienne Commission et de la juridiction de l’ancienne Cour (articles 25
et 46 anciens). Il s’agit notamment de maintenir certaines limitations ratione
temporis. Cette disposition transitoire n’a, selon nous, qu’un intérêt
limité.
En revanche, l’article 5 mérite qu’on s’y arrête car il organise en détail
la transition de l’ancienne à la nouvelle Cour. Il comprend six paragraphes
et sa structure est complexe. En dépit des apparences et malgré la volonté
des auteurs du texte d’envisager toutes les hypothèses possibles, il n’est
pas complet. Il comporte des lacunes, ce qui en soit n’est pas étonnant pour
ceux qui s’intéressent au droit transitoire et aux problèmes du droit
intertemporel : il est en effet très difficile de maîtriser le temps (ou le
facteur temps) sur le plan juridique et d’envisager à l’avance toutes les
hypothèses possibles. La réalité réserve bien souvent des surprises. La Cour
n’a sans doute pas voulu souligner ces lacunes et les carences des négociateurs,
mais une telle attitude l’a conduit à faire une application erronée, à
notre avis, de certaines dispositions de l’article 5.
Le
paragraphe 1 prévoit que “ le mandat des juges, membres de la
Commission, greffier et greffier-adjoint, expire à la date d’entrée en
vigueur du présent protocole ”, soit le 1er novembre 1998. Cette
disposition est parfaitement correcte et consacre l’effet immédiat du
Protocole n° 11. La date du 1er novembre 1998 apparaît essentielle pour
l’application des mesures transitoires prévues dans les paragraphes 2 à 6 en
ce qui concerne les procédures entamées avant cette date devant les organes de
la Convention selon l’ancien système. L’article 5 envisage fort logiquement
trois hypothèses selon que l’affaire était pendante devant la Commission,
devant la Cour ou devant le Comité des Ministres.
Le
cas le plus simple était celui des affaires pendantes devant la Cour. Aux
termes du paragraphe 5, elles “ sont transmises à la grande chambre de
la Cour, qui se prononce sur l’affaire conformément aux dispositions de ce
Protocole ”. En conséquence, une affaire qui était traitée par une
chambre avant le 1er novembre 1998 devait l’être par la grande chambre après
cette date, ce qui pouvait alourdir la tâche de la nouvelle Cour. De plus, des
problèmes pratiques sont apparus du fait que les anciens membres de la
Commission, devenus juges, ne pouvaient siéger dans la grande chambre : ils ont
donc dû se déporter et des juges ad hoc être désignés.
Le
cas du Comité des Ministres était plus complexe. Le paragraphe 6 de
l’article 5 consacre la survie du droit ancien alors que pour la Cour
l’application du droit nouveau est privilégiée. Les affaires pendantes
devant le Comité des Ministres sont donc réglées conformément à l’ancien
article 32. Comme pour la Cour, aucune date limite n’est fixée en ce qui
concerne la mise en œuvre de cette disposition transitoire. Elle risque donc de
s’appliquer durant de nombreuses années encore, compte tenu de la pratique du
Comité des Ministres.
En revanche, pour la Cour on peut espérer que l’année 2000 verra l’achèvement
de toutes les affaires pendantes devant l’ancienne Cour. De plus, le Comité
des Ministres devra traiter non seulement les affaires qui étaient pendantes
devant lui au moment de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, mais également
celles dont il a été saisi sur la base de l’article 5 § 4 par l’ancienne
Commission, qui a continué à fonctionner pendant une année. Au 17 janvier
2000, 276 rapports adoptées par la Commission entre le 1er novembre 1998 et le
1er novembre 1999 avaient été déférés au Comité des Ministres ; 118
rapports adoptés avant cette date ont été transmis au Comité après le 1er
novembre 1998 (hypothèse non prévue dans l’article 5), soit un total de 364
rapports. 289 rapports antérieurs au 1er novembre 1998 ont été examinés par
le Comité des Ministres après l’entrée en vigueur du Protocole n° 11. Le
nombre des résolutions finales adoptées par le Comité des Ministres sur des
rapports (article 32) s’élève à 129 (118 rapports antérieurs au 1er
novembre 1998 et 11 rapports postérieurs) ; 527 résolutions intérimaires ont
été adoptées en 1999 (dont 281 concernent des rapports antérieurs au 1er
novembre 1998 et 246 des rapports postérieurs à cette date).
Si le nombre des nouvelles affaires portées devant le Comité des Ministres a
diminué en 1999 (347 contre 501 en 1998), en revanche le nombre des affaires
pendantes s’est accru (1916 en 1999 contre 1304 en 1998). Ces chiffres
confirment que l’activité du Comité des Ministres sur la base de l’ancien
article 32 ne cessera pas de sitôt...
La
troisième hypothèse envisagée dans l’article 5 du Protocole n° 11 concerne
les affaires qui étaient pendantes devant la Commission. Trois cas de figure
sont prévus selon l’avancement de la procédure. Le paragraphe 2 concerne les
requêtes dont l’examen étaient le moins avancé, c’est-à-dire “ les
requêtes pendantes devant la Commission qui n’ont pas encore été déclarées
recevables à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ”.
Dans ce cas, la nouvelle procédure s’applique avec effet immédiat : 84 des
177 arrêts rendus en 1999 l’ont été sur la base de l’article 5 § 2 (soit
plus de 47%) ; dans 67 arrêts (37,6%), la Cour a invoqué expressément
l’article 5 § 2 ; dans 17 autres elle l’a appliqué implicitement. 12 arrêts
concernant la France sur 23 (soit 50%) ont été pris sur la base de cette
disposition, explicitement mentionnée.
Le
paragraphe 3 traite des requêtes déjà déclarées recevables avant le 1er
novembre 1998. Elles “ continuent d’être traitées par les membres de
la Commission dans l’année qui suit ”. Cette disposition assure donc
une sorte de survie de la Commission pendant une année. Il n’est pas précisé
que les membres de l’ancienne Commission, qui peuvent d’ailleurs avoir été
élus juges à la nouvelle Cour, devront appliquer l’ancienne procédure, mais
cela semble résulter implicitement du texte car la phrase suivante précise que
les affaires dont l’examen n’est pas terminé pendant cette période “ sont
transmises à la Cour qui les examine en tant que requêtes recevables, conformément
aux dispositions du présent Protocole ”. C’est d’ailleurs ce qui
ressort explicitement du rapport explicatif joint au texte du Protocole.
Aucun arrêt n’a été rendu sur ce fondement en 1999.
En
revanche, de nombreux arrêts mettent en œuvre le paragraphe 4 de l’article
5, soit explicitement, soit implicitement, mais aussi parfois de manière erronée.
Cette disposition relative au troisième cas de figure est très détaillée,
mais sa rédaction soulève des problèmes, et il n’est pas étonnant que son
application ait suscité des difficultés. Comme le rapport explicatif le
confirme, le paragraphe 4 concerne les requêtes pour lesquelles l’ancienne
Commission, fonctionnant sur la base du paragraphe 3, a adopté un rapport
conformément à l’ancien article 31 durant la période de survie du système
ancien (1er novembre 1998-1er novembre 1999). En revanche, le paragraphe 4 n’a
pas prévu le cas des rapports adoptés par la Commission avant l’entrée en
vigueur du Protocole, et qui n’avaient pas fait l’objet d’une saisine de
la Cour (ou d’une transmission au Comité des Ministres).
Or
cette hypothèse s’est révélée une hypothèse bien réelle et non pas une
simple hypothèse d’école, d’autant plus que le délai de saisine de la
Cour prévu à l’ancien article 32 part de la date de transmission du rapport
au Comité des Ministres et non de la date d’adoption de celui-ci : plusieurs
mois peuvent s’écouler entre ces deux dates ! Pour combler cette lacune la
nouvelle Cour a été amenée à appliquer le paragraphe 4 de l’article 5 de
manière erronée. En effet, les dispositions transitoires prévues dans le Règlement
de la nouvelle Cour (articles 97 à 102) comportent des précisions intéressantes
en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 5, mais sont muettes sur le
point qui nous intéresse.
Seuls
7 arrêts sur 177 (soit 3,9%) correspondent à une application correcte de
l’article 5 § 4 ; pour la France, il s’agit d’un arrêt sur les 23 la
concernant (soit 4,2%). En revanche, 30 arrêts (16,9%) s’appuient
explicitement sur l’article 5 § 4 de manière erronée puisque la Cour a été
saisie après le 1er novembre 1998 sur la base de rapports adoptés avant cette
date (parfois quelques jours seulement avant celle-ci) : pour la France le
chiffre s’élève à 4 (soit 16,6%).
A
cela il faut ajouter un cas d’application implicite et erronée de l’article
5 § 4 qui n’intéresse pas la France (arrêt Buscemi c. Italie du 16
septembre 1999 et un cas d’application totalement erronée du paragraphe 4
concernant l’Autriche (arrêt Ernst et Anna Lughofer du 30 novembre
1999) : cette affaire relevait du paragraphe 5 puisque le rapport de la
Commission et la saisine étaient tous les deux antérieurs au 1er novembre
1998.
Tous
ces exemples montrent combien il est difficile de maîtriser le facteur temps
sur le plan juridique : il est pratiquement impossible de prévoir à l’avance
toutes les hypothèses qui se réaliseront et il n’est pas toujours aisé
d’appliquer correctement les dispositions transitoires qui ont été convenues
entre les Etats et qui s’imposent au juge. On peut signaler à cet égard la
question de la survie du Protocole n° 9 : celle-ci n’est pas prévue à
l’article 2 § 8 qui abroge le Protocole n° 9 purement et simplement, mais
elle peut-être déduite implicitement du libellé de l’article 5 § 4. Le
rapport explicatif semble considérer qu’une telle interprétation va de soi
et se réfère expressément au Protocole n° 9,
mais les termes mêmes du paragraphe 4 ne sont pas très clairs. Ce texte
stipule que “ conformément aux dispositions applicables avant l’entrée
en vigueur du présent Protocole, une affaire peut être déférée à la Cour ”.
Il peut être interprété comme incluant une référence à la fois à
l’ancien article 48 et au Protocole n° 9, ainsi que le fait le rapport
explicatif, dont la valeur juridique est sujette à discussion.
Mais on peut très bien soutenir une interprétation plus restrictive et se
fonder sur le paragraphe 8 de l’article 2 qui ne contient pas de renvoi à
l’article 5 et qui ne précise pas qu’il abroge le Protocole n° 9 “ sous
réserve ” ou “ sans préjudice des dispositions du paragraphe 4
de l’article 5 ” (formule que l’on trouve par exemple au paragraphe 1
de l’article 5).
L’année
1999 aura donc été pour la nouvelle Cour de Strasbourg une année de
transition à tous égards. Il en est de même de la jurisprudence qu’elle a
élaborée et qui apparaît comme une jurisprudence “ en transition ”.
III
• Une jurisprudence “ en transition ”
Il
est évidemment difficile de porter un jugement définitif et approfondi sur une
jurisprudence qui est encore toute récente et dont on ne perçoit sans doute
pas encore toutes les potentialités ni toutes les implications et toutes les
conséquences. On peut cependant faire quelques remarques générales et
provisoires, concernant aussi bien le fond que la forme.
Tout
d’abord il convient de rejeter toute vision “ nationaliste ” de
la jurisprudence de Strasbourg. La Cour européenne des droits de l’Homme est
avant tout une juridiction internationale et doit le demeurer, même si elle est
composée de juges qui ne peuvent pas répudier leur formation juridique. Ainsi,
dans l’affaire Yahiaoui (arrêt du 2 janvier 2000), le juge britannique
Sir Nicolas Bratza semble se référer au principe “ stare decisis ”
en ce qui concerne les arrêts de la grande chambre. Or ce principe, connu des
juristes de “ common law ”, n’existe pas dans les pays de
droit écrit ni dans le droit international. La Cour européenne l’a
d’ailleurs reconnu dans l’affaire Cossey.
On
peut aussi remarquer que plusieurs affaires françaises et britanniques jugées
en 1999 se font en quelque sorte écho. Ainsi à l’arrêt Chassagnou du
29 avril qui a ému les chasseurs français, répond l’arrêt Hasham et
Harrup du 25 novembre, qui donne également raison aux anti-chasseurs
britanniques lesquels troublaient le bon déroulement de la chasse - comble de
l’ironie... - en sonnant du cor de chasse !
De
même, à l’affaire du Canard enchaîné (arrêt du 21 janvier), qui
condamne la France au nom d’une liberté d’expression proche de la
conception anglo-saxonne, répond le même arrêt Hasham et Harrup, qui
condamne le Royaume-Uni et protège la liberté d’expression des “ saboteurs
de chasse ”. Et l’on pourrait sans doute trouver d’autres exemples.
Par
ailleurs, les premiers linéaments de la rénovation de la jurisprudence
entreprise par la nouvelle Cour apparaissent déjà. Celle-ci a largement repris
et confirmé les acquis antérieurs de l’ancienne Commission et de
l’ancienne Cour. Mais on relève néanmoins certains infléchissements ou
certaines évolutions, par exemple dans la jurisprudence relative à
l’irritante question de la durée excessive des procédures, mal qui frappe
pratiquement tous les pays et même les juridictions européennes !
Dans une série d’arrêts rendus le 28 juillet 1999, la Cour a condamné l’Italie
en considérant que l’accumulation des manquements était constitutive d’une
“ pratique incompatible avec la Convention ”.
Dans
certains cas, la Cour s’est efforcée de simplifier une jurisprudence antérieure
complexe et confuse. L’exemple le plus significatif est celui de
l’applicabilité de l’article 6 en matière de fonction publique. L’arrêt
Pellegrin c. France du 8 décembre 1999 constitue un effort louable dans
son principe pour aboutir à l’utilisation de critères plus justes et plus
simples, mais on peut légitimement se demander s’il ne s’agit pas d’une
fausse clarification.
En
revanche, on doit se féliciter des prises de position très fermes de la
nouvelle Cour face à la Cour de Justice des Communautés européennes et au
Conseil constitutionnel français. Ainsi dans l’affaire Matthews, qui
concernait les élections au Parlement européen dans le territoire britannique
de Gibraltar, la Cour n’a pas craint d’empiéter sur le domaine de l’Union
européenne et de s’attirer les foudres de la Cour de Justice des Communautés
européennes.
De même, elle n’a pas hésité à affronter discrètement, mais directement,
le Conseil constitutionnel français dans l’affaire Zielinski et Pradal,
démontrant qu’aucune juridiction nationale, fut-elle constitutionnelle, ne
peut échapper à sa censure.
Certaines
tendances de la nouvelle jurisprudence de la Cour suscitent des interrogations
et nous semblent inquiétantes pour l’avenir, si elles se confirmaient sans
qu’on y apporte les correctifs nécessaires. Dans plusieurs arrêts la Cour a
adopté une motivation extrêmement succincte, réduite à sa plus simple
expression. Une telle pratique peut se justifier pour des affaires très répétitives,
comme c’est le cas en matière de durée de la procédure. Mais le plus
souvent ce n’est pas recommandable. La légendaire concision des arrêts du
Conseil d’Etat français n’est pas transposable aux juridictions européennes.
L’arrêt Yahiaoui du 20 janvier 2000 ne nous semble pas un exemple à
suivre à cet égard. Certes, il renvoie à l’arrêt Civet qui concerne
aussi la France, mais les circonstances n’étaient pas absolument identiques.
L’arrêt ne contient aucune indication sur le droit interne, contrairement à
la pratique antérieure de la Cour : il fallait au moins renvoyer à l’arrêt Civet
sur ce point. De plus, le rappel du droit interne pertinent et la motivation répondent
à une exigence pédagogique qui s’impose à une juridiction internationale
dont la jurisprudence n’est pas toujours facile à comprendre pour des
juristes ayant reçu des formations très différentes et qui doivent acquérir
les réflexes des spécialistes de droit comparé.
La
nouvelle Cour de Strasbourg a certainement la volonté d’établir une
jurisprudence de qualité, répondant à un souci de transparence et de clarté.
Il convient qu’elle soit très vigilante à cet égard. L’abandon du
bilinguisme français-anglais complet qui était pratiqué jusqu’ici est
parfois regrettable lorsque certains arrêts rendus en anglais seulement
semblent difficilement compréhensibles pour un juriste français ordinaire, peu
au fait des subtilités du droit anglo-saxon.
Il
est en tout cas très encourageant de constater que la Cour de Strasbourg rénovée
suit les traces de sa devancière et n’hésite pas à se prononcer sur des
questions importantes et nouvelles : la question des élections européennes à
Gibraltar, mais aussi celle des homosexuels dans l’armée britannique,
ou celle de l’immunité de juridiction d’une organisation internationale,
ou encore celles des incidences de la Convention européenne sur le marché de
l’art.
Ainsi la jurisprudence de la nouvelle Cour a bien montré que 1999 était une
année de transition pour la juridiction strasbourgeoise. Cette transition se
poursuivra sans doute en l’an 2000 et probablement au-delà. Souhaitons que ce
soit pour une plus grande et plus efficace protection des droits de l’Homme.
Débats
Guy
CANIVET
Merci
pour ce panorama magistral et très complet de la jurisprudence et de la
pratique de la Cour européenne des droits de l’Homme pour l’année 1999. Je
voudrais m’associer à ce que vous avez dit sur la qualité, la clarté et le
caractère explicite de la jurisprudence de la Cour et de ses arrêts. Je veux
dire que tous ceux qui critiquent la motivation trop rapide des arrêts de la
Cour de cassation et du Conseil d’Etat trouvent dans ces arrêts de la Cour de
Strasbourg un vrai modèle. Ceci dit, sans vouloir flatter le juge Costa ici présent…
Jean-Paul
COSTA
Je
voulais dire deux choses. D'abord souligner le fait, en écho à votre exposé
que j'ai beaucoup apprécié, qu'en effet les décisions récentes du Conseil d'Etat
en ce qui concerne le Conseil des marchés financiers et la CNIL ne sont pas du
tout contradictoires, et j'abonde dans votre sens, avec la jurisprudence de la
Cour d'appel de Paris, puis de la Cour de cassation, en ce qui concerne la
Commission des opérations de bourse et le Conseil de la concurrence.
Je
voudrais ensuite compléter les chiffres donnés par Paul Tavernier, bien qu'il
ait dit qu'il les compléterait dans son exposé écrit, pour corriger une
impression qui pourrait être fâcheuse pour l'auditoire. Il nous a parlé du
nombre d'arrêts rendus par la Cour, du nombre des requêtes enregistrées en
1999 et des décisions considérées comme recevables. Mais l'écart entre ces
chiffres et le nombre des requêtes enregistrées pourrait faire apparaître
qu'après la tempête de fin décembre, la Cour de Strasbourg subirait un
raz-de-marée. En réalité, il a oublié de mentionner, mais il le fera dans
son rapport écrit, le nombre très important de décisions qui ont été
rendues par les chambres de sept juges ou par les comités de trois juges et qui
sont des décisions d'irrecevabilité ou de radiation du rôle. Il y en a eu près
de 3500 en 1999. Il faut encore ajouter à tous ces chiffres les 600 décisions
qui ont encore été rendues par la Commission qui, comme il vous l'a expliqué,
a survécu à elle-même jusqu'au 31 octobre 1999. Il n'en reste pas moins vrai
qu'en 1999 la nouvelle Cour a jugé moins d'affaires qu'il n’en est entré, et
que l'écart est même assez préoccupant puisqu'elle avait reçu elle-même un
héritage de l'ancien système nettement déficitaire. Nous allons faire de gros
efforts pour essayer de réduire l'écart, et si possible rattraper l'arrière,
ce qu'on appelle en anglais le backlog.
Dernier
élément de précision par rapport à ce qu'a dit Paul Tavernier : il a parlé
d'accélération à la fin de l'année 1999. Cette accélération se confirme
puisqu'entre le 1er et le 25 janvier 2000 la Cour a rendu 44 arrêts, c'est-à-dire
encore mieux qu'en décembre... Mais il faut continuer...
J'ajoute
qu'il y a certains éléments qui ont surpris le Professeur Tavernier, comme le
fait que les arrêts sont plus courts qu'auparavant, que toutes les décisions
ne sont pas rendues dans les deux langues : ceci s'explique uniquement pour des
raisons de temps, d'efficacité ou de budget. Si nous avions tous les moyens
dont nous avons besoin, nous pourrions continuer à rendre des arrêts plus détaillés
et dans les deux langues. C'est malheureusement impossible car le Conseil de
l'Europe n'a pas assez d'argent à donner à la Cour européenne, parce que les
Etats n'en donnent pas suffisamment au Conseil de l'Europe, et nous sommes obligés
de faire ce qu'on pourrait appeler des économies de "bout de
chandelle". Je m'en excuse au nom de la Cour. C'est dans le souci d'une
bonne administration de la justice
Eric
GARAUD (professeur à Limoges)
Monsieur
le Président : d'un point de vue théorique, cela ne vous gêne-t-il pas
qu'apparaisse une hiérarchie entre les garanties issues de l'article 6 ? Certes
toutes sont fondamentales, et si le principe de l'égalité des armes est violé,
il s'en suit une nullité irrémédiable : le vice est trop grave. En revanche,
si la règle méconnue est la publicité des débats, on considère que la
violation est superficielle. On peut s'en accommoder... On comprend l'idée. Il
ne faut pas annuler une procédure pour des broutilles. Encore faudrait-il nous
expliquer en quoi la "fondamentalité" de la règle de la publicité
des débats est moindre que celle d'autres règles procédurales.
Guy
CANIVET
Je
ne l'explique pas. C'est d'ailleurs pour cela que je l'ai citée dans une partie
qui, à mon avis, relève des incertitudes dans la mesure où la distinction est
difficile à faire. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'on a une succession de
jurisprudences dans le temps. Les arrêts qui ont rejeté les moyens de nullité
tirés de la non-publicité des débats sont antérieurs aux grands arrêts de
la Cour de cassation et du Conseil d'Etat. Peut-être que la jurisprudence
serait différente à partir de maintenant. En tout cas, s'il fallait effectuer
un tri entre ce qui affecte vraiment la validité de la décision et ce qui
l'affecte moins, il faudrait se fonder sur ce qui est le coeur de la décision,
c'est-à-dire sur le processus décisionnel lui-même, et en particulier la
notion d'impartialité et d'égalité des armes. Ce qui ne veut pas dire que le
principe de publicité n'est pas aussi fort, mais il faut reconnaître que dans
le cadre de l'instance de recours, s'il y a publicité, aussi bien devant la
Cour d'appel de Paris que devant toute juridiction administrative, il est clair
que le principe de publicité est satisfait. C'est ce que j'aurais tendance à répondre,
mais votre remarque est juste : il est très difficile d’établir une hiérarchie
entre les principes définis par le paragraphe 1er de l'article 6.
Catherine
TEITGEN-COLLY (professeur à l’Université
de Paris XI)
Je
suis très frappée par le double mouvement auquel nous assistons dans le
domaine de la répression depuis quelques années : d’une part d’une
administration qui devient juge, d’autre part d’un juge qui devient
administrateur.
Une
administration qui devient juge, tel
est le premier mouvement. Pour des raisons diverses : absence de véritable
volonté de poursuivre du ministère public ou impuissance de celui-ci,
inefficacité du juge répressif, - tout le monde à cet égard a gardé en mémoire
les difficultés du contrôle des concentrations en matière de presse,
notamment du groupe Hersant dans les années quatre-vingt -, le législateur a
progressivement doté des autorités administratives de pouvoirs de sanction.
Ces pouvoirs n’ont cessé de s’étendre et de se sophistiquer, et les
autorités qui n’en étaient pas pourvues revendiquent à leur tour de tels
pouvoirs. Ainsi la CNIL estime-t-elle aujourd’hui ne plus pouvoir mener à
bien les fonctions qui lui ont été confiées il y a vingt ans et revendique
des compétences répressives.
La
Cour de Strasbourg a souhaité encadrer cette forme nouvelle de répression. Au
nom de la définition autonome qu’elle donne de la matière pénale, elle a
soumis aux garanties de l’article 6 de la Convention européenne ce pouvoir de
sanction administrative. Elle a cependant dans un premier temps différé
l’application des garanties inscrites à cet article à la phase
juridictionnelle de la procédure, se bornant à exiger que les sanctions
fassent l’objet d’un contrôle juridictionnel respectueux de ces garanties.
Puis elle paraît s’être ravisée. Dans les affaires Imbroscia c. Suisse
en filigrane, et plus nettement ensuite dans l’affaire Miailhe c. France,
elle se montre soucieuse d’examiner la procédure répressive dans son
ensemble pour s’assurer que dès la phase administrative, les garanties du
procès équitable sont bien respectées. Les juridictions nationales ont
confirmé cette analyse, du moins la Cour de cassation ; le Conseil d’Etat
demeurant plus prudent à l’égard du droit européen. Mais un renforcement
des garanties procédurales à la phase administrative emporte inévitablement
un alourdissement de la procédure, avec les conséquences classiques :
allongement de la durée de la procédure, insuffisance de moyens des autorités
administratives et perte d’efficacité de la répression. On retrouve certains
des maux dont souffrait la répression dans les années soixante-dix
lorsqu’elle était assurée par le juge répressif. La question du bien-fondé
du transfert du pouvoir répressif du juge à l’administration se pose alors
évidemment.
Elle
se pose d’autant – et c’est là le second mouvement observable – que le
juge devient administrateur. En effet, la Cour européenne de Strasbourg
exige que soient respectées au stade de la phase juridictionnelle les garanties
du procès équitable qu’énonce l’article 6. A ce titre, les sanctions
doivent faire l’objet d’un contrôle de plein contentieux, notion qui, en dépit
des incertitudes qu’elle recèle, renvoie pour la Cour à la fois à l’étendue
du contrôle et aux pouvoirs du juge. Ainsi, sous l’influence de la Cour européenne,
le juge civil, lorsque par exception la loi lui a donné compétence pour juger
de sanctions administratives (COB, Conseil de la concurrence, etc.) s’assure
de leur proportionnalité et le cas échéant les réforme. Il en va de même du
juge administratif, invité de plus en plus souvent par le législateur à être
un juge de plein contentieux (CSA, CCA, etc.), mais qui manifeste toutefois des
résistances à aller au bout du plein contentieux en certains domaines comme le
domaine fiscal.
De
ce double mouvement résultent ainsi un alourdissement de la répression dans sa
phase administrative, en raison du poids des exigences procédurales empruntées
au procès pénal, et une substitution du juge à l’administration en raison
de l’étendue des pouvoirs de contrôle qui lui sont confiés. Cette sorte de
dérive, voire de confusion des rôles invite à s’interroger à nouveau sur
le bien-fondé de la mise à l’écart du juge pénal et son remplacement par
des autorités administratives dotés de pouvoirs répressifs dans des secteurs
chaque jour plus étendus. Peut-on continuer d’exclure le juge pénal de
secteurs essentiels et renoncer à ce qu’apporte au plan symbolique son
intervention ? Alors même que les atouts de la répression administrative
– célérité et efficacité – sont mis en cause ?
Guy
CANIVET
Je
partage votre avis. S'il y avait une réponse à donner dans un dialogue sur
cette question, il faudrait je crois réfléchir sur la spécificité de
l'autorité administrative indépendante, c'est-à-dire ce qu'elle apporte par
rapport au juge pénal. A mon avis, il y a deux aspects. Si on regarde la COB,
son originalité tient à ce que la sanction n'est qu'un aspect d'un mécanisme
de régulation plus grand : pouvoir d’édicter des règles, pouvoir de
contrôler l'autorité morale sur le marché, etc. La procédure de sanction
fait partie d’un mécanisme plus large dans lequel le juge pénal ne peut pas
s’insérer.
Le
second aspect, et on touche davantage au Conseil de la concurrence, concerne le
domaine d'action de la répression où il y a un aspect technique économique
assez fort. On aurait pu éviter de donner cette technicité au juge pénal.
Mais la composition du Conseil de la concurrence offre cette grande richesse de
mêler des hommes de marché et des hommes d'entreprises, des économistes, des
juristes administratifs et des juristes judiciaires, et je crois que cette
confrontation de juristes et d'économistes provenant de milieux divers,
constitue un élément d’enrichissement dans l'appréciation des décisions.
Pour être très objectif, je ne vois pas un juge pénal rendre des décisions
avec une motivation telle que le Conseil de la concurrence peut en développer,
c’est-à-dire, une vraie motivation économique. Dans le droit de la
concurrence, il y a une technicité de l'approche des problèmes qui fonde en
quelque sorte une doctrine de la protection du marché. Je ne suis pas sûr que
le juge pénal aurait pu faire cela. C'est un avis personnel, mais objectivement
je crois qu’il est fondé. Certes, une évolution était souhaitable vers plus
de garanties. Devant ces autorités administratives, il y a des choses que les
parties et les avocats ne tolèrent pas et si on a réussi finalement à
sanctionner la présence du rapporteur dans le délibéré, c'est que c'était
une anomalie complète par rapport à nos manières de penser : on ne peut
pas admettre que l'accusateur fasse partie du mécanisme de prise de décision
car cela est totalement exogène à notre système de pensée et cela a fini par
disparaître. Une telle évolution a pris un certain temps, mais elle a été en
définitive un soulagement pour tout le monde. On avancera de plus en plus vers
une protection accrue dans la répression administrative, vers plus de
garanties, tout en sauvegardant à la fois les missions de régulation et la spécificité
ou la spécialité de ces autorités.
Je
pourrais ajouter un troisième aspect : j'ai l'impression qu'en doctrine
administrative, la notion d'autorité administrative indépendante est passée
de mode. Si on instaure une autorité de régulation, on cherche d'autres
moyens. Va-t-on revenir au renforcement du judiciaire ? Est-ce que le
judiciaire sera plus crédible ? Il est vrai que c'est une question de
moyens. Si on avait donné au juge judiciaire les moyens que l'on a donné à la
COB ou au Conseil de la concurrence pour régler ce type de contentieux, il est
certain qu’ils auraient été dans de meilleures conditions pour le faire.
Mais il y a aussi une question de sources de financement. La COB a des sources
de financement qui ne sont pas publiques puisque elle dispose d’un prélèvement
sur les opérations de bourse. A partir du moment où vous donnez à une autorité
un tel moyen de financement, elle se dote de structures considérables. Il n'y a
pas de problème d'encombrement devant la COB parce qu'elle a ce type de
financement.
Vincent
DELAPORTE
Je
voudrais poser une question qui intéresse assez directement le droit de la
concurrence, même si c'est si ce n’est pas totalement spécifique à cette
matière : c'est la question du contrôle judiciaire des visites domiciliaires.
Les
visites domiciliaires portent une atteinte objective au droit au domicile, à la
vie privée, et par conséquent nécessite une protection judiciaire indépendamment
du bien-fondé des poursuites qui peuvent être engagées. Il faut évidement
par définition, pour que ces visites soient efficaces, qu'elles soient
impromptues ; sinon on ne trouverait jamais les preuves nécessaires. Il y a
donc une autorisation judiciaire qui est donnée sur requête de
l'administration sans débat contradictoire, et le pourvoi en cassation est
ouvert a posteriori contre l’ordonnance d’autorisation. La Cour de cassation
a déjà jugé à plusieurs reprises que les garanties de la Convention étaient
assurées par ce double système : d'abord par le contrôle du président du
tribunal de grande instance, et ensuite par le pourvoi en cassation. Mais ce
système là ne paraît pas tout à fait satisfaisant puisque devant le président
du tribunal de grande instance, il n'y a pas de débat contradictoire, et par
conséquent les garanties de la Convention ne sont pas remplies ; et devant la
Cour de cassation le débat n'est pas non plus complet puisque la Cour de
cassation n'a pas abandonné en cette matière la distinction du fait et du
droit, et par conséquent seuls les moyens de droit sont recevables dans le
cadre du pourvoi contre l'ordonnance d'autorisation, les moyens de fait ne
peuvent pas être valablement discutés. Ne pensez-vous pas qu'il y a une lacune
dans le système puisqu'à aucun moment le débat ne peut avoir lieu de façon
complète, même a posteriori, sur la légitimité tant en fait qu’en droit de
l'autorisation ?
Guy
CANIVET
Votre
observation est pertinente. Ce qu'il faut dire d'ailleurs c'est que la
Convention se fonde sur l'article 8 (c'est-à-dire la protection du domicile et
de la vie privée) et qu'à partir de là on a un mécanisme qui est aussi
garanti par la Constitution puisque c'est le Conseil constitutionnel qui a fixé
les garanties accordées à ces visites domiciliaires. Ces garanties sont les
suivantes : la visite doit être autorisée par le juge et exécutée sous
le contrôle du juge. Ceci est satisfait dans la mesure où l'autorisation du
juge se fait par une ordonnance dont la légalité est contrôlée par la Cour
de cassation sur un recours direct, et vous savez mieux que moi quelle est la
minutie du contrôle de la Cour de cassation, même s’il s’agit d’un contrôle
de droit sur la légalité de ces ordonnances.
La
jurisprudence est très précise : certains estiment même qu’elle est
trop pointilleuse. On a une jurisprudence qui est très exigeante sur la légalité
de ces décisions de contrôle, et qui va jusqu'à constater et vérifier le
contrôle auquel s'est prêté le juge, c'est-à-dire si on lui a bien donné
toutes les pièces lui permettant d'apprécier la nécessité de ce contrôle,
et s'il a visé toutes ces pièces, s'il les a toutes examinées et s'il en a déduit
certains indices. La seul chose que ne contrôle pas la Cour de cassation, c'est
la portée de ces indices, c'est-à-dire qu'on ne va pas entrer finalement dans
la justification en fait de l'autorisation, mais en tout cas il y a un contrôle
très précis sur les conditions dans lesquelles ce juge donne l'autorisation, même
si en fin de compte, et je ne dirai pas le contraire, ce contrôle est assez
formel.
Sur
les incidents et les restitutions, le débat est contradictoire. On dit que
c'est une requête, mais qu'on doit appeler l'administration. On va donc
discuter d'un point de vue contradictoire sur la régularité des pièces appréhendées,
sur la régularité de l'exécution de cette mesure : on a un débat
contradictoire. Je pense qu'on peut souhaiter davantage de protections, mais
sous l'angle des protections, il me semble que l'on a atteint un niveau
sensiblement satisfaisant. Sous l'angle du contentieux, on constate une
explosion considérable, et les exigences juridiques y trouve leur compte.
Vincent
DELAPORTE
Le
contrôle a posteriori est depuis quelques semaines assez théorique, depuis que
la chambre commerciale a décidé que le président du tribunal de grande
instance n’est plus compétent, une fois les opérations de visites terminées,
pour en contrôler la régularité et, le cas échéant, les annuler.
Guy
CANIVET
Il
ne faut pas exagérer la portée de cette décision car la chambre commerciale
ne fait que dire : quand c'est un tiers qui conteste la régularité de la
visite, il ne peut pas saisir le juge qui l'a autorisée, mais il doit faire
valoir ses moyens dans le cadre d'une procédure au fond. On rejoint votre préoccupation,
c'est-à-dire qu'on va avoir un contrôle du fond sur la régularité de
l'ordonnance. Cela met fin à un système qui n'était plus tenable, mais qui était
l'aboutissement logique du système mis en place, puisqu'on avait dit qu'il n'y
avait pas de délai pour le tiers concerné par une pièce appréhendée lors
d'une visite pour contester la réalité de cette visite. Ainsi la veille du
jour où le Conseil de la concurrence devait se prononcer, voire le lendemain ou
même la veille du jour où la Cour d'appel devait se prononcer, on assistait à
des saisines du juge qui avaient autorisé la visite pour contester, et ensuite
obtenir une décision de ce juge, faire un pourvoi en cassation, et demander un
sursis à statuer en soutenant la thèse suivante : il y a une procédure
en cassation sur la régularité de la saisine, donc vous ne pouvez pas vous
prononcer au fond. On aboutissait finalement à une paralysie sous le couvert de
vouloir vérifier la régularité de la visite domiciliaire. C'est ce que la
chambre commerciale a voulu arrêter en disant : il y a un moment du contrôle
du juge de l'autorisation, et ensuite il y a un moment du contrôle du Conseil
de la concurrence et du juge du fond sur l’exécution de la mesure.
Vincent
DELAPORTE
Tout
le contentieux de l’exécution est reporté devant la juridiction ou
l’autorité éventuellement saisie des poursuites sur le fond.
Guy
CANIVET
Non,
pour le contentieux de l’exécution par le tiers concerné, le contentieux de
l'exécution par l'entreprise visée par la visite, la chambre commerciale dit
qu'il y a un délai qui est celui du dépôt du procès-verbal.
Vincent
DELAPORTE
Mais
il est pratiquement impossible de saisir le juge pendant la réalisation des opérations
: comment l’intéressé pourrait-il à la fois assister aux opérations, en
constater l’irrégularité alléguée, et accomplir les démarches nécessaires
à la saisine du juge ?
Guy
CANIVET
Entre
le moment où la visite est faite et le moment où l'on dépose le procès-verbal,
il y a un délai qui s'écoule et on peut saisir le juge. De toute façon cet
aspect des choses fait l'objet d'un examen très attentif du ministre des
Finances qui veut modifier l'ordonnance sur ce point. Il y a un projet de
modification, donc il y aura un débat devant le Parlement sur cette question.
Vincent
DELAPORTE
Effectivement,
dans ses mémoires sur les pourvois en cours, en matière fiscale, le Ministre
s'est opposé à cette nouvelle jurisprudence et il demande une modification de
la loi.
Paul
TAVERNIER
Pour
revenir au problème de la transition en ce qui concerne la Cour, il y a deux
points, qui sont liés, que j'ai omis de signaler : un qui concerne la Cour et
l'autre l'utilisation des nouvelles technologies avec internet. Tous les étudiants
connaissent l'existence du site internet de la Cour, très pratique, puisqu'il
permet d'avoir accès à la jurisprudence de la Cour très rapidement. Mais il y
a tout de même des problèmes transitoires. Par exemple, pour l'affaire Yahiaoui,
il était impossible pendant plusieurs jours de disposer du rapport de la
Commission qui présente un grand intérêt puisqu'il a été adopté par 7 voix
contre 7 et que la Cour ne s'est pas prononcée sur le problème de fond. Par
contre, on avait les décisions sur la recevabilité. Il s'agit très
certainement d'un problème technique.
Dans
le même ordre d'idées, je pense que la Cour a souvent été obligée de
travailler dans l'urgence et je crains que cette situation ne perdure, d'où
certaines aberrations sur le plan juridique. J'avais signalé au greffe de la
Cour l'affaire Baghli, dans laquelle il était dit que l'arrêt avait été
rendu à l'unanimité alors qu’il y avait deux opinions dissidentes. Après
mon intervention le greffe a modifié la version sur internet, mais je ne suis
pas sûr que le résultat soit satisfaisant, parce que désormais le dispositif
comporte un seul point et la décision de la Cour sur l'exception préliminaire
n’apparaît plus, ce qui ne me semble pas de bonne logique juridique.
Pourtant, la personne que j'ai contactée au greffe a paru un peu surprise de ma
remarque et a semblé même me dire qu'il y avait des précédents à la
Commission. Le juge Costa me fait signe que ce n'est pas normal, et j'espère
donc que dans la version définitive on tiendra compte de ces remarques. Il
s'agit d'un problème technique, lié au fait que la Cour est obligée, comme je
l'ai dit, de travailler dans l'urgence, voire dans l'extrême urgence.
Mon
deuxième point est lié à cette remarque : j'ai oublié de préciser tout
à l'heure que le Credho a ouvert un site sur internet. La référence est
facile à retenir puisque c'est : credho.org. J'espère que ce site se développera,
y compris avec votre participation, puisque nous vous demanderons vos
suggestions et nous espérons aussi ouvrir des forums de discussion. On pourra
aussi trouver sur le site, si un membre du Credho s'en charge, un résumé de
cette Journée, comme Isabelle Capette a bien voulu faire un résumé du
colloque organisé à Rouen le 15 octobre dernier par le Credho-Rouen et
Paris-Sud sur : Un siècle de droit international humanitaire : vous
le trouverez non pas sur le site du Credho qui n'existait pas encore, mais sur
le site de la revue Actualité et Droit international (ridi.org) dont
Patrice Despretz,ingénieur d'études, est le concepteur, de même qu’il est
concepteur du site du Credho.
Les actes du colloque
seront de toute manière publiés sur papier dans les Cahiers du Credho,
et sur internet. Les actes du précédent colloque sont d’ores et déjà publiés
sur internet. Notre but est d'insérer sur ce site l'ensemble des colloques précédents
ainsi qu'une grande partie des bulletins d'information du Credho, en particulier
les bibliographies sur les droits de l’Homme, les libertés publiques et de
droit humanitaire en langue française, ainsi que les thèses soutenues. Chaque
fois qu'il y aura une référence à un arrêt de la Cour, nous renverrons
directement sur le site de la Cour par un lien.
|