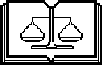|
Président
de séance :
Jean-Paul
COSTA
Juge
à la Cour européenne des droits de l’Homme
Je
remercie beaucoup les organisateurs du colloque, et au premier chef Paul
Tavernier, de m'avoir non seulement accepté parmi vous, mais de m'avoir invité
à présider une partie des travaux. Comme nous avons pris du retard, je vais être
bref dans mes propos liminaires. Je voudrais dire d'abord que je suis le juge élu
au titre de la France à la Cour européenne des droits de l'Homme. J'en suis très
heureux et très fier, surtout compte tenu du fait que mes trois prédécesseurs
ont été tous les trois tout à fait illustres : René Cassin, Pierre-Henri
Teitgen et Louis-Edmond Pettiti. Tous les trois sont malheureusement décédés,
le juge Pettiti peu de temps après l'entrée en vigueur du Protocole n° 11,
mais il m'avait accueilli extrêmement gentiment à la Cour de Strasbourg et
prodigué beaucoup de conseils.
Concernant
ma qualité de juge français : je suis tout à fait d'accord avec Paul
Tavernier pour dire que la Cour de Strasbourg est une juridiction européenne et
internationale, et qu'il n'y a pas de juges nationaux, mais malgré tout le juge
“ national ” a une certaine responsabilité puisqu'il siège dans
toutes les affaires sur des requêtes concernant son pays, donc j'aurai
l'occasion probablement de faire quelques commentaires puisque dans toutes les
affaires dont on va parler aujourd'hui, à l'exception de l'une d'entre elles,
l'affaire Zielinski & Pradal où je m'étais déporté, j'ai eu
l'occasion de siéger.
Je
donne la parole à Antoine Buchet. J'ai le plaisir de bien le connaître. Je le
vois parfois à Strasbourg. Il est chef du bureau des droits de l'Homme au
service des Affaires européennes et internationales de la chancellerie du
Ministère de la Justice. Il va traiter de la toute première affaire, celle qui
avait donné lieu à une audience le 18 novembre 1998, l'affaire dite du “ Canard
enchaîné ”, l'affaire Fressoz et Roire.
Convention
européenne des droits de l’Homme et fiscalité
•
Liberté d’expression et secret fiscal :
l’affaire
du Canard enchaîné
(arrêt
Fressoz et Roire du 21 janvier 1999)
par
par
Antoine BUCHET
Chef
du Bureau des droits de l’Homme,
SAEI,
Ministère de la Justice
L’arrêt
Fressoz et Roire, qui entrera probablement dans les recueils de
jurisprudence sous l’appellation plus attrayante d’arrêt “ Canard
Enchaîné ”, est le premier arrêt rendu dans une affaire française par
la nouvelle Cour européenne des droits de l’Homme, installée à Strasbourg
depuis le 1er novembre 1998, date de l’entrée en vigueur du Protocole 11 à
la Convention. C’est un arrêt rendu par la grande chambre, à l’unanimité
des 17 juges qui la composent.
Avant
d’analyser cet arrêt, et d’essayer d’en tirer quelques enseignements pour
l’avenir, revenons quelques instants sur les faits et la procédure suivie
devant les juridictions nationales.
I
• Rappel des faits et de la procédure suivie devant les juridictions
nationales
En
septembre 1989, l'entreprise automobile Peugeot connaît un grave conflit
social, relatif à des hausses de salaire réclamées par le personnel et refusées
par la direction de la société, présidée par M. Jacques Calvet.
Dans
son édition du 27 septembre 1989, l'hebdomadaire satirique Le Canard Enchaîné
publie un article de M. Claude Roire détaillant l'évolution du salaire de
M. Calvet, à partir de photocopies de ses avis d'imposition de 1986 à 1988 au
titre de l'impôt sur le revenu. Le journal reproduit un fac-similé partiel de
chaque document, indiquant les sommes perçues en traitement et salaires par le
président directeur général de PSA.
L'article
met en évidence une augmentation des sommes perçues par M. Calvet de 45,9% sur
deux ans. Ce qui conduit tout naturellement l'hebdomadaire à titrer : “ Calvet
met un turbo sur son salaire ”.
Le
2 octobre 1989, M. Calvet porte plainte contre X., avec constitution de partie
civile. Le parquet de Paris lui emboite le pas le 5 octobre. Le ministre du
budget se joint à la procédure le 25 octobre, en portant plainte pour
soustraction de documents administratifs et violation du secret professionnel.
L'analyse,
par les services de police judiciaire de Paris, du numéro informatique figurant
sur les documents en la possession de M. Roire, auteur de l'article, montre
qu'il s'agit des photocopies des exemplaires des avis d'imposition que conserve
l'administration fiscale et qui ne sont pas destinés à sortir de ses services.
Il n’est en revanche pas possible d'identifier le ou les auteurs de la sortie
des documents qui s'est faite, selon les constatations de l'enquête, au centre
départemental des impôts de Chaillot.
Le
8 mars 1991, M. Claude Roire, journaliste, et M. Roger Fressoz, directeur de la
publication du Canard Enchaîné, sont inculpés des chefs de recel de
copies d'avis d'imposition obtenues à l'aide du délit de violation du secret
professionnel et de soustraction d'actes ou de titres, et de vol.
Par
ordonnance du 27 janvier 1992, le juge d'instruction renvoie MM. Roire et
Fressoz devant le tribunal correctionnel de Paris afin qu'il soit jugés pour :
-
recel d'informations relatives aux revenus de M. Calvet, couvertes par le secret
fiscal, provenant de la violation du secret professionnel par un fonctionnaire
non identifié,
-
recel des photocopies de déclaration d'impôts de M. Calvet établies à l'insu
et contre le gré du légitime détenteur des documents originaux et
frauduleusement soustraits dans ce but.
Le
tribunal relaxe les deux prévenus le 17 juin 1992. Il considère que les
infractions principales ne sont pas établies du fait de l'impossibilité
d'identifier leurs auteurs et d'établir les circonstances de leur commission et
que dès lors le recel de ces infractions ne peut être constitué. Appel de ce
jugement est interjeté par les parties civiles et le ministère public.
Par
arrêt du 10 mars 1993, la 11ème chambre des appels correctionnels de la Cour
d’appel de Paris infirme le jugement de première instance. Elle déclare MM.
Roire et Fressoz coupables du délit de recel de photocopies provenant
d'une violation du secret professionnel par un fonctionnaire des impôts non
identifié. La Cour d’appel estime que les conditions d'une violation du
secret professionnel sont réunies dès lors qu'il est établi que seul un
fonctionnaire des impôts pouvait avoir accès aux documents en question, les
sortir et les transmettre au Canard enchaîné. Selon la Cour d’appel,
l'élément matériel et l'élément moral du délit de recel de violation du
secret professionnel sont réunis, à l'égard de M. Roire en raison des vérifications
faites par ce dernier pour s'assurer de la véracité et donc de l'origine des
documents et, s'agissant de M. Fessoz, parce que l'on a fait appel à lui
et non à un secrétaire de rédaction pour la signature du bon à tirer.
En
répression, M. Fressoz est condamné à 10.000 francs d'amende et M. Roire à
5.000 francs. Les prévenus sont de plus solidairement condamnés, en réparation
du préjudice moral subi par M. Calvet, à lui payer 1 franc de dommages et intérêts.
Le
pourvoi formé par les deux journalistes est rejeté le 3 avril 1995 par la
chambre criminelle de la Cour de cassation, qui estime que les juges d'appel
n’ont fait qu’user de leur pouvoir d’appréciation souveraine des faits.
MM.
Fressoz et Roire se tournent alors vers la Cour de Strasbourg. Ils déposent une
requête devant la Commission européenne des droits de l’Homme, invoquant une
violation des articles 10 et 6 § 2 de la Convention.
Déclarée
recevable le 26 mai 1997, la requête des deux journalistes fait l’objet
d’un rapport adopté par la Commission le 13 janvier 1998, laquelle conclut à
la violation de l’article 10, par 21 voix contre 11. L’affaire est ainsi déférée
à la Cour.
II
• L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme
Après
avoir écarté une exception d’irrecevabilité pour non-épuisement des voies
de recours, la Cour aborde le fond du grief fondé sur l’article 10 de la
Convention. Elle admet sans difficulté que l’ingérence dans le droit à la
libre expression était prévue par la loi, et qu’elle poursuivait un but légitime.
Elle
examine ensuite la proportionnalité de l’ingérence, afin de déterminer si
celle-ci était “ nécessaire dans une société démocratique ”,
conformément au paragraphe 2 de l’article 10.
Sur
ce point, la Cour relève en premier lieu que l’information diffusée
soulevait une question d’intérêt général (§ 50 de l’arrêt) : il
s’agissait d’un conflit social largement évoqué par la presse, au sein de
l’une des principales firmes automobiles françaises. Or, l’article 10 de la
Convention, qui protège aussi bien le droit de diffuser des informations que
celui d’en recevoir, doit être particulièrement sauvegardé lorsque
l’information en question touche à des questions d’intérêt général. La
Cour rappelle en effet que, dans le cas d’une information de cette nature, “ une
ingérence dans l’exercice de la liberté de la presse ne saurait se concilier
avec l’article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif
prépondérant d’intérêt public. ” (§ 51).
Si
les journalistes sont effectivement tenus de respecter les lois pénales de
droit commun, la Cour se doit de rechercher si, “ dans les circonstances
particulières de l’espèce, l’intérêt d’informer le public
l’emportait sur les “ devoirs et responsabilités ” pesant sur
les requérants en raison de l’origine douteuse des documents qui leur avaient
été adressés ” (§ 52). La haute instance européenne s’interroge en
particulier sur le point de savoir si “ l’objectif de préservation du
secret fiscal, légitime en lui-même, offrait une justification pertinente et
suffisante à l’ingérence ”. Sur ce point, elle souligne que les
informations en question étaient accessibles à un grand nombre de personnes,
selon certaines modalités prévues par le Code des procédures fiscales ; elle
fait ainsi la distinction entre le contenu de l’information, dont la
confidentialité n’est pas absolue, et le support de l’information, dont la
publication a entraîné la condamnation des deux journalistes (§ 53).
Or,
et c’est sans doute l’un des points essentiels de l’arrêt, “ la
condamnation des requérants pour avoir simplement publié le support (...)
ne saurait être justifié au regard de l’article 10. ” En effet,
rappelle la Cour, cette disposition de la Convention “ laisse aux
journalistes le soin de décider s’il est nécessaire ou non de reproduire le
support de leurs informations pour en asseoir la crédibilité. ”
L’article 10 “ protège le droit des journalistes de communiquer des
informations sur des questions d’intérêt général, dès lors qu’ils
s’expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des
informations fiables et précises dans le respect de l’éthique journalistique ”
(§ 54).
Constatant
que la publication d’une photocopie de l’avis d’imposition de Jacques
Calvet servait “ non seulement l’objet, mais aussi la crédibilité des
informations communiquées ”, la Cour conclut, pour retenir une violation
de l’article 10, que “ la condamnation des journalistes ne représentait
pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite des buts légitimes
visés compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et
à maintenir la liberté de la presse. ” (§ 55 et 56).
III
• Quels enseignements pour l’avenir ?
Il
faut en premier lieu insister sur le fait que l’arrêt Fressoz et Roire
démontre la fidélité de la nouvelle Cour à l’égard de la jurisprudence
antérieure, qui, sur le fondement de l’article 10 de la Convention, a déjà
établi de nombreux principes à l’occasion d’affaires mettant en cause des
journalistes pénalement sanctionnés pour avoir publiquement relaté des faits
portant atteinte à la réputation d’autrui.
Dans
l'affaire Oberschlick[2], la Cour européenne
statue sur le cas d'un journaliste condamné pour avoir publié une plainte déposée,
par lui-même et d'autres, contre un homme politique. A cette occasion, la Cour
“ rappelle que la liberté d'expression (...) constitue l'un des
fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions
primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. (...) ”.
Elle ajoute que “ ces principes revêtent une importance particulière
pour la presse ”, qui, “ si elle ne doit pas franchir les bornes
fixées en vue, notamment, de la protection de la réputation d'autrui ”,
peut néanmoins “ communiquer des informations et des idées sur les
questions politiques ainsi que d'autres thèmes d'intérêt général. ”.
La
Cour rappelle à cet égard que “les limites de la critique admissible sont
plus larges à l'égard d'un homme politique, agissant en sa qualité de
personnage public, que d'un simple particulier”. A l’évidence, dans notre
affaire, il s’agissait bien d’une affaire d’intérêt général, et M.
Calvet pouvait difficilement éviter la qualification de “personnage
public”.
S’agissant
du contrôle de proportionnalité exercé par la Cour, il n’est pas inutile de
se remémorer l'affaire Sunday Times[3],
où elle souligne que la liberté d'expression est assortie d'exceptions qui
appellent une interprétation étroite, et que le besoin de la restreindre doit
se trouver établi de manière convaincante. La presse doit avoir le droit de
diffuser des informations, et le public a le droit d'en recevoir. “S'il en était
autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de “chien de
garde”. Pour qu'une ingérence soit “nécessaire”, au sens de l'article 10
paragraphe 2, il faut démontrer l'existence d'un “besoin social impérieux”.
La
Cour insiste ainsi sur le rôle indispensable de la presse en tant que “chien
de garde” de la démocratie, en précisant, d’une part, que les juridictions
nationales ne peuvent se substituer à la presse pour dire quelle technique de
compte rendu les journalistes doivent adopter[4],
d’autre part, qu’un journaliste ne peut être tenu de révéler ses sources
confidentielles[5]. Le Canard Enchaîné
fait partie de ces “chiens de garde” ; ses plumes sont d’ailleurs souvent
plus acérées que les crocs de ses confrères.
La
protection de la liberté d'information ne permet pas cependant de justifier
certaines dérives. La jurisprudence européenne exige en particulier des
journalistes qu’ils se livrent à un travail rigoureux[6].
L’affaire Worm[7]
concerne un journaliste autrichien qui avait écrit des articles sur M. Androsch,
ancien ministre des Finances mis en cause dans plusieurs procédures pénales.
Dans l'un de ses articles, le journaliste avait écrit que la seule hypothèse
possible était celle d'une fraude fiscale commise par l'ancien ministre et que
sa défense sur ce point était “lamentable”. Pour ce passage, le
requérant fut condamné pénalement. La Cour conclut cependant qu’il n’y a
pas eu violation de l’article 10. Elle considère que le journaliste avait présenté
de manière excessivement négative un élément de preuve présenté par le
ministre des Finances au cours de son procès ; dès lors, il avait clairement
donné son avis sur la culpabilité de l'accusé et son article pouvait, d'une
certaine manière, influer sur l'issue du procès. Les conséquences néfastes
de l'article de presse sur l'impartialité du pouvoir judiciaire l'ont ainsi
emporté sur la liberté d'information.
Il
résulte de toute cette jurisprudence, couronnée par l’arrêt Fressoz et
Roire, que la publication par la presse d’informations portant atteinte
aux droits ou à la réputation d’autrui, ou à l’indépendance du pouvoir
judiciaire - on songe notamment à des informations publiées sur des procédures
pénales en cours - est efficacement protégée par la Cour de Strasbourg, tout
au moins lorsque ces publications répondent aux conditions suivantes :
-
la gravité de l'affaire dévoilée par la presse et son intérêt pour le
public ;
-
la rigueur du travail journalistique, qui ne doit pas se fonder sur des sources
fantaisistes (étant précisé que le journaliste n’est pas tenu de révéler
ses sources confidentielles) ;
-
la qualité de la personne dont les droits ou la réputation sont atteints (la
publication sera plus efficacement protégée lorsqu’elle concerne une
personnalité).
Au-delà
de cette fidélité à la jurisprudence de la Cour, l’arrêt Fressoz et
Roire invite à s’interroger de manière plus générale sur le droit de
la presse et sur l’utilisation de l’incrimination de recel, retenue par la
Cour d’appel de Paris pour condamner les deux journalistes du Canard Enchaîné.
En
soi, l’infraction de recel de photocopie provenant d’une violation du secret
professionnel n’est pas contraire à la Convention. Cependant,
lorsqu’il est fait usage de cette incrimination à l’encontre de
journalistes, les poursuites pénales heurtent de front le principe de la liberté
de la presse. On ne saurait ainsi sanctionner pénalement des journalistes qui
s’efforcent d’asseoir la crédibilité de leur travail en faisant état des
preuves matérielles qui fondent leurs écrits ou leurs propos.
Dans
ce domaine, d’autres instances judiciaires sont en cours dans notre pays. Il
en est ainsi, en particulier, de l’affaire dite des “écoutes de l’Elysée”.
MM. Pontault et Dupuis ont fait paraître, le 25 janvier 1996, un ouvrage
intitulé “Les oreilles du Président”, dans lequel sont reproduits
des pièces de la procédure suivie devant un juge d’instruction parisien pour
violation de l’intimité de la vie privée. Les deux auteurs ont été
poursuivis, à leur tour, à l’initiative de M. Gilles Ménage, concerné par
plusieurs des pièces de procédure reproduites dans l’ouvrage. Ils ont été
condamnés, le 10 septembre 1998, par le tribunal correctionnel de Paris, pour
recel de violation du secret de l’instruction ou du secret professionnel, à
5000 francs d’amende chacun (plus 50.000 francs de dommages et intérêts à
verser à M. Gilles Ménage).
Ce
jugement a été confirmé, dans toutes ses dispositions, par la Cour d’appel
de Paris, le 11 juin 1999. La Cour a notamment relevé, au sujet de l’article
10 de la Convention, invoqué par les prévenus, que, je cite : “les termes généraux
employés par la CEDH doivent être interprétés dans le cadre de l’Etat de
droit existant. En France, la garantie des libertés et celle du respect de la légalité
est constitutionnellement confiée à l’autorité judiciaire. La liberté
d’expression ressortit elle-même de textes qui sont appliqués par les
juridictions et ne participe pas d’un ordre juridique parallèle ou
concurrent. Obliger au respect des règles fondamentales du fonctionnement des
juridictions et des pratiques des auxiliaires de justice concourt au maintien
des caractères démocratiques de la société. A ce titre, les règles sur le
respect du secret de l’instruction comme celui du secret professionnel
permettent de protéger cette instance de trop fortes pressions comme elles protègent
également les intérêts essentiels des protagonistes de la procédure.
“Dès
lors, les limites auxquelles est soumise la liberté d’expression sont nécessaires
d’autant d’une part qu’il n’est pas établi que les contraintes exercées
en la cause aient nui de réelle façon à l’information de l’opinion,
compte tenu des articles parus sur le sujet. Et d’autre part qu’il n’est
pas plus établi que la justice se soit trouvée dans une impossibilité de
fonctionner dont il aurait fallu informer cette opinion.”
A
cela, la Cour d’appel ajoute que “tels ne sont pas le statut,
l’organisation et les enjeux du secret fiscal qui est au centre de l’arrêt Fressoz
et Roire lequel ne saurait constituer un précédent en l’espèce.”
Un
pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt. Il nous faudra donc
attendre que notre haute juridiction se prononce pour mesurer les exactes retombées
de l’affaire Fressoz et Roire.
Jean-Paul
COSTA
A.
Buchet vous a montré qu'il connaît parfaitement bien la jurisprudence de la
Cour de Strasbourg. Il a restitué l'arrêt Fressoz et Roire dans la
continuité de la jurisprudence avant et après le 1er novembre 1998. Je veux
simplement ajouter deux choses.
La
première : en effet, en 1999, la Cour européenne des droits de l'Homme a rendu
d'autres arrêts qui montrent une espèce de survalorisation de la liberté
d'expression, et notamment de la liberté de la presse, par exemple l'affaire Bladet
Tromso c. Norvège.
La
deuxième chose, c'est que par une sorte d'ironie de l'histoire, la plainte
qu'avait engagée M. Calvet à l'époque serait maintenant probablement à
contre-courant puisque vous savez que le Medef a décidé que les dirigeants
d'entreprise dévoileraient leur salaire...
Je
vais demander à Mlle Muscat, docteur en droit de cette Université et de cette
UFR de nous présenter son exposé sur l'hypothèque légale du fisc, à propos
de l'arrêt Lemoine qui a eu moins de retentissement. Nous aurons ensuite
un débat...
•
L’hypothèque légale du fisc :
l’affaire
Lemoine (arrêt du 1er avril 1999)
par
Hélène
MUSCAT
Docteur
en droit, IEDP, Université de Paris XI
La
question des interactions de la Convention européenne des droits de l’Homme
et du droit fiscal français est classiquement abordée à travers l’article 6
de la Convention, sous l’angle de la protection des droits et obligations à
caractère civil
et des accusations en matière pénale,
mais une autre disposition est en mesure d’intervenir dans ce domaine, c’est
l’article 1 du premier protocole additionnel qui est relatif au respect
des biens, et on en trouve une illustration avec l’affaire Lemoine qui
règle la question de la conventionnalité de l’hypothèque légale du trésor.
L’hypothèque
légale du trésor
fait partie des nombreux privilèges de l’administration fiscale qui
permettent de garantir ses créances. Son principe
est simple
: l’administration a la possibilité pour assurer le recouvrement de presque
toutes les impositions directes, indirectes, de constituer une hypothèque sur
toute la propriété immobilière du contribuable,
sous réserve de viser précisément chacun des immeubles frappés d’hypothèque
lors de l’inscription de cette dernière.
Le
mécanisme de l’hypothèque est très avantageux pour l’administration
fiscale puisqu’il lui confère un droit de préférence, elle est payée par
préférence aux créanciers non-inscrits sur le prix de vente de l’immeuble
donné en garantie-,
mais également un droit de suite -l’administration fiscale peut poursuivre
l’immeuble grevé de l’hypothèque entre les mains d’un acquéreur, et
donc d’une tierce personne, et faire vendre l’immeuble hypothéqué contre
l’acquéreur.
Malgré
tous ces avantages, l’hypothèque légale du Trésor est un procédure qui, au
regard de la doctrine de l’administration, doit être utilisée avec modération
; mais l’affaire Lemoine révèle cependant que la réalité peut être
toute autre.
Dans
cette affaire, un contribuable s’était vu notifier un redressement au titre
de l’impôt sur le revenu, redressement qui s’était accompagné de la
constitution par l’administration fiscale d’une hypothèque portant sur
l’intégralité de sa propriété immobilière, c’est à dire sur neufs
terrains dont la valeur totale était supérieure à un million de francs ;
cela, afin de garantir la créance de l’administration fiscale qui s’élevait
à un peu plus de quatre-vingt mille francs. M. Lemoine a contesté le montant
de la somme due et donc il a saisi les juges internes ainsi que les organes de
Strasbourg devant lesquels il a fait valoir que l’inscription d’une hypothèque
sur l’ensemble de ses biens aboutissait à une violation de l’article 1 du
premier protocole.
La Commission a accepté ses arguments par 13 voix contre 1,
mais la Cour, qui a été saisie alors que le délai de trois mois après le
rapport de la Commission était expiré, a déclaré la requête irrecevable.
Le Comité des ministres, s’est en conséquence prononcé sur l’affaire et
fait sien l’avis exprimé par le Commission.
L’affaire
Lemoine ne règle pas la question de savoir si l’hypothèque légale
dont bénéficie le Trésor est ou non conforme aux exigences de l’Etat de
droit ; ce dont on pourrait douter puisque l’hypothèque légale signifie la
garantie par une sûreté, d’une somme dont la détermination définitive
n’est pas toujours arrêtée -un recours juridictionnel pouvant être pendant-
; tel était d’ailleurs le cas dans l’affaire Lemoine.
Dans
son rapport, la Commission a conclu que l’inscription d’une hypothèque est
soumise aux exigences de l’article 1 du protocole 1 et elle a subordonné sa régularité
à la proportionnalité entre la prérogative mise en œuvre par
l’administration -l’hypothèque- et le but recherché -le recouvrement
d’une créance fiscale-. La Commission n’a donc, bien évidemment, pas
condamné le principe même de l’hypothèque légale du Trésor, mais elle a,
et cette position est extensible à toutes les hypothèques légales dont bénéficie
l’administration,
consacré une obligation de proportionner la valeur des biens hypothéqués à
celle de la créance.
Le
raisonnement qu’elle a suivi peut toutefois être critiqué à divers égards.
·
Tout d’abord, l’applicabilité de l’article 1 du protocole 1 n’allait
pas nécessairement de soi.
Cet
article est relatif au droit au respect des biens
et pour qu’il trouve à s’appliquer, il fallait considérer que
l’inscription d’une hypothèque porte atteinte aux biens soit en ce
qu’elle aboutit à une privation de propriété, soit en ce qu’elle
constitue une ingérence dans l’exercice du droit de propriété et donc dans
l’usage des biens.
Il
est bien évident que la constitution d’une hypothèque n’entraîne pas de
privation de propriété.
On pourrait également hésiter à considérer qu’elle porte atteinte à la
propriété. En effet, si le bien grevé d’une hypothèque peut être saisi et
faire l’objet d’une vente afin que les créanciers hypothécaires puissent
recouvrer leur créance, jusqu’à la saisie hypothécaire, le droit de propriété
demeure entier. En outre, dans l’hypothèse où un dégrèvement total serait
prononcé, c’est à l’administration fiscale qu’incomberait de procéder
à la mainlevée sans que cela entraîne de conséquences pécuniaires pour le
contribuable.
En
1982, à l’occasion d’une affaire concernant déjà la France, la Commission
avait envisagé l’hypothèque légale du trésor, “pour autant qu’elle
puisse être considérée comme une atteinte (...) au respect [des biens]”.
Elle n’avait donc pas expressément tranchée la question de sa soumission à
l’article 1.
Dans
l’affaire Lemoine, elle a affiné son analyse en considérant que, même
si l’hypothèque n’entraîne pas transfert de propriété ni interdiction de
cession, son existence limite de fait l’exercice du droit de propriété, d’éventuels
acquéreurs pouvant être découragés par l’exercice du droit de suite de
l’administration.
Cette position a été critiquée à juste titre dans une opinion dissidente par
M. F. Martinez puisque le requérant n’avait pas démontré qu’il avait été
empêché de vendre ses biens en raison de l’inscription.
La
position de la Commission est donc discutable ; mais elle n’est pas moins fondée
puisque certains actes de dispositions pouvant porter atteinte à la valeur de
l’immeuble sont interdits au propriétaire d’un bien grevé d’hypothèque.
L’hypothèque induit donc nécessairement une restriction de l’usage des
biens et à ce titre tombe dans le champ de l’article 1 du premier protocole
additionnel.
·
La Commission a ensuite considéré que l’atteinte aux biens était
disproportionnée, et sur ce point aussi son raisonnement est discutable.
L’article
1 du premier protocole additionnel précise dans son second paragraphe que le
droit au respect des biens ne porte pas atteinte “au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour (...)
assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes”.
Cette
disposition ne signifie pas, loin s’en faut, l’impossibilité d’un contrôle
sur de telles mesures. Ce contrôle existe et est le même que celui qui
sous-tend toute la protection du droit au respect des biens dans la Convention :
l’action de l’Etat doit répondre à l’intérêt général et un rapport
de proportionnalité doit exister entre la mesure imputable à
l’administration nationale et le but recherché.
Le
but d’intérêt général ne fait pas de doute : l’hypothèque légale du Trésor
répond à un souci de garantie des créances publiques et vise à assurer le
paiement des impositions ; elle répond de ce fait à un impératif d’intérêt
général. La question de l’existence d’un rapport de proportionnalité est
plus complexe ; mais en matière fiscale, la Cour recherche ce rapport de
proportionnalité en vérifiant si l’administration impose à l’intéressé
une charge spéciale et exorbitante.
Il
est intéressant de relever que jusqu’à l’affaire Lemoine, les
instances de Strasbourg n’avaient à aucune occasion condamné une atteinte
aux biens rentrant dans le cadre de l’article 1§2. L’administration fiscale
était en effet considérée comme devant bénéficier d’une marge de manœuvre
particulièrement large eu égard à sa mission ; et lors de son élaboration,
l’article 1§2 avait été compris comme réservant aux Etats le pouvoir
d’adopter toutes les lois fiscales jugées par eux souhaitables, dès lors que
les mesures adoptées dans ce domaine ne s’analysent pas en une confiscation
arbitraire.
Ainsi la Commission a-t-elle validé l’application à certaines sociétés
d’un impôt exceptionnel sur le capital
ou encore, et cela touche plus directement l’affaire Lemoine,
l’inscription d’une hypothèque conservatoire au profit de
l’administration fiscale en garantie de droits éludés.
L’affaire
Lemoine marque un tournant de cette appréciation car pour la première
fois la Commission va conclure à une violation du droit au respect des biens
dans le cadre de l’article 1§2. Selon elle, l’administration fiscale a méconnu
le principe de proportionnalité dans la mesure où d’une part elle a hypothéqué
l’ensemble de la propriété immobilière du contribuable, ce qui a aboutit à
l’inscription d’une hypothèque en garantie d’une dette au départ 12 fois
puis 24 fois, puisque le contribuable avait fait l’objet d’un dégrèvement
partiel, inférieure à la valeur des biens, et où d’autre part l’hypothèque
avait été maintenue nonobstant le paiement de la dette fiscale par le
contribuable.
Il
est nécessaire de reprendre chacun de ces points.
Hypothéquer
l’ensemble de la propriété privée est très avantageux pour
l’administration puisque en raison de l’indivisibilité de l’hypothèque
elle va pouvoir faire répondre de la totalité de la dette chaque immeuble.
Pourtant selon la Commission, l’administration aurait dû vérifier
l’existence d’un rapport d’adéquation entre la créance fiscale et la
valeur du bien grevé d’hypothèque ; un tel rapport d’adéquation étant
absent de l’affaire Lemoine. L’administration fiscale a donc
l’obligation d’évaluer précisément les biens et de faire correspondre
leur valeur avec celle de la créance fiscale.
On
peut d’abord s’interroger sur le bien-fondé de l’affirmation au niveau
européen d’une telle obligation. En effet, celle-ci existe d’ores et déjà
en droit français puisqu’une instruction de la comptabilité publique en date
du 20 mai 1992 invite les agents à respecter l’idée de proportionnalité
entre la dette fiscale et la valeur du bien hypothéqué. Ce n’est donc pas
une nouvelle obligation que fait naître le droit européen. A tout le moins la
position de la Commission devrait-elle inciter l’administration à un respect
plus strict de cette règle.
Ensuite,
le raisonnement de la Commission ne prend pas en compte la possibilité
qu’avait le contribuable d’obtenir la réduction des inscriptions hypothécaires
dont il avait fait l’objet sur le fondement de l’article 2161 du Code civil
; ce qui lui aurait permis de limiter l’atteinte aux biens qu’il prétend
avoir subi du fait de l’action de l’administration.
Le
fait d’avoir maintenu l’hypothèque malgré le paiement de la dette fiscale
par le contribuable est, selon la Commission, le second élément qui fait
apparaître l’utilisation de la technique de l’hypothèque disproportionnée
dans l’affaire Lemoine.
Il
semble à première vue surprenant que l’inscription n’ait pas disparue une
fois le paiement effectué. Toutefois une inscription hypothécaire est soumise
à un certain formalisme qui justifie qu’elle doive faire l’objet d’une
mainlevée expresse, à l’initiative du créancier ou du débiteur. La mainlevée
est effectuée auprès du conservateur des hypothèques et est assumée soit par
l’administration en cas de dégrèvement total, soit par le contribuable en
cas de paiement. Cette répartition peut être considérée comme équitable :
l’administration n’a pas à supporter la charge financière d’une
inscription justifiée par une manœuvre du contribuable visant à éluder le
paiement de l’impôt ; corrélativement, le contribuable n’a pas à assumer
le coût de poursuites initiées par l’administration fiscale qui se révéleraient
injustifiées. Aussi semble-t-il étonnant que la Commission impute à
l’administration fiscale l’absence de levée de l’hypothèque alors que
celle-ci incombait au seul contribuable.
La
position de la Commission dans l’affaire Lemoine n’est pas
condamnable dans sa solution car il y avait une disproportion évidente entre la
valeur du bien hypothéqué et celle de la créance ; mais on peut contester le
raisonnement qu’elle a suivi puisqu’à aucun moment elle ne s’est interrogée
sur la limitation de responsabilité qui découle du comportement du
contribuable et plus précisément de l’adage Nemo auditur bien connu
en droit français pas plus qu’elle ne s’est attachée aux garanties
fournies par le droit interne, garanties tenant à la possibilité pour le
contribuable d’obtenir une réduction de l’hypothèque ainsi que la levée
de cette dernière.
L’affaire
Lemoine n’en traduit pas moins l’extension du champ de la protection
fournie par la Convention et l’immixtion des organes de Strasbourg dans des
sphères, comme celle du recouvrement de l’impôt, où la marge de manœuvre
reconnue à l’Etat est traditionnellement importante ; cela afin d’affirmer
la primauté de la protection des droits des particuliers.
[1]
Cet aspect de l’affaire ne sera pas
évoqué dans la présente notice.
[2]
Cour EDH, Oberschlick c. Autriche, 23 mai 1991 (Série A, volume 204,
§ 57 et suivants).
[3]
Cour EDH, Sunday
Times c. Royaume-Uni, 26 novembre 1991 (Série A, volume 217, § 50).
[4]
Cour EDH, Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994 (Série A, volume
298, § 31). Voir également un arrêt récent
: Cour EDH, News Verlags c. Autriche, 11 janvier 2000 (non
encore publié).
[5]
Cour EDH, Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996 (§ 39 et suivants).
[6]
Fermin Bocos
Rodriguez c. Espagne,
décision de la Commission EDH du 12 avril 1996 (DR
85, page 141).
[7]
Cour EDH, Worm c. Autriche, 29 août 1997 (Recueil des arrêts et décisions,
n° 45, 1997-V).
Il stipule que :
“ Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit
international.
|