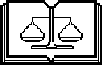|
L’éloignement
des étrangers : le débat sur l’intégration
L’affaire
Baghli (arrêt du 30 novembre 1999)
par
Béatrice
BOISSARD
Maître
de conférences, Université de Versailles-Saint Quentin
La
Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) ne garantit pas à l’étranger
le droit de ne pas être expulsé : aucune disposition de la Convention ne porte
sur cet aspect, excepté les cas d’expulsions collectives d’étrangers
(article 4, protocole n° 4). Par contre, elle lui accorde des garanties procédurales,
dès lors qu’il réside régulièrement sur le territoire d’un Etat (article
1, protocole n° 7).
Cette
protection procédurale fait partie des droits dérivés reconnus aux étrangers
par la Convention. Cependant, par une jurisprudence audacieuse, la Cour a
consacré par ricochet des droits non garantis aux étrangers, mettant en place
une protection indirecte par attraction de droits garantis par la Convention.
Ainsi, l’étranger jouit de droits comme le droit au recours effectif devant
une instance nationale (article 13), le droit à un contrôle juridictionnel
rapide de la légalité de la détention (article 5), le droit de mettre en
cause la responsabilité de l’Etat dans le cas où il pourrait subir ou
risquerait de subir un déni de justice flagrant dans un autre Etat (article 6),
le droit de ne pas être exposé à la torture ou à des peines et traitements
inhumains ou dégradants dans un Etat tiers à la Convention (article 3), et le
droit à une vie privée et familiale existante dans un Etat partie à la
Convention (article 8).
L’article
8, paragraphe 1, est devenu, depuis plusieurs années, un moyen de défense et
de protection de l’étranger. Deux arrêts de principe le confirment.
En
1985, la Cour européenne des droits de l’Homme affirme que le principe du
refoulement ou de l’éloignement de l’étranger d’un pays où vivent les
membres proches de sa famille peut porter atteinte à son droit à la vie
familiale et constituer une violation de l’article 8.
Trois ans après, elle franchit un nouveau seuil dans l’affaire Berrehab
où elle est amenée à préciser les incidences de l’article 8 sur l’éloignement
des étrangers : “lorsque l’étranger possède sur le territoire de l’Etat
où il réside des liens familiaux réels et que la mesure d’éloignement est
de nature à compromettre le maintien de ces liens, cette mesure n’est justifiée
au regard de l’article 8 que si elle est proportionnée au but légitime
poursuivi, c‘est-à-dire en d’autres termes si l’atteinte à la vie
familiale qui en résulte n’est pas excessive eu égard à l’intérêt
public qu’il s’agit de protéger”.
En
consacrant cette solution, elle accorde principalement une sécurité juridique
à l’étranger. Toutefois, elle en rappelle la limite : celle de la défense
de l’ordre public, pouvoir discrétionnaire de l’Etat. Dans sa décision Abdulaziz
et autres, elle précise que “d’après un principe général de droit
international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des
engagements internationa,ux découlant pour eux des traités, de contrôler
l’entrée des nationaux sur leur sol”.
La Commission tend à admettre que l’article 8 n’interdit pas aux Etats d’éloigner
les étrangers dès lors que cela est nécessaire à la défense de l’ordre
public.
Cependant,
la Cour franchit une nouvelle étape en étendant cette protection aux étrangers
intégrés délinquants, appelés également immigrés de la seconde génération.
Il se dégage de sa jurisprudence des critères qui tendent à ne pas perdre de
vue deux grands principes : le principe de souveraineté des Etats et le
principe de solidarité. Le premier commande la préservation des intérêts
publics, et de ce fait, l’Etat a la faculté d’expulser les délinquants ;
le second, fondé sur le caractère objectif des droits de l’Homme, légitime
l’exercice d’un contrôle de l’adéquation des mesures étatiques aux fins
légitimes qu’elles prétendent poursuivre. C’est donc à travers les hypothèses
de l’alinéa 2 de l’article 8 (sécurité nationale, sûreté publique,
bien-être économique du pays, défense de l’ordre public, prévention des
infractions pénales, protection des droits et liberté d’autrui), que la
Commission et la Cour examinent si le droit au respect de la vie privée et/ou
familiale du requérant a été violé par un Etat.
Cette
jurisprudence se révélera finalement favorable à l’étranger intégré délinquant.
Il en découle trois lectures de l’article 8. L’étranger non intégré relève
de l’article 8, paragraphe 1, exceptionnellement l’étranger délinquant relève
de l’article 8, paragraphe 2, et exception de l’exception, l’étranger délinquant
intégré relève de l’alinéa 2 mais la protection de l’ordre public ne
suffit pas à justifier son éloignement.
Mais,
à partir de 1990, la Cour inverse sa jurisprudence. En utilisant habituellement
les hypothèses du paragraphe 2 de l’article 8, elle construit une nouvelle
jurisprudence défavorable aux étrangers intégrés délinquants.
Ce
revirement a toujours été prévisible. En effet, les arrêts, reconnaissant
systématiquement la violation de l’article 8, font l’objet de débats au
sein même de la Cour, et l’unanimité n’est jamais acquise. Il en est de même
pour les arrêts consacrant la non-violation de l’article 8 par les Etats.
Dans
ce contexte, la solution de l’arrêt Baghli ne surprend pas : il
n’est que la continuité d’un ensemble de décisions. En effet, la Cour a
entamé un revirement spectaculaire et considère désormais que l’étranger
intégré délinquant n’a plus de vie privée et/ou familiale en raison de
deux critères : un passé pénal important ainsi que l’existence de liens
familiaux et/ou culturels avec son pays d’origine (I).
Si
cette solution, semble bien être le fruit de divergences de point de vue entre
les juges au sein même de la Cour, il est clair que certains juges n’ont pu
imposer une conception qui aurait réglé le problème, et qui repose sur la
reconnaissance d’une nouvelle catégorie juridique, celle des quasi-nationaux
(II).
I
• L’absence d’atteinte à la vie privée et familiale pour l’étranger
intégré délinquant.
Le
revirement de la Cour est précédé par de nombreuses décisions
d’irrecevabilité de la Commission en matière d’expulsion ou
d’interdiction du territoire.
Cette
dichotomie entre les organes de la Cour démontre déjà la difficulté de définir
les critères permettant de distinguer les cas où l’article 8, paragraphe 1
s’appliquerait et les cas où au contraire le paragraphe 2 l’emporterait.
Cette
progression dans la sévérité s’explique par une analyse comparative des
faits. Jusqu’ici, la Cour met en balance les paragraphes 1 et 2 de l’article
8. Elle privilégie l’effectivité de la vie privée et/ou familiale de
l’individu sur le territoire, déduisant que la mesure d’expulsion ou d’éloignement
prise par l’Etat relève d’une ingérence disproportionnée par rapport à
une société démocratique. Systématiquement, l’Etat était condamné pour
violation de l’article 8, même si la mesure était prévue par la loi et
avait un but légitime, répondant aux différentes hypothèses posées par le
paragraphe 2 de l’article 8 (A).
Mais
dès les années 90, on note un infléchissement de la Cour : elle attribue
à nouveau une grande importance à la gravité des infractions commises par le
requérant ainsi qu’à l’absence de liens avec le pays d’origine pour
pouvoir conclure à une non-violation de l’article 8 (B).
A
• La priorité donnée à l’effectivité de la vie privée et familiale de
l’étranger intégré délinquant
En
cette matière, celle des droits des étrangers, la Cour a appliqué sa méthode
classique du contrôle de proportionnalité. D’une part, elle tend à prendre
en compte l’intérêt privé de l’étranger, celui du respect de sa vie privée
et familiale, conformément à l’article 8, paragraphe 1 de la CEDH. D’autre
part, elle tend à ne pas s’immiscer dans l’intérêt de l’Etat, à savoir
la protection de l’ordre public, lorsque l’étranger est indésirable pour
avoir commis une infraction pénale dont la sanction administrative se traduit
par une mesure d’expulsion (ou une interdiction définitive du territoire), et
ce conformément au paragraphe 2 de l’article 8.
On
aurait pu croire que cette protection par ricochet ne concernerait que des cas
d’espèce précis : celui du regroupement familial. Dans l’affaire Abdulaziz
et autres, il s’agit d’époux se voyant refuser l’autorisation de
rejoindre leurs épouses. Dans l’affaire Berrehab, un ressortissant
marocain se voit refuser le prolongement de son séjour alors que sa fille de
nationalité néerlandaise vit sur le territoire néerlandais, où lui-même a vécu.
Pourtant,
la Cour étend sa jurisprudence aux étrangers délinquants, plus précisément
aux étrangers intégrés délinquants. Utilisant son contrôle de
proportionnalité, elle dégage un faisceau d’indices, conduisant à penser
que ces étrangers sont également protégés contre les mesures d’éloignement
prises par les Etats.
Aussi
il est indispensable de rappeler les critères ou plutôt le faisceau
d’indices dégagé par la Cour qui menait irrémédiablement à la
condamnation de l’Etat pour violation de l’article 8 en son ensemble.
Ce
faisceau d’indices a été dégagé à l’occasion des arrêts Moustaquim,
Beljoudi
et Nasri.
La
Cour prend donc en compte un élément principal et en écarte deux autres.
Elle
ne retient ni la nationalité, ni le passé pénal du requérant.
-
D’une part, la Cour fait abstraction de la nationalité étrangère du requérant ;
M. Moustaquim est d’origine marocaine, Messieurs Beljoudi et Nasri sont de
nationalité algérienne. Pourtant, la nationalité est un élément important
en droit international
: elle est considérée comme “un lien juridique d’allégeance politique
avec l‘Etat (…), un lien juridique ayant à sa base un fait social de
rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts, de
sentiments, jointe à une réciprocité de droits et de devoirs ”. Cette
définition illustre bien la compétence exclusive de l’Etat sur son national
mais également sur l’étranger qui vit sur son territoire.
Si
la Cour avait retenu ce critère comme un élément indiscutable, l’étranger
délinquant serait donc expulsable, abstraction faite de tout autre élément.
Ici, la Cour semble assimiler l’étranger au national. Et surtout, elle ne
semble pas considérer explicitement la nationalité comme une justification
“objective et raisonnable ”, comme le souligne le juge Martens.
Peut-être souhaite-t-elle inviter les Etats à considérer les étrangers comme
des nationaux, dès lors qu’ils sont intégrés à la société d’un Etat.
Encore faut-il définir ce que l’on doit entendre par “étranger intégré ”
?
-
D’autre part, la Cour ne retient pas le passé pénal du requérant. Elle ne
souligne pas non plus le fait que le requérant a purgé la ou les peines de
prison sur le territoire de l’Etat. Cet élément est essentiel car la
principale argumentation des Etats est de démontrer que c’est en raison des
infractions commises par l’étranger que ce dernier est soumis à une mesure
de police administrative (c’est-à-dire de prévention).
La durée de l’emprisonnement ainsi que la gravité des infractions commises
lui importent peu, même si certains requérants ont un passé pénal extrêmement
chargé par rapport à d’autres.
Ainsi, estime-t-elle que, malgré des peines d’emprisonnement répétées,
Messieurs Moustaquim, Beljoudi et Nasri bénéficient de l’article 8.
Le fait que ce sont des récidivistes n’entre pas non plus en ligne de compte.
Il en est de même de la gravité des faits retenue par les Etats, et défendue
par certains juges de la Cour
: vols, viols, coups et blessures volontaires, trafic de drogue…
Quant
à l’élément principal, il repose à la fois sur l’existence réelle
d’une vie familiale et/ou privée du requérant et l’absence de liens avec
son pays d’origine.
Trois
éléments ont été retenus : - la durée et la nature du séjour (arrivée
sur le territoire en bas âge de l’individu ou naissance sur le territoire),
le contexte familial (intensité de vie familiale, intégration de la famille
qui se traduit notamment par l’acquisition de la nationalité de l’Etat par
plusieurs membres de la famille, vie familiale avec une épouse ou un époux de
nationalité de l’Etat d’accueil ou concubine et enfants), le contexte
professionnel (exercice d’un métier sur le territoire).
Cet
élément l’emporte sur tous les autres car il justifie l’existence d’une
vie privée et surtout familiale effective, conformément au paragraphe 1 de
l’article 8. On note même, de la part de la Cour, une progression qui
s’explique bien sûr par le fait que chaque cas d’espèce est différent,
mais qui constitue un ensemble d’indices.
Dans
le cas de M. Moustaquim, sa vie privée et familiale est effective, car au
moment des faits reprochés, il réside de façon ininterrompue avec ses parents
et ses trois frères et sœurs dont l’un de nationalité belge. Et les fugues
répétées ne peuvent être assimilées à une vie occasionnelle voire épisodique.
En outre, il travaille sur le territoire. Enfin, lors de ses incarcérations, il
a bénéficié de peines légères mais également par deux fois d’un congé pénitentiaire
qui se serait déroulé sans incident.
Dans
le cas de M. Beljoudi, sa vie privée et familiale effective se fonde sur sa vie
de couple avec une française.
La mesure d’expulsion porte donc atteinte non seulement au requérant, mais également
à sa femme qui pourrait certes le suivre en Algérie mais connaîtrait un
profond déracinement ne connaissant pas la langue du pays et ayant toutes ses
attaches en France.
Le
cas Nasri est très particulier mais l’argumentation de la Cour ne doit pas être
négligée. En effet, M. Nasri, sourd-muet de naissance et de nationalité algérienne,
arrive en France à l’âge de cinq ans. Les portes de l’éducation lui sont
la plupart du temps fermées en raison de son état ou de l‘impossibilité
pour ses parents de subvenir aux frais de scolarité ou d’hébergement. Son
comportement brutal est mis en cause également.
Au-delà
de la condamnation de l’Etat pour violation de l’article 8, la Cour fait
apparaître la responsabilité de l’Etat qui n’a pas su mettre en place les
moyens et les conditions de son intégration à la société française.
On peut également appliquer cette réflexion aux affaires Moustaquim et
Beljoudi dans le sens où, là encore, l’Etat n’assume pas ses
responsabilités : il a intégré ces deux individus à la société, puis une
fois, les infractions commises, il souhaite s’en débarrasser.
A
travers ces cas d’espèces, la Cour applique sa définition extensive de la
vie privée et familiale.
Deux
constats peuvent être faits à la suite de ces arrêts.
-
Qu’importe la gravité des faits commis par l’étranger intégré, la mesure
d’expulsion, même prévue par la loi et ayant des buts légitimes, en l’espèce
la défense de l’ordre public, est considérée comme une atteinte à la vie
privée et familiale du requérant car elle constitue un déracinement. L’étranger
a construit sa vie (familiale, culturelle, professionnelle) sur le territoire de
l’Etat, et a souvent coupé les ponts avec son pays d’origine.
-
En insistant sur la compétence exclusive des Etats en la matière, la Cour
impose un cadre qu’ils ne peuvent dépasser : le passé pénal de l’individu
ne suffit pas à emporter la non-violation de l’article 8, même si la mesure
d’expulsion répond à deux critères de fond : le fait qu’elle est prévue
par la loi et qu’elle poursuit un but légitime.
Par
ailleurs, il ne revient pas à la Cour de condamner les politiques
d’immigration des Etats, mais les modalités de leur mise en œuvre.
La
Cour elle-même prend soin de rappeler le respect de la souveraineté des Etats
en la matière, limitant ainsi sa jurisprudence, mais elle restreint également
l’action des Etats en précisant que la mesure d’expulsion doit être
justifiée par un besoin social impérieux.
Ce
besoin social impérieux est donc un ensemble qui concilie principe de
souveraineté et principe de solidarité. Pour autant, elle se refuse à déterminer
de manière précise ce qu’elle entend par cette expression et quelle conséquence
définitive elle doit entraîner. Autrement dit, il n’est pas certain que
l’article 8 garantira un droit aux étrangers délinquants intégrés de ne
pas être expulsés.
Cependant,
on ne peut ignorer qu’au sein même des juges de la Cour, il n’y a pas
unanimité sur la matière. Deux grandes oppositions se distinguent.
L’une
veut faire clairement peser le principe de solidarité sur celui de souveraineté.
C’est la voie choisie par le juge Morenilla et d’autres,
qui condamnent l’aspect de “persona non grata”. “ La mesure
d’expulsion de ces “non-ressortisants” dangereux peut s’avérer expédient
pour l’Etat qui se débarrasse ainsi de personnes considérées comme “indésirables”,
mais elle se révèle cruelle et inhumaine
et clairement discriminatoire à l’égard des “ressortissants” qui se
trouvent dans de telles circonstances. L’Etat qui, pour des raisons de
convenance, accueille les travailleurs immigrés et autorise leur résidence,
devient responsable de l’éducation et de la socialisation des enfants de ces
immigrés tout comme il l’est des enfants de ses “ citoyens ”.
En cas d’échec de cette socialisation, dont les comportements marginaux ou délictueux
sont la conséquence, cet Etat est aussi tenu d’assurer leur réinsertion
sociale au lieu de les renvoyer dans leur pays d’origine,
qui n’a aucune responsabilité pour ces comportements et où les possibilités
de réhabilitation dans un milieu social étranger s’avèrent illusoires.
Sans
pour autant s’aligner sur l’opinion du juge Morenilla, certains
estiment qu’il serait nécessaire que la Cour indique avec plus de précision
les seuils de condamnations et de récidives, les handicaps physiques et
linguistiques, la nature des crimes et délits, le contenu de la vie familiale
et la définition de la communauté familiale à protéger au sens de
l’article 8, la définition de l’ordre public européen en considération
desquels la décision d’expulser devrait être jugée contraire à l’article
8.
L’autre
estime que la Cour nourrit une sorte d’impunité pour le requérant qui fait
“si bon marché du droit à la sûreté et du droit au respect des biens des
futures victimes”.
La Cour ne devrait pas faire de différence entre les atteintes aux biens et les
atteintes aux personnes. L’intérêt général de la société ne peut être
comparé et confronté à l’exercice des infractions.
La
position du juge Morenilla est fondamentale car il fait appel à la
responsabilité de l’Etat ; ce dernier doit assumer les échecs des étrangers
intégrés, au même titre que ceux des nationaux.
On
peut donc regretter la timidité de la Cour qui ne condamne pas fermement la
mesure d’expulsion comme une mesure s’ajoutant à une peine déjà purgée,
ce qui forme ainsi une sorte de double peine. Ces arrêts auraient pu être
l’occasion de condamner définitivement ce système et d’affirmer que la
mesure d’expulsion est une mesure portant atteinte à la vie privée et
familiale de l’étranger dès lors qu’elle est mise en action par les
autorités publiques.
Cette
prise de position aurait eu le mérite de confirmer que l’étranger intégré,
surtout délinquant, bénéficie de la même situation que le national, délinquant,
parce que lui aussi est né ou est arrivé en bas âge sur le territoire du pays
d’accueil, que le choix (volontaire ou non) de ses parents de le voir s’intégrer
la société le rend inexpulsable, malgré ces infractions.
L’impunité
n’existe pas dans nos sociétés actuelles. L’impunité existerait si
l’individu jouissait de la mesure d’expulsion sans être jugé pour ses
crimes. Là, ce serait socialement dangereux.
La
position du juge Morenilla pose, explicitement, la problématique qui sous-tend
le contentieux du droit des étrangers : l’étranger intégré, délinquant ou
non est-il assimilable à un national ?
Ainsi,
la Cour obligerait l’Etat à renoncer à son droit d’expulser. Cette
position n’aurait rien d’amoral. En effet, l’Etat a toujours condamné pénalement
tout individu quelle que soit son origine. On remarque toujours que l’Etat a
commencé par condamner l’étranger intégré, et que ce dernier a purgé sa
peine. Mais l’Etat semble croire que cela ne suffit pas, et par conséquent
utilise systématiquement la mesure d’expulsion.
Or
en confirmant itérativement le droit de l’Etat d’éloigner ses étrangers,
elle permet à ce dernier de protéger son ordre public. Ne le fait-il déjà
pas en infligeant au requérant une sanction pénale ?
B
• La priorité donnée à l’importance du passé pénal et au maintien de
liens avec le pays d’origine de l’étranger délinquant
Ce
souci de concilier principe de solidarité et principe de souveraineté a
conduit la Cour, sans aucune raison objective, à part celle de la divergence
des juges, à renverser sa jurisprudence. Les hypothèses de l’alinéa 2 sont
toujours mises en balance avec le respect de la vie privée et/ou familiale de
l’individu.
Arrivé
en France à l’âge de deux ans, M. Baghli y a résidé avec sa famille, a
suivi sa scolarité et fréquente une ressortissante française. Il commet une
infraction : le trafic de drogue.
C’est
encore l’occasion pour la Cour de confirmer que le lourd passé pénal de
l’individu ainsi que l’attachement à son pays d’origine par le maintien
de sa nationalité et de liens sociaux et culturels n’entraînent pas le déracinement
de ces individus.
Son
contrôle de proportionnalité existe toujours, mais il est clair que la Cour
retient plus difficilement l’effectivité de la vie privée et/ou familiale
des requérants.
La
Cour retient plus facilement l’existence de liens avec le pays d’origine.
Ainsi,
dans l’affaire Baghli, la Cour juge que ce dernier n’a ni vie privée
ni vie familiale, malgré le fait qu’il est arrivé en bas âge en France,
qu’il y a suivi sa scolarité, qu’il y travaille et y vit en concubinage.
Ces éléments auraient dû être suffisants pour juger de l’existence
effective d’une vie privée et/ou familiale.
Pourtant,
la Cour s’y refuse. M. Baghli n’a pas de vie privée et/ou familiale, même
s’il a vécu de manière interrompue avec sa famille. Le requérant n’aurait
pas apporté la preuve qu’il entretenait des relations étroites ou des liens
de dépendance avec sa famille. Pour asseoir cette idée, les juges font référence
à la continuité de liens entretenue par M. Baghli avec son pays d’origine.
Le requérant a fait son service militaire en Algérie pendant un an et y a passé
régulièrement des vacances. Ce qui implique la connaissance de la langue et
des liens forts avec son pays d’origine.
On
retrouve cette même formule dans des arrêts précédents, Boughanemi,
Bouchelkia,
Boujaïdi
et Dalia.
Né
en Tunisie, M. Boughanemi entre en France à l’âge de 8 ans avec sa famille
dont certains membres ont la nationalité française. Il y vit pendant 20 ans.
Vivant en concubinage avec une française, il a un enfant né en 1993 qu’il
reconnaît en 1994. A partir de 1981, il est condamné pour plusieurs
infractions (vol, proxénétisme, coups et blessures volontaires) et est frappé
d’une mesure d’expulsion. Il revient en tant que clandestin en France où il
vit 6 ans.
La
Cour estime qu’il n’y a pas violation de l’article 8 car elle considère
que M. Boughanemi n’a pas de vie effective en France. Elle lui reconnaît un
semblant de vie familiale après l’exécution de la mesure d’expulsion.
Revenu dans la clandestinité, M. Boughanemi aurait à ce moment entretenu, avec
sa concubine, une vie commune qui s’est traduite par la naissance d’un
enfant, et à ce moment, l’expulsion aurait bien constitué une atteinte au
respect de la vie familiale.
En
outre, le requérant a maintenu des liens avec son pays d’origine : il a gardé
sa nationalité tunisienne et ne semble avoir fait aucun effort pour devenir
français et il confirme la connaissance de la langue arabe ainsi que le
maintien de liens avec son pays natal.
La
solution retenue pour l’affaire Bouchelkia repose sur les mêmes
arguments : il n’aurait pas rompu avec son pays d’origine. Il a été envoyé
en 1986 au “village”, séjour qui lui a été bénéfique pendant ses
vacances scolaires et, il comprend la langue arabe. La Cour semble donc considérer
que cette période vécue par le requérant amenuise l’effectivité d’une
vie privée et familiale sur le territoire de l’Etat d’accueil. La mesure
d’expulsion n’entraîne donc pas de déracinement de M. Bouchelkia, et de ce
fait justifie sa qualité de mesure de sauvegarde de l’ordre public.
La
motivation de la Cour est choquante. En effet, Messieurs Baghli, Boughanemi et
Boulchelkia sont des étrangers intégrés en raison de la durée de leur séjour
sur le territoire d’accueil et, de liens familiaux, sociaux, scolaires,
professionnels et culturels. Le fait que M. Baghli ait fait son service
militaire ne peut suffire à faire pencher la balance, d’autant qu’il ne
s’est absenté que pendant deux ans. Le requérant a démontré sa volonté de
continuer à construire sa vie en France. Il s’est plié à une obligation et
est ensuite revenu en France.
En
quoi le fait de parler sa langue d’origine ou le fait de faire des voyages réguliers
dans son pays d’origine manifestent-ils une faiblesse des liens avec le pays
d’accueil ?
En
fin de compte, n’est-il pas logique de se rappeler d’où l’on vient sans
pour autant renier son désir de continuer à vivre dans son pays d’accueil,
d’autant que le choix n’a jamais été donné aux requérants. Ils ont suivi
leur famille.
Cette
volonté de la Cour de démontrer qu’il ne peut y avoir de déracinement dès
lors que l’étranger connaît la langue de son pays d’origine et/ou y a fait
des séjours a déjà été rappelé dans les affaires Boujaïdi
et Dalia.
Or, dans les affaires Moustaquim, Beljoudi et Nasri, les requérants ne
semblent pas avoir tenté d’acquérir la nationalité française et vivaient
ou ont vécu de manière interrompue avec leur famille.
Il
est plus étrange encore que la Cour estime que la présence d’un enfant ou le
simple fait de vivre en concubinage ne sont pas des éléments essentiels.
Dans
l’affaire Dalia, les conséquences de l’éloignement du territoire de
la requérante sur son enfant, de nationalité française, ne sont pas retenues.
Comment peut-on affirmer que Mlle Dalia n’a pas de vie familiale sur le
territoire ? Le fait que son enfant est en bas âge ne contrevient pas à
son renvoi : ce dernier devrait pouvoir s’adapter, et qu’importe
qu’il soit de nationalité française.
Dans
l’affaire Baghli, la Cour dénie à M. Baghli toute vie familiale avec
sa concubine, préférant l’expression “ relation sentimentale ”,
puisqu’elle ne s’est pas traduite par la naissance d’un enfant. Est-ce une
nouvelle approche de la notion de vie privée ? Si on peut admettre que M.
Baghli n’a pas de vie familiale avec sa concubine, il est difficile de croire
que la notion de vie privée ne peut pas lui être appliquée. Or on constatera
que la Cour n’a pas hésité à adopter une conception de plus en plus
extensive de la vie privée. La Cour ne précise-t-elle pas, dans l’affaire Niemetz,
que l’article 8 couvre non seulement la sphère intime des relations
personnelles, mais également le droit pour l’individu de nouer et de développer
des relations avec ses semblables ?
La
Cour retient donc plus facilement l’existence de liens avec le pays
d’origine, qu’avec le pays d’accueil.
La
Cour retient également le passé pénal de l’individu.
Il
en est de même pour le passé pénal de l’individu. La Cour semble avoir défini
parmi les objectifs de défense de l’ordre public que le trafic de drogue est
un élément qui empêche l’étranger intégré d’échapper à la mesure
d’éloignement. Cet élément était déjà apparu dans les affaires Boujaïdi
et Dalia
: le trafic de drogue est assimilé à un dangereux commerce et “(…) Au vu
des ravages de la drogue dans la population, la Cour conçoit que les autorités
fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à
la propagation de ce fléau ”. La formule est reprise dans l’arrêt Baghli
. Il est incontestable que l’infraction commise constitue une atteinte grave
à l’ordre public et à la protection de la santé d’autrui. Or, au vu des
ravages de la drogue dans la population, la Cour conçoit que les autorités
fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à
la propagation de ce fléau ”.
Une
question se pose : si le trafic de drogue est un facteur doublement pénalisant
pour le requérant, en est-il de même pour toutes les infractions commises par
l’étranger intégré délinquant ? Rappelons que Messieurs Boughanemi et
Bouchelkia n’ont pas participé à un trafic de drogue ; l’un a été
accusé de proxénétisme aggravé, l’autre de viol avec violences, et de vol
stipulé commis pendant sa minorité. La Cour a bien souligné le lourd passé pénal
de ces requérants,
pour autant, elle n’a pas été jusqu’à les qualifier de “ fléau ”.
Ces infractions, au même titre que le trafic de drogue, sont des infractions
graves, mais elles ne peuvent justifier l’éloignement de l’étranger intégré.
A ce moment, qu’en est-il du national qui commet ce même type d’infraction
? Il est puni, au même titre que l’étranger intégré ou non intégré. La
Cour semble donc retenir un critère, celui des atteintes aux personnes victimes.
En
introduisant dans la balance le passé pénal, la Cour adopte une solution
choquante. Est-ce que les délinquants les plus endurcis seraient moins protégés,
et n’auraient donc pas droit ou moins le droit à une vie familiale normale ?
L’affaire
Baghli confirme donc plus un revirement qu’un infléchissement de la
jurisprudence de la Cour. Ces affaires marquent le retour à la liberté des
Etats de pouvoir éloigner leurs étrangers, sans encourir la sanction de la
Cour. Ils sont les seuls, en fin de compte, à définir et à protéger leur
ordre public propre. Quant à l’étranger, il demeure soumis à la volonté
des Etats.
II
• L’étranger demeure un étranger
“En
résumé, M. Baghli est un immigré de la seconde génération, un quasi-Français,
dont la très grande majorité des attaches familiales, sociales,
professionnelles, culturelles se trouvent en France”, opinions dissidentes et
communes des juges Costa et Tulkens.
L’arrêt
Baghli ne fait que confirmer, qu’à l’instar de l’arrêt Abdulaziz
et autres, l’article 8 n’emporte pas obligation pour l’Etat de ne pas
expulser ses étrangers intégrés délinquants, et ce malgré leur présence
sur le territoire pendant un grand nombre d’années.
Par
conséquent, la thèse selon laquelle la solution générale ne jouait pas en
faveur des immigrés de seconde génération est totalement remise en cause. Les
décisions de principe Moustaquim et Beljoudi démontraient
l’attention particulière portée par la Cour au fait que l’étranger a sa
vie familiale effective dans l’Etat d’accueil et n’a avec son Etat
d’origine, hors le lien de nationalité, aucun lien réel.
Autrement
dit, il semblait d’une part, que la Cour alignait la situation des immigrés
de seconde génération sur celle des “nationaux ”, dont le protocole
4, article 3, interdit l’expulsion, et d’autre part, qu’elle avait formé
un concept tendant à les protéger, celui de quasi-national (A).
Doit-on
déduire que la Cour juge que l’étranger, intégré ou pas, ne dispose pas de
la jouissance de droits fondamentaux comme tout individu ? Pourtant, elle a
été à l’origine de la juridictionnalisation du contentieux du droit des étrangers
en imposant à l’Etat, et plus particulièrement aux juridictions internes
d’intégrer l’article 8 (B).
A
• Le refus du concept de quasi-national
L’article
3 du protocole n° 4 précise que “ Nul ne peut être expulsé, par voie
de mesure individuelle ou collective, du territoire de l’Etat dont il est le
ressortissant ”. On retrouve le contenu de cet article, dans des clauses
analogues, à l’article 12, paragraphe 4, du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (PIDCP) : “Nul ne peut être arbitrairement privé
du droit d’entrer dans son propre pays”.
Clause
analogue mais non similaire. En effet, la CEDH retient le terme
“ressortissant”, tandis que le PIDCP retient celui de “propre pays”.
D’après
une partie de la doctrine, la référence à la notion “propre pays”
signifierait que le PIDCP interdirait l’expulsion non seulement des nationaux
mais également des étrangers intégrés.
Toutefois,
en 1996, le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies (CDH-ONU) a précisé
ce qu’il entendait par cette notion dans l’affaire Stewart c. Canada.
Né en Ecosse, Charles E. Stewart arrive au Canada à l’âge de 7 ans avec sa
mère, rejoignant son père et son frère aîné. Pour cause de criminalité, il
est sous le coup d’un arrêté d’expulsion du Canada.
L’argumentation
de M. Stewart est de démontrer qu’il s’est toujours considéré comme un
“citoyen canadien”, sans avoir la nationalité de ce pays.
Pour le Canada, il n’est qu’un simple résident permanent, ses parents
n’ayant jamais demandé la citoyenneté canadienne pour lui quand il était
enfant.
En outre, le Canada rappelle que “les règles internes et internationales
relatives aux droits de l’Homme montrent clairement que le droit de rester
dans un pays et de ne pas être expulsé vise exclusivement les ressortissants
de l’Etat (…) Il est reconnu que, s’agissant des non-nationaux, ces droits
sont détenus dans certaines conditions, seulement, et sont plus limités que
dans le cas des nationaux”. Autrement dit, M. Stewart n’a jamais acquis un
droit conditionnel à demeurer au Canada comme dans son “propre pays”.
La
réponse du Comité est nuancée.
Le
Comité précise que la notion de “propre pays” est une notion plus vaste
que celle de “ pays de nationalité ”, sans pour autant la
recouvrir
- la notion de ressortissant entre dans cette catégorie : “La notion
contestée n’est pas limité à la nationalité au sens strict du terme, à
savoir la nationalité conférée à la naissance ou acquise par la suite”.
Elle fait donc référence à “un étranger qui se trouve légalement sur le
territoire d’un Etat partie” pour restreindre les droits des Etats
d’expulser une personne considérée comme “étranger”. Cette notion
s’applique donc aussi bien aux nationaux qu’à une certaine catégorie de
personnes, qui tout en n’étant pas des nationaux, ne sont pas moins des étrangers.
Elle semble bien considérer que certains étrangers bénéficient du droit de
ne pas être expulsés, au même titre qu’un national.
Mais,
cette affirmation est rapidement tempérée. Parmi ces non-nationaux, le Comité
inclut les apatrides ainsi que les personnes dont le pays de nationalité aurait
été intégré ou assimilé à une autre entité. Par contre, il exclut de
cette catégorie des personnes qui ont la possibilité d’entreprendre des démarches
pour acquérir la nationalité du pays où elles résident. La notion de
“propre pays” ne jouerait que pour celles rencontrant des difficultés, des
obstacles déraisonnables, dus au pays lui-même.
L’immigrant qui n’acquiert pas cette nationalité, soit par choix, soit du
fait d’actes qu’il a commis et qui le privent de la possibilité de l’acquérir,
ne peut considérer le pays d’immigration comme son propre pays.
Il
est à noter que cette solution n’a pas été partagée par tous les membres
du Comité.
Ces derniers estiment que le Comité a une conception trop étroite de
l’article 12, paragraphe 4. L’opinion de M. Prafullachandra rejoint celle du
juge Morinella et d’autres : “je ne vois pas de raison acceptable
d’exclure ainsi certaines catégories de personnes, à moins que la majorité
ait considéré à l’avance qu’elles ne répondaient pas aux critères fixés,
du fait qu’il en irait alors des politiques d’immigration des pays développés”.
Le facteur de la résidence permanente ne le satisfait pas, mais il estime que
ce facteur combiné à d’autres (liens sociaux, culturels, professionnels…)
devrait suffire à déterminer si le pays d’accueil est le “propre pays”
de la personne concernée. De même, il considère que la non acquisition de la
nationalité, pour quelque raison que ce soit, n’entraîne pas que la notion
de “propre pays” soit appliqué à l’immigrant.
Ces
opinions dissidentes démontrent bien, à l’instar de celle des juges de la
Cour européenne des droits de l’Homme, que le débat sur l’intégration est
toujours d’actualité.
En
retenant la référence au terme “ressortissant”, la Convention exclut
clairement pareille extension du droit et rejoint la jurisprudence du CDH-ONU.
Par “étrangers”, il faut entendre “tous ceux qui n’ont pas un droit
actuel de nationalité de l’Etat sans distinguer, ni s’ils sont simplement
de passage ou s’ils sont résidents ou domiciliés, ni s’ils sont des réfugiés
ou s’ils sont entrés dans le pays de leur plein gré, ni s’ils sont
apatrides ou possèdent une autre nationalité”.
L’étranger intégré est encore considéré comme ne pouvant être assimilé
à un quasi-national parce qu’il n’a pas la nationalité de l’Etat
d’accueil.
Si
la référence à la notion de ressortissant ne peut être retenue en raison de
son lien avec la notion de “nationalité”, celle de quasi-national pouvait
justifier le maintien de la jurisprudence de la Cour d’avant 1990.
Cette
référence à la notion de quasi-national semble avoir été le fil conducteur
de la jurisprudence de la Cour, au grand dam de certains juges, à l’image du
juge Pettiti, qui regrettait, dans l’affaire Beljoudi, cette tendance
de la Cour.
Si
la Cour avait confirmé explicitement que la notion de quasi-national, est une
catégorie juridique à part entière, et qu’elle a pour conséquence de
placer l’étranger intégré sur le même pied que le national, elle aurait
contribué à accorder aux étrangers intégrés un statut sécurisant. Et
surtout, elle aurait contribué à garantir à l’étranger un droit à ne pas
être expulsé.
La
jurisprudence de la Cour était donc novatrice, d’autant qu’elle s’insérait
dans le débat sur l’intégration des étrangers dans les Etats membres.
En
leur reconnaissant dans un premier temps une protection minimale en cas
d’expulsion individuelle (affaires Moustaquim, Beljoudi et Nasri), en
acceptant le concept de “quasi-national”, la Cour leur assurait ainsi une sécurité
juridique, les protégeant comme le souligne le juge Martens dans l’affaire Beljoudi,
d’une part de la “loterie des autorités nationales (administrations et
juridictions nationales)”, et d’autre part “de l’embarras de la Cour”.
Toutefois,
la Cour n’a jamais explicitement introduit la notion de quasi-national ni
celle d’immigré de seconde génération dans ses décisions. Elle s’est
toujours gardée de glisser sur ce terrain polémique.
Aussi,
le juge Martens, dans l’affaire Boughanemi, estimait qu’en raison de
cette loterie, et par conséquent de l’incertitude juridique pesant sur les étrangers,
la Cour devait adopter la thèse prônée par les juges De Meyer, Morenilla,
Baka (Boughanemi), Palm (Boulchekia), Foighel (El Boujaïdi
du 26 septembre 1997), à savoir que les étrangers intégrés, c’est-à-dire
ceux qui ont vécu la totalité ou presque de leur vie dans un Etat, ne doivent
pas plus en être expulsés que les nationaux. Ainsi s’appliquerait
l’article 3 du protocole 4 de la Convention qui interdit l’expulsion des
nationaux.
Le
recours à cette notion avait le mérite d’éviter de préciser des critères,
comme le souhaitait une partie de la doctrine et, de faire taire même
partiellement une certaine idée qui veut que l’étranger intégré ne l’est
plus s’il commet des infractions.
Il aurait donc raté son intégration, de la même manière que lorsqu’il
maintient des liens avec son pays d’origine.
B
• L‘impact de la jurisprudence Baghli et autres
Nous
tirons deux éléments de réflexion de l’arrêt Baghli et de ceux qui
l’ont précédé : la réaction des juridictions internes, et notamment
du juge administratif français, et son impact sur le débat sur l’intégration.
D’une
part, qui ne se souvient pas de l’impact des arrêts Moustaquim et autres sur
la jurisprudence administrative française ?
Longtemps,
le Conseil d’Etat a refusé d’admettre que des étrangers puissent invoquer
à leur bénéfice l’article 8, alors qu’ils avaient commis des infractions
lourdes. Le poids des infractions l’emportait sur l’effectivité de la vie
privée et familiale des individus. A partir de 1991, il entame un revirement en
admettant de contrôler des mesures d’éloignement au regard de l’article 8.
A
partir de 1992, on constate que la juridiction administrative se rapproche du
standard européen de protection des étrangers délinquants.
Le Conseil d’Etat a même, depuis 1994, définitivement étendu la protection
de l’article 8. Ainsi, on notera qu’à plusieurs reprises, il a considéré
qu’il y avait violation de l’article 8 dans les cas où l’étranger est né
en France ou y a vécu depuis sa plus tendre enfance, sans attache avec son pays
d’origine, dont la famille réside en France, lorsqu’il est marié ou vit en
concubinage avec une française et a des enfants français, à la condition
qu’il subvienne aux besoins de sa famille.
Par
contre, il se refuse à accorder une telle protection à un étranger n’ayant
pas de communauté de vie, ou ne subvenant pas au besoin de sa famille,
lorsqu’il est célibataire, même s’il a toujours vécu en France, a perdu
toute attache avec son pays d’origine et que sa famille vit en France,
lorsqu’il est arrivé tardivement en France même avec une vie familiale,
s’il est marié, avec un conjoint français et parent d’enfants français.
Cependant,
le Conseil tient compte également du passé pénal de l’individu,
position relayée par une circulaire du ministre de l’Intérieur.
Ainsi, il estimait que le moyen tiré de la violation de l’article 8 était
inopérant dans cette situation. Désavouée par la Cour, à l’occasion de
l’affaire Beljoudi, sa jurisprudence est désormais en symbiose avec
celle de la Cour européenne des droits de l’Homme.
D‘autre
part, le revirement de la Cour relance de nouveau le débat sur l’intégration,
et plus précisément sur les qualités qu’un étranger doit avoir pour être
considéré comme intégré.
En
juridicisant la problématique “étranger”, la Cour avait eu le mérite
d’inciter à une réflexion plus profonde.
D’abord,
la problématique “étranger” avait été perçue comme focalisée sur le
regroupement familial. Problématique qui avait pour fondement l’acceptation
entière, voire définitive, de l’étranger dans la société nationale.
En prenant partie dans cette problématique, la Cour a ainsi démontré que le
droit au respect de la vie privée et familiale ne concerne pas seulement le
regroupement familial, mais est avant tout un droit de l‘individu face à l’Etat.
L’Etat a une compétence personnelle en la matière, mais l’individu a également
des droits et a droit à une protection. Mener une vie privée et familiale,
c’est également demeurer en famille, conserver cette famille, se maintenir
sur le territoire, ou construire cette famille.
Ensuite,
cette juridictionnalisation a entraîné la problématique sur le terrain des
droits fondamentaux, comme rempart à la souveraineté des Etats. Elle a
contribué ainsi, comme le souligne M. Labayle,
à ne plus considérer l’étranger comme un objet utilitaire. L’accès au
territoire de “ cet objet ” est soumis au gré des volontés des
Etats pour des raisons diverses (les raisons les plus souvent invoquées sont
des motifs démographiques et/ou économiques), quitte à s’en débarrasser
lorsque l’Etat, ou l’opinion publique, le trouvent envahissant.
Enfin,
elle a contribué dans les ordres internes de certains Etats à poser le débat
sur l’intégration. L’étranger intégré a droit à une vie familiale
normale. Ainsi, la reconnaissance d’un principe général du droit à mener
une vie privée et familiale n’est pas propre à la Cour.
En
France, dès 1988, ce principe général a été consacré par le juge
administratif
: “il résulte des principes généraux droit, et notamment du préambule de
la Constitution de 1946 auquel se réfère la Constitution de 1958, que les étrangers
résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener
une vie familiale normale”.
Il
en est de même pour le Conseil constitutionnel qui a reconnu le droit à une
vie familiale normale pour l’étranger “dont la résidence en France est
stable et régulière”.
Mais
cette reconnaissance aurait pu être étendu aux étrangers intégrés délinquants
et assouplir la législation en la matière : comme le national, non seulement
l’étranger a droit à une vie normale dès lors qu’il est établi régulièrement
en France et de manière stable, mais aussi, comme le national délinquant, l’étranger
intégré délinquant a le droit de bénéficier des mesures tendant à sa réinsertion
après avoir commis une infraction dès lors qu’il s’est établi de manière
durable dur le territoire français.
Deux
éléments sont à retenir dans le revirement de la Cour.
D’une
part, elle adopte une relecture des éléments constitutifs de la vie privée et
ou familiale de l’étranger délinquant. Son approche demeure toujours
subjective. Il est temps que la Cour se décide à être plus claire sur ce débat.
D’autre
part, elle détermine une nouvelle approche de la sauvegarde de l’ordre
public. Dans ce cas, elle avait le choix entre trois approches : soit au cas par
cas en recherchant si l’ingérence se justifie au regard de la clause
d’ordre public (art. 8, par. 2), soit en adoptant la notion de quasi-national,
soit en retenant les infractions les plus graves (comme le suggérait le juge
Martens), à savoir des crimes contre l’Etat, activités terroristes
politiques ou religieuses ou le fait d’occuper une position éminente dans une
organisation de trafic de drogue. Ici, il est certain que la Cour a refusé de
retenir le concept de quasi-national. Par contre, elle semble distinguer entre
l’atteinte aux biens et l’atteinte aux personnes, distinction discutable.
Débats
Jean-Paul
COSTA
Merci
Mme Boissard pour cet exposé convaincu, engagé. Je voudrais juste faire
remarquer qu’il y a quelques erreurs de dates. Ce n’est pas à partir de
1990 que la jurisprudence de la Cour s’est infléchie, mais à partir de
1996-1997 (après l’affaire Nasri). L’arrêt Berrehab c. Pays-Bas
n’est pas de 1985, mais de 1988.
Antoine
BUCHET
C’est
vrai qu’il y a un infléchissement de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’Homme. En revanche, il y a du côté des juridictions
internes, et de l’administration française, une prise en compte. C’est
d’ailleurs assez paradoxal de voir que le mouvement se fait dans des sens différents
puisqu’en France, à la suite du rapport sur la notion de double peine, la
Ministre de la Justice, a émis une circulaire dans laquelle on a accordé
beaucoup de place à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme
non pas pour mettre en évidence cette grande tolérance de la Cour à l’égard
des Etats, mais pour expliquer, au contraire, que la Cour exerce un vrai contrôle
de proportionnalité et qu’il y a donc une supervision européenne, et donc
pour appeler l’attention des magistrats de l’ordre judiciaire sur la nécessité
de prendre en compte cette jurisprudence dans leurs décisions et pour les
motiver au regard des exigences de l’article 8.
C’est
effectivement paradoxal de voir une évolution de la jurisprudence européenne
vers plus de tolérance à l’égard des Etats, et, en revanche, des Etats, en
tout cas du côté de la France, plus enclins à intégrer dans les pratiques
judiciaires et administratives la jurisprudence européenne.
Jean-Paul
COSTA
J’ajoute
que beaucoup de ces affaires concernent la France, mais curieusement aucune de
ces affaires depuis de nombreuses années ne sont des affaires de grande
chambre. Je pense qu’un jour ou l’autre, la grande chambre sera amenée à
préciser la jurisprudence car il ne s’agit pas de renversement de
jurisprudence, mais il y a vraiment eu une inflexion à partir des années
1996-1997, et peut-être qu’à l’avenir la nouvelle Cour aura l’occasion
de préciser sa jurisprudence.
Paul
TAVERNIER
Je
voudrais remercier les deux derniers intervenants. A partir d’arrêts qui n’étaient
pas au premier abord très passionnants puisqu’ils n’apportaient pas d’éléments
nouveaux, Me Clément a su nous intéresser en montrant les extensions de ce
contentieux sur le sida.
Le
débat soulevé par Béatrice Boissard me paraît vraiment fondamental. Grâce
à l’opinion dissidente commune des juges Costa et Tulkens, je suis plus
optimiste que vous, car je pense que la question n’est pas réglée définitivement.
Ce qui me paraît intéressant, c’est de noter que les deux juges qui ont présenté
une opinion dissidente sont les juges français et belge, deux pays où le problème
se pose de la manière la plus aiguë. Dans l’avenir, les choses peuvent évoluer.
J’ai
été également très intéressé par votre référence à la jurisprudence du
Comité des droits de l’Homme, même si bien sûr elle ne va pas dans le même
sens que nous, mais effectivement il ne faut pas oublier cette “ jurisprudence ”,
parce que ce n’est pas une juridiction, mais c’est quand même un organe qui
statue et a un rôle intéressant à jouer et que, finalement, les droits de
l’Homme ne sont pas limités à un continent, ils sont universels, avec une
inspiration commune, la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Je
suis heureux que ce débat ait pu avoir lieu, même s’il a été un peu
raccourci par des impératifs de temps.
|