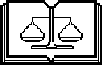|
L'actuelle
Cour européenne des droits de l'Homme :
un
Phénix renaissant de ses cendres ?
par
Michele
De Salvia
Greffier
de la Cour européenne des droits de l'Homme
Selon
la légende, le Phénix, oiseau fabuleux unique de son espèce, une fois brûlé,
avait le privilège de renaître de ses cendres afin d'entamer une nouvelle vie.
Dans
notre cas, le Phénix en question peut être la composante juridictionnelle du
système de protection de la
Convention européenne des droits de l'Homme. En effet, avec la disparition de
la Commission et de l' "ancienne" Cour, la
"juridiction de Strasbourg"
s'est transformée en un nouvel organe : la Cour "unique" des
droits de l'Homme, cette Cour résultant
de la fusion des deux institutions précitées.
L'adjectif
"unique", utilisé même dans les travaux préparatoires pour désigner
la nouvelle Cour, montre bien qu'en fait il y avait auparavant, à la base du
système de protection, deux véritables organes juridictionnels, l'un
quasi-judiciaire (la Commission) et l'autre pleinement judiciaire (la Cour)
chargé de dire le droit en tranchant au fond les questions qui lui étaient
soumises par la Commission, les Etats, voire même par des individus dans le
cadre du Protocole n° 9. Dans ce système, la Commission était considérée,
dans l'imaginaire collectif, comme une sorte de" cour" ou tribunal
de première instance, aux attributs singuliers et novateurs.
Comme
cela ressort clairement des travaux préparatoires du Protocole n° 11, la
nouvelle Cour a largement puisé dans le patrimoine génétique de la
"juridiction" bicéphale qu'elle a été censée remplacer.
D'où
la légitime interrogation : s'agit-il d'un
juridiction "nouvelle" dans ses éléments constitutifs
principaux ou ne s'agit-il pas, en fait, que d'une opération de chirurgie plus
esthétique et réparatrice, destinée à gommer des rides et des imperfections,
qu'une véritable opération de reconstruction d'un édifice aux fissures
apparentes ?
C'est
ce que nous essaierons d'analyser brièvement en partant d'une double approche :
les assonances entre les deux systèmes,
d'une part, et les dissonances entre ces systèmes, de l'autre. Assonances et
dissonances qui nous permettront de mesurer, peut-être, le degré d'adéquation
des solutions retenues par le Protocole n° 11 aux objectifs poursuivis par les
inspirateurs de la réforme et les auteurs de ce texte.
Les
assonances
Elles
peuvent être mesurées quant à la forme et quant au fond.
Pour
ce qui est de la forme, il est à peine nécessaire de relever que peu a changé
quant à la présentation d'une requête et aux méthodes de traitement de
celle-ci. La formule de requête n'a pas été, pour l'essentiel, modifiée et
les communications que le greffe de la Cour envoie aux requérants, potentiels
ou réels, sont quasiment identiques à celles que le Secrétariat de la
Commission leur faisait parvenir auparavant. Surtout, l'esprit dans lesquels se
déroulent les contacts entre le greffe et les requérants s'inspire toujours du
même souci d'assurer un équilibre entre le respect du droit de recours
individuel et l'exigence de limiter un contentieux voué à l'échec à plus de
80%. Ce, afin de désengorger ainsi, un rôle qui devient de plus en plus
difficile à maîtriser.
Les
textes qui sont présentés par le greffe aux juges en vue du traitement des
requêtes sont calqués sur ceux de l'ancienne Commission, qu'il s'agisse des
rapports, des notes de procédure et des projets de décisions. Les textes des décisions
sur la recevabilité et des arrêts au fond sont la copie conforme de ceux
rendus par l'ancienne Commission et par l'ancienne Cour.
Les
assonances quant au fond concernent à la fois l'organisation de la Cour, et
donc la procédure d'examen proprement dite, ainsi que le contenu
jurisprudentiel des décisions et des arrêts.
Des
trois formations de jugement prévues par le Protocole n° 11,
deux s'inspirent directement de celles existant au sein de la Commission
-les Comités et les Chambres- la Grande Chambre, elle, s'inspirant plutôt de
la formation créée par l'ancienne Cour au moyen d'une modification au Règlement
intérieur.
Le
système des juges rapporteurs en vigueur à l'ancienne Commission a été
maintenu. Il s'agit là d'un résultat important, car le rapporteur est le
principal moteur de la procédure et forme avec le référendaire, chargé en
fait du dossier, la véritable cheville ouvrière de la procédure. Les pouvoirs
du juge rapporteur sont identiques à ceux dont disposait son homologue au sein
de la Commission, notamment en ce qui concerne la mise en état de l'affaire.
La
procédure d'examen proprement dite suit de très près celle élaborée par la
Commission et passe à travers des stades désormais codifiés : la
communication, l'éventuelle tenue d'une audience, l'établissement des faits,
la tentative de règlement amiable.
Le
principe des mesures d'urgence, une
des améliorations les plus audacieuses apportées par la Commission au déroulement
de la procédure, a également été retenu par le Règlement de la Cour. De même,
le principe de la tierce intervention qui dans l'ancien système n'avait été
prévu que par le Règlement de
l'ancienne Cour, est désormais inscrit dans la Convention.
En
ce qui concerne le contenu des solutions jurisprudentielles, les assonances sont
assurément plus profondes que les dissonances. Au fur et à mesure qu'avançait
l'élaboration du nouveau système qui aurait dû être mis en place par le
Protocole n° 11, beaucoup s'étaient inquiétés des divergences qui risquaient
de se produire quant au l'application de la Convention par un organe nouveau qui
aurait pu se sentir délié de toute "allégeance" à la jurisprudence
de la Commission et de l'ancienne Cour. Le maintien de ce que l'on a appelé
l'acquis jurisprudentiel a été l'une des questions les plus souvent évoquées,
la crainte étant celle d'un nivellement vers le bas à cause surtout de l'élargissement
du système de protection aux pays d'Europe centrale et orientale.
Or,
rien de tel ne s'est produit. Tout au contraire. L'acquis a été maintenu à un
niveau aussi élevé de protection. La jurisprudence s'est inspirée des mêmes
principes directeurs élaborés par l'ancienne Cour et par la Commission, à tel
point que la jurisprudence a repris formules et citations comme si la continuité
l'emportait nettement sur le changement.
Dissonances
Elles
sont nombreuses et profondes et concernent surtout le fond et, marginalement, la
forme.
Le
changement de forme le plus visible est constitué par le prononcé des arrêts,
ou mieux par la procédure par laquelle ils sont rendus publics. Dans le précédent
système, l'arrêt était toujours rendu public par le prononcé comportant la
lecture intégrale de la partie "en droit". Il s'agissait là d'une
procédure qui a été critiquée (aussi par certains juges de l'ancienne Cour)
surtout par sa lourdeur, car il n'était pas inhabituel d'assister à des
prononcés durant plus d'une demi-heure pour un seul arrêt.
Désormais,
les arrêts son rendus publics par une procédure plus simple et expéditive. En
règle générale, les arrêts de la Grande Chambre sont rendus publics par la
lecture d'un résumé des faits essentiels et la lecture du seul dispositif, le
texte étant aussitôt mis à la dispositions du public. Toujours en règle générale,
les arrêts des Chambres, de même évidemment que les décisions sur la
recevabilité, sont rendus publics par la notification par écrit aux parties.
Il est à noter que tous ces textes sont insérés sur le site Internet de la
Cour, en principe le jour même du prononcé ou de la notification.
Malgré
les apparences, les dissonances au fond revêtent de l'importance et sont de
nature à éclairer les points de divergence, certains desquels fondamentaux,
entre l'ancien et le nouveau système.
Ce
qu'il faut souligner d'abord est la complète judiciarisation du système, avec
la mise à l'écart du Comité des ministres en tant qu'organe de décision au
fond. S'il s'agit là d'une évolution souhaitable et nécessaire après près
de cinquante années de fonctionnement du système de protection, il faut aussi
relever qu'en fait, cet organe n'avait été (à quelques rares exceptions près)
qu'une sorte de chambre d'enregistrement pour des décisions prises au fond par
la Commission (dans des affaires ne présentant pas d'intérêt pour le développement
de la jurisprudence) et auxquelles il fallait donner le sceau du caractère
obligatoire.
Le
précédent système s'appuyait donc sur une répartition des rôles : la
Commission était à la fois une sorte d'avocat général pour les affaires (pas
très nombreuses) qui soulevaient un réel problème d'interprétation de la
Convention et qui étaient dès lors déférées à la Cour, et une juridiction
de première instance pour la grande masse des affaires.
La
judiciarisation complète du système a été à l'origine d'un autre profond
changement : le droit de recours, désormais obligatoire pour les parties
contractantes, s'exerce devant la Cour elle-même qui remplit la fonction de
filtre, jadis confiée à la Commission. Ce qui n'est pas sans poser des problèmes,
une Cour étant soumise à des règles beaucoup plus strictes qu'un organe du
genre de celui de la Commission.
Pour
ce qui est de la composition de la Cour, deux changements majeurs sont
intervenus. Si les juges sont toujours élus par l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe laquelle, il est vrai, a ajouté à la procédure une phase
nouvelle de façon à augmenter son poids en matière de choix des juges, la durée
de leur mandat a été écourtée (sans que l'on sache véritablement pourquoi)
par rapport à celle des juges de l'ancienne Cour (six ans au lieu de neuf) et a
été introduite une limite d'âge (70 ans) qui n'existe pas pour d'autres
tribunaux internationaux, voire même pour les seules cours nationales
comparables, à savoir les cours constitutionnelles.
En
ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la Cour, s'il est vrai
que le système des Chambres a déjà existé au sein de la "première"
Cour, il est tout aussi vrai que leur rôle est foncièrement différent. Dans
le nouveau système il s'agit de Chambres constituées pour une durée déterminée
(et non pas constituées pour chaque affaire). Un système comparable
a aussi existé au sein de la Commission,
mais à la différence de ce qui se passait devant cet organe, les
Chambres fonctionnent désormais comme autant de "cours" au sein de la
Cour, "cours" en principes autonomes et dotées de la plénitude de
juridiction. En effet, toujours à la différence de ce qui se passait à la
Commission qui, en formation plénière, avait
le pouvoir d'évoquer une affaire, les Chambres de la nouvelle Cour ne peuvent
pas être dessaisies contre leur gré. Il y a là un élément de rigidité qui
réduit d'autant le rôle régulateur qui devrait échoir à la Grande Chambre.
Même
la possibilité d'un réexamen d'un
arrêt rendu par la Chambre par la Grande Chambre est soumise à de telles
contraintes qu'elle est quasiment exceptionnelle.
Pour
s'en convaincre, il n'est que de relever le nombre très limité des
dessaisissements volontaires et des demandes de réexamen acceptés par le collège
de la Grande Chambre.
On
pourrait aussi mentionner l'abandon du principe de confidentialité, qui était
la règle devant la Commission, et surtout les procédures de règlement amiable
pour lesquelles la Cour, à la différence de la Commission, n'intervient pas
directement.
Comme
on le voit, les dissonances ont trait à l'organisation du travail judiciaire de
la Cour. Elles ne concernent pas le contenu jurisprudentiel pour lequel il y a
continuité, ce qui n'exclut pas, bien évidemment, les nécessaires évolutions.
Conclusions
Les
aspects qui viennent d'être mentionnés sont de nature, me semble-t-il, à
fournir quelques éléments de réponse à d'importantes interrogations.
Le
bel oiseau de Strasbourg est toujours le même que celui admiré et respecté
pendant des décennies ? Et encore. L'opération "chirurgicale" du
Protocole n° 11 a-t-elle été concluante ? Va-t-on vers une
"reforme" de la réforme comme certains l'affirment ?
De
toute évidence, si en apparence par son plumage et par son ramage le Phénix
est toujours le même, le processus de sa renaissance a engendré des
modifications profondes dans son code génétique.
Pour
ne citer qu'un aspect, on peut relever que le fractionnement de l'activité
judiciaire entre des Chambres de plus en plus cloisonnées et l'impossibilité
pour la Grande Chambre de se saisir d'une
affaire par voie d'évocation, pose un sérieux problème de coordination
concernant les pratiques et l'évolution de la jurisprudence.
De
plus, la distribution des affaires parmi les Chambres si, en principe, elle suit
un critère objectif (l'affaire étant confiée à la Chambre où siège le juge
national), elle doit également composer avec les réalités d'une distribution
équitable du travail parmi les Chambres elles-mêmes. Il s'ensuit que certaines
affaires importantes concernant une pays donné sont traitées par d'autres
Chambres que la chambre "naturelle", ce qui peut se répercuter sur la
solution retenue.
Il
faut aussi souligner que l'élément de stabilité jurisprudentielle, stabilité
qui est au niveau des principes indéniable, est représenté en l'occurrence,
mais jusqu'à un certain point seulement, par les juristes du greffe, greffe
dont le rôle s'inscrit à la fois dans la continuité (par rapport greffe de
l'ancienne Cour et par rapport au Secrétariat de la Commission) et dans le
changement car il est appelé à assister une Cour permanente composée de juges
désormais "professionnels".
Quant
à l'opération "chirurgicale" du Protocole n° 11, elle ne semble pas
avoir atteint jusqu'ici les objectifs principaux qu'elle s'était assignés, le
but principal de la "réforme" étant -il ne faut pas l'oublier-
d'aboutir à une restructuration du système en vue de réduire la durée des
procédures au niveau supranational.
Faut-il
alors s'inscrire résolument dans une perspective de "réforme" en
profondeur du système ? Avant d'entamer une réflexion sur les moyens à mettre
en œuvre et les meilleures solutions à retenir, une question préalable doit
trouver une réponse satisfaisante de la part de ceux-là mêmes qui ont mis sur
pied le système de protection et ont voulu la "reforme", c'est-à-dire
les Etats.
A
notre avis, la question préalable à résoudre n'est pas tant d'ordre juridique
; elle est avant tout -et surtout- d'ordre politique.
A
cet égard, le contexte joue un rôle déterminant. Ce contexte n'est plus celui
des années 80 où le projet de réforme avait été conçu et avait pris forme.
La cadre actuel est celui d'une Europe qui fait fi des frontières géographiques,
d'une Europe euro-asiatique de quelque 800 millions de citoyens.
D'où
la question essentielle qui conditionne toute la réflexion future :
peut-on assurer une justice supranationale pour un tel ensemble en
gardant un droit de recours individuel généralisé et illimité, ou ne doit-on
pas songer à une sorte de "barrage" en amont de la procédure européenne,
en partant de l'idée qu'au delà d'un certain seuil de contentieux il ne serait
plus possible d'assurer une justice rapide et efficace ?
Ensuite,
comment organiser un tel "barrage" ? Faut-il faire revivre la
Commission, sous d'autres formes, par exemple en songeant à une sorte de
Parquet européen qui pourrait refuser d'accepter des requêtes qui n'auraient
pas de chances suffisantes de succès et qui ne soulèveraient pas de problèmes
sérieux en matière de droits fondamentaux ? Que prévoir alors, par exemple,
pour le contentieux relatif à la durée excessive des procédures internes ?
Et
encore, quelle est la charge budgétaire que les Etats seraient prêts à assumer
pour une protection judiciaire efficace au niveau européen ?
Et
enfin, comment concilier une protection européenne à la dimension politique du
Conseil de l'Europe (43, voire jusqu'à 47 Etats membres) avec l'élargissement
de l'Union européenne et la nécessité, que d'aucuns considèrent impérieuse,
d'assurer à l'intérieur de cette même Union
une protection réelle des droits fondamentaux (ce qui pose le problème
de la coexistence non seulement de textes tels que la Convention européenne et
la Charte des droits fondamentaux ou le futur texte qui la remplacera, mais également
la coexistence de deux Cours "suprêmes", et l'une et l'autre ayant
vocation "constitutionnelle") ? Quel avenir réserver, dans ce cadre,
à l'adhésion de l'Union à la Convention européenne ?
En
fin de compte, la question essentielle est simple, bien que la réponse ne le
soit pas forcément : que souhaitent en fait les Etats européens en matière de
protection des droits fondamentaux ?
De
la réponse à cette question dépend l'avenir d'un système, celui de
Strasbourg, à la fois ambitieux et
pragmatique, mais qui ne pourra pas, sans de profonds changements, continuer à
jouer le rôle fédérateur des "libres démocraties d'Europe" qui a
été le sien pendant un demi-siècle.
|
|
Débats
Paul
TAVERNIER
Je
voudrais remercier Michele De Salvia pour son exposé remarquable. Une fois de plus, il
a fait la preuve qu'il est non seulement un fin juriste et un praticien confirmé,
mais aussi qu'il est un universitaire expérimenté.
Une
question me préoccupe beaucoup : celle de la langue. Je sais que M. De
Salvia est aussi un grand défenseur de la langue française au Conseil
de l’Europe, à la Commission, et maintenant à la Cour. Il nous a expliqué
la difficulté liée au nombre des langues (37) pour que les juges arrivent à
comprendre les dossiers. C’est une gageure...
Je
signalerai tout d'abord un problème technique : on trouve sur internet des arrêts
avec des indications en langue étrangère qui ne sont pas lisibles suivant les
systèmes informatiques utilisés. Mais surtout on constate que les arrêts
rendus, notamment pour l'Italie, le sont de plus en plus en anglais, ce qui sans
doute s'explique par la situation de la langue française en Italie… Mais plus
grave encore, pour la Suisse, on se rendra compte que la plupart des arrêts
sont rendus en anglais. En Italie, le français n’est pas une langue
officielle, mais par contre elle l’est en Suisse puisqu’il y a quatre
langues officielles, dont le français. Vous avez peut-être une réponse sur
cette question.
Michele
DE SALVIA
Le
français est une langue nationale italienne, car elle est la langue officielle
dans le Val d’Aoste, comme l’allemand l’est au Tyrol du Sud.
Il
faudrait peut-être dire un mot sur le régime linguistique des arrêts et des décisions.
Pour
des raisons budgétaires ou des raisons d’économie, le système actuel a coupé,
dirais-je, la poire en deux ! L’ancienne Cour rendait ses arrêts dans les
deux langues et tous les arrêts de l’ancienne Cour existe dans les deux
langues officielles. L’ancienne Cour rendait quelques dizaines d’arrêts par
an. La nouvelle Cour en rend un peu plus de 700 par an, sans compter les décisions
sur la recevabilité. Le régime est différent suivant qu’il s’agit de procédures
se déroulant devant la Grande Chambre ou de procédure se déroulant devant les
Chambres, la Grande Chambre n’intervenant dans le pourcentage que pour 2 ou 3
% des affaires. L’essentiel du travail judiciaire de la Cour est fait au sein
des Chambres. Les arrêts de la Grande Chambre existent dans les deux langues
officielles. De plus le texte français et le texte anglais font également foi.
Ceci est important. Pour ce qui est des arrêts rendus au sein des Chambres, la
solution qui s’est imposée - ceci n’a pas été un choix - est qu’il
n’existe qu’une version, la version dans laquelle a été élaboré, préparé
et rédigé le texte de la décision ou de l’arrêt. Ce qui fait que 95 ou 96
% de la jurisprudence existe dans une seule langue, ce qui signifie que
quelqu’un qui veut comprendre exactement le déroulement de la jurisprudence
de Strasbourg doit maîtriser les deux langues officielles. Ceci ne gêne pas
tellement en fait les francophones, mais plutôt les anglophones. En effet,
quand je suis entré au Conseil de l’Europe, je me souviens qu’il y avait
les affaires linguistiques belges, et on disait toujours qu'un Belge bilingue
est toujours un Flamand... aujourd’hui, on peut dire que le bilingue est
toujours un francophone, car les Anglais se dispensent d’apprendre ou
d’avoir une connaissance précise de la langue française. Voilà la réalité.
A
cela, il faut dire aussi que la jurisprudence publiée, qui ne concerne qu’un
choix de décisions et d’arrêts, l’est dans les deux langues officielles,
mais avec cette particularité qu’une seule version des deux langues, la
version officielle, fait foi. Pourquoi un texte est présenté dans une langue
plutôt que dans une autre ? En fait, c’est la langue du référendaire qui détermine
la langue de procédure officielle. Les juges francophones ou anglophones
peuvent travailler indifféremment avec des référendaires anglophones ou
francophones. Mais c’est le référendaire qui détermine l’utilisation de
la langue. On commence à avoir des requêtes roumaines présentées en anglais,
et donc des arrêts rendus en anglais. A part la Roumanie, la Pologne est
quasiment anglophone, la Bulgarie (qui fait partie de la Francophonie) l’est
également, et les rares agents du gouvernement qui utilisent le français sont
amenés à se servir de l’anglais, car c’est le mouvement naturel des
choses.
Voilà
pour ce qui concerne la situation du français à la Cour, d’où l’idée que
j’avais essayé de mettre en œuvre avec le bâtonnier Pettiti,
qui était l’ancien juge français de l’ancienne Cour, de créer à
Strasbourg un Institut supérieur francophone de formateurs pour former des
avocats, des magistrats et d’autres personnalités qui, se rendant dans leur
pays, allaient relayer l’enseignement reçu à Strasbourg. Malheureusement,
cet Institut n’a pas reçu les appuis nécessaires en dépit des efforts du bâtonnier
Pettiti.
Paul
TAVERNIER
Puisque
Mme Dubrocard est là, elle
pourrait faire part de ces préoccupations auprès des autorités compétentes
du ministère des Affaires étrangères... Il serait souhaitable de faire des
efforts pour le développement de la langue, même si la situation est très
difficile. En tout cas, elle est très préoccupante.
Vous
dites que les francophones sont bilingues, c’est vrai, et que la situation est
surtout préjudiciable pour les anglophones, c’est vrai aussi, puisque ce sont
eux-mêmes qui avaient demandé qu’on maintienne un certain bilinguisme au
moment de la réforme du Protocole n° 11, et de la discussion du Règlement.
Mais, même pour les francophones, il y a des problèmes. Ce n’est pas
simplement une question de connaissance linguistique, mais c’est aussi une
question de connaissance du système juridique. Quand on lit des arrêts
concernant la Grande Bretagne et qui se fondent sur une analyse de la common
law, si on n’est pas un spécialiste de ce système, on a beaucoup de mal
à saisir toutes les subtilités du raisonnement. S’il était traduit en français,
par des traducteurs professionnels, je pense que l’accès à la jurisprudence
serait nettement amélioré. Le fond de la question, est bien sûr budgétaire...
Edouard
DUBOUT (Etudiante, Université
d’Evry-Val d’Essonne)
La
mise en œuvre du Protocole n° 12 va encore augmenter le nombre des requêtes
devant la Cour dont le rôle est déjà surchargé. Quelles sont les raisons qui
expliquent l'adoption d'un tel texte ?
Michele
DE SALVIA
Ce
sont des raisons politiques. Je suis un partisan farouche du Protocole n° 12 au
niveau des principes, mais il faut dire que cela va également élargir le champ
d’application de la Convention, et donc multiplier par deux ou trois ou quatre
le nombre des requêtes. Nous n’y pouvons rien. Nous subissons ce que les
Etats décident, mais je crois qu’il y a une prise de conscience. Si les Etats
décident d’ouvrir à la signature, comme ils l’ont fait à Rome, le
Protocole n° 12 qui a déjà été signé par 25 Etats (pas par la France), les
Etats doivent donner à la Cour les moyens de leurs ambitions. Il y a déjà eu
des résultats positifs, puisque le budget de la Cour va augmenter de 15 % sur
deux ans, ce qui compte tenu de la croissance 0 est extraordinaire ; cela veut
dire que les autres activités du Conseil de l’Europe vont baisser d’autant.
Je crois donc qu’il y a une prise de conscience.
La
Cour aura à la fin de l’année 43 juges. Elle aura beaucoup à faire pour intégrer
les nouveaux juges qui seront élus. Il faut qu’elle soit débarrassée des
contraintes budgétaires parce qu’elle n’est pas responsable des contraintes
qu’elle a héritées.
Sylvie
BARRAULT (assistante, Faculté Jean Monnet à Sceaux)
Je
voudrais à la fois savoir si compte tenu de l’élargissement du nombre des
membres, et du nouveau système du jugement par les Chambres, on ne risque pas
d’aller à terme vers une dislocation de la jurisprudence ?
Michele
DE SALVIA
C’est
ce que j’ai dit. En fait, c’est un danger, d’autant qu’on songe déjà
à une cinquième Chambre. Il y a quatre Chambres pour l’instant. Je devrais
expliquer qu’il y a en fait quatre sections. Le Règlement intérieur a
introduit un nouveau concept qui ne figure pas dans le Protocole, c’est la
section et la répartition administrative des juges. Les juges sont intégrés
dans l’une des quatre sections : il y a donc trois sections de 10 juges et une
section de 11 juges, et à l’intérieur des sections, on constitue les
Chambres de 7. Néanmoins, on songe à une cinquième section, donc à une
cinquième Chambre, et le problème sera très aigu. D’ailleurs, et c’est la
réflexion que l’on se fait actuellement, est-ce qu’il ne faut pas avoir à
l’intérieur de la Cour un service ou des personnes qui font ce travail de
coordination, donc un ou plusieurs jurisconsultes pour essayer de contenir en
quelque sorte le danger prévisible ?
Catherine
TEITGEN-COLLY (professeur, Faculté Jean Monnet à Sceaux)
On
a souligné le défaut de signature par la France du Protocole n° 12, mais Mme Dubrocard
pourra peut-être nous préciser les raisons de ce refus que l'on souhaite
temporaire. L'une des principales raisons qui toutefois a été donnée
tiendrait à la crainte d’un débordement de la Cour par un contentieux des étrangers.
Déjà important, celui-ci verrait son développement favorisé par
l'interdiction de discriminations plus étendues que celles qui, fondées sur
des droits garantis par la Convention, sont déjà sanctionnées. Cette raison
si elle est exacte est difficilement acceptable. Et puisque vous avez évoqué
la question d'un Parquet européen, ne croyez-vous pas que c'est dans cette
direction qu'il faut chercher une réponse au problème au problème de
l'engorgement de la Cour, plutôt que dans le refus de signer le Protocole n°
12 ?
Michele
DE SALVIA
Sur
le Protocole n° 12 : bien évidemment il y aura une explosion du contentieux
parce que pour l’instant l’interdiction de la discrimination ne vaut que
pour les droits et les libertés garantis par la Convention. Avec le Protocole n°
12, tout droit qui pourra être garanti au niveau interne, même s’il n’est
pas garanti par la Convention, pourra faire l’objet d’une requête. La Cour
peut encore plus élargir le contentieux en donnant à la notion de droits
garantis par le droit interne un contenu plus large. On ne peut pas prévoir
quelle sera l’ampleur du phénomène. Les raisons pour lesquelles les Etats
ratifient ou ne ratifient pas le Protocole sont des raisons qui appartiennent
aux Etats et qui sont donc largement politiques. Je ne peux pas vous en dire
plus. Michèle Dubrocard en parlera
peut-être.
En
ce qui concerne l’idée du parquet européen, je l’ai moi-même lancée. Sur
le « barrage », la « digue », c’est une idée qui fait
son chemin. Certains pensent même que la Cour pourrait agir comme agit la Cour
suprême des Etats-Unis qui dit , je peux traiter tant d’affaires par an, je sélectionne
les affaires que je veux et je rejette toutes les autres. Ce n’est pas, à mon
humble avis, conforme à la tradition juridique continentale européenne ; ou
bien il faut avoir un barrage par un organe. Il ne faut pas refaire le passé,
mais il faudra bien qu’un jour l’on songe à cette « digue ». Il
y a aussi d’autres idées : celle du Président Badinter
d’instituer des tribunaux régionaux qui seraient reliés à une Cour européenne,
mais elle se heurte à plusieurs objections. D’abord, il y aura une régionalisation
de la protection quant au contenu possible des droits de l’Homme, mais la
raison majeure est bien évidemment
d’ordre budgétaire. C’est déjà cher pour les Etats d’avoir une Cour
européenne à Strasbourg, mais la multiplier par deux ou trois ou quatre, ce
serait intenable. Il faut un barrage. L’œuvre de filtrage était accompli par
la Commission auparavant, et en tant qu’ancien Secrétaire général de la
cette Commission, je peux dire que c’était l’un des organes les plus
efficaces en matière de protection si l’on compare les moyens dont elle a
disposés et les résultats. Bien évidemment, la Commission agissait dans un
cadre qui n’était pas strictement judiciaire ; elle était juridictionnelle,
quasi judiciaire. Elle était plus libre et avait des règles plus souples. La
Cour actuelle ne le peut pas puisque telle a été la volonté des Etats. Encore
une fois, cette volonté a pris forme au milieu des années 80, alors que l’Europe
était une Europe de 20 Etats, relativement homogène. En 1989, l’Europe avait
fait le plein, à l’exception de Saint Marin, puisque tous les Etats démocratiques
faisaient partie du système de la Convention, le nombre des Etats a plus que
doublé et en population encore plus, puisque la Russie à elle seule compte 160
millions de citoyens, l’Ukraine 50, la Pologne 40. La Pologne est l’un des
tous premiers Etats quant au nombre de requêtes présentés devant la Cour. Le
problème est un problème de dimension. La Cour a la possibilité de rendre une
justice efficace ; si on lui en donne les moyens, elle est capable de le faire.
Paul
TAVERNIER
Si
vous le permettez, dans la ligne de ce que vous venez de dire, vous avez mis
l’accent, à la demande de Catherine Teitgen-Colly,
sur un point essentiel qui conditionne l’avenir de cette nouvelle Cour. Je
rappellerai pour l’histoire que lors d’un précédent colloque du CREDHO
votre prédécesseur, M. Petzold,
avait suggéré de réfléchir justement sur le modèle de la Cour suprême américaine,
et qu’il avait rencontré un tollé, je m’en souviens, à l’évocation de
cette idée... Notamment Me Delaporte
avait protesté vigoureusement. Mais ce n’est que pour l’histoire, car les
choses peuvent évidemment évoluer….
Michèle
DUBROCARD
Je
voudrais très rapidement préciser les raisons pour lesquelles le gouvernement
français n’a toujours pas signé le Protocole n° 12.
Ce
sont celles que, très précisément, M. De
Salvia a indiquées : à savoir que la préoccupation majeure
actuellement du gouvernement est celui de l’engorgement de la Cour, et sa
capacité à fonctionner de façon efficace. L’engorgement, on le craignait,
est déjà là. A titre d’exemple, je peux citer l’affaire Papon.
La requête que l’on nous a signalée depuis plus d’un an ne nous a toujours
pas été communiquée. Je parle de la première requête, je ne parle pas de la
seconde qui va faire l’objet d’un examen, comme tout le monde le sait, dans
le courant de la semaine prochaine.
On voit bien, à travers ce seul exemple, quelle est la situation actuelle de la
Cour. Dans ce contexte, si l'on a une approche réaliste, il ne me paraît pas
opportun pour le gouvernement français de "charger un peu plus la
barque", si vous me permettez l’expression, et d’autoriser la Cour à
accroître sa compétence. Il ne s’agit pas d’un problème de principe pour
la France, la preuve en est que nous avons ratifié le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques qui, comme chacun le sait, dans son
article 26 prohibe de manière très large toute forme de discrimination. Une
fois encore, ce n’est pas un problème de principe juridique qui pose des
difficultés à la France, c’est la situation actuelle de la Cour.
Laurence
BURGORGUE-LARSEN (professeur, Université de Rouen, directeur du
CREDHO-Rouen)
Vous
avez fait part de l'existence de liens informels entre les membres de la Cour de
Luxembourg et ceux de Strasbourg. Je voudrais savoir comment, dans la pratique,
ces rencontres ont lieu, qui en a l’initiative, si elles sont toujours
informelles et si d’aventure un jour on pense à les institutionnaliser ? Dans
le cadre de ces liens avec la Cour de Luxembourg, est-ce que la Cour de
Strasbourg ne réfléchit pas, dans le cadre de sa future restructuration, à ce
qu’a mis au point le Traité de Nice au niveau de la nouvelle architecture
juridictionnelle, à savoir la création de Chambres spécialisées ? Est-ce que
la Cour de Strasbourg pense à cela, c’est-à-dire à la possibilité de créer
des Chambres spécialisées, par domaines notamment ?
Michele
DE SALVIA
Ces
rencontres ont lieu une fois par an, à l’initiative parfois de la Cour de
Strasbourg, parfois à celle de Luxembourg. Elles sont toujours informelles,
c’est-à-dire qu’elles ne sont pas ouvertes au public. Il y a un échange de
vues sur la façon de dire le droit et sur les problèmes qui se posent. La
dernière rencontre a porté sur le rang de la Charte.
En
ce qui concerne les Chambres spécialisées : lors de l’élaboration du règlement
intérieur de la Cour, entre juillet et octobre 1998, cette question a été
mise à l’ordre du jour, mais elle n’a pas trouvé un écho favorable parce
que les Chambres spécialisées ne sont pas conformes à la façon dont la
juridiction de Strasbourg a toujours traité les problèmes. En effet, un problème
peut relever à la fois de plusieurs articles. La Cour de Strasbourg s’inspire
beaucoup, on dit de la common law,
mois je préfère dire du droit romain, parce que le droit romain est un droit
prétorien. Les faits étaient présentés au préteur et le préteur donnait le
droit, c’est un peu ce qui se passe, c’est le grief et le grief peut être
analysé au regard de l’article 6, mais aussi de l’article 8, en matière de
garde d’enfants par exemple. S’il s’agit de la procédure, un danger
existe déjà dans le fait d’avoir des Chambres spécialisées, et on sait très
bien que la première Chambre, qui est présidée par la Vice-présidente Palm,
est forcément spécialisée dans les affaires turques. Pourquoi ? Parce que le
juge turque siège dans cette Chambre, et vu le nombre des affaires turques, et
leur complexité, elles sont évidemment attribuées en grande partie à la
première Chambre. La Chambre n° 2, où siège le juge italien, se spécialise,
malgré elle, dans les problèmes de durée de la procédure, et ce n’est pas
un sujet très intéressant... Les Chambres les plus conviviales, les plus intéressantes,
sont les Chambres 3 et 4, surtout la Chambre 3, parce que se trouvent traitées
les affaires de la France et du Royaume-Uni. Le hasard a voulu rassembler ces
deux pays qui fournissent un contentieux varié, important, bien présenté et
on a du plaisir à suivre ses travaux.
Je
ne pense pas donc que ce soit une voie que la Cour de Strasbourg souhaite
explorer.
Arlette
HEYMANN-DOAT (professeur, Faculté Jean Monnet à Sceaux)
Je
voudrais attirer l’attention de Mme Dubrocard
sur l’aspect symbolique des choses, au-delà de l’aspect technique. Certes,
il peut y avoir un problème technique, quantitatif pour la Cour, mais à des
problèmes techniques, on trouve de solutions techniques. En vérité, il y a
une autre question qui est l’aspect symbolique. Je voudrais rappeler que la
France, patrie des droits de l’Homme, a ratifié la Convention européenne 24
ans après sa signature et qu’il est difficile d’expliquer et de justifier
cette position aux étudiants dans les cours sur les libertés publiques ou les
droits de l’Homme. Vis-à-vis du Protocole n° 12, qui porte sur le droit qui
aujourd’hui est le droit en pointe, c’est-à-dire le droit à la
non-discrimination, considérer que de raisons techniques sont suffisantes pour
que la France ne signe pas ce Protocole, je trouve que c’est un peu court.
Michèle
DUBROCARD
Mais
précisément, il faut encore vous donner de la matière à débattre avec vos
étudiants durant quelques années, et vous pourrez leur expliquer pourquoi nous
avons attendu autant de temps pour signer ! C’est finalement intéressant et
cela peut susciter des débats dans les années à venir...
Michele
DE SALVIA
En
fait, je crois que la francophonie a souffert du fait que la France n’a ratifié
qu’en mai 1974 et surtout que le droit de recours individuel n’ait été
reconnu qu’à partir du 2 octobre 1981. Ceci est vrai. Mais, personnellement,
je pense que la France a fait preuve de sérieux, car elle pouvait le faire
avant. J’utilise souvent l’exemple français pour montrer comment le système
de la Convention et un système contraignant, qui vise en fait le dernier carré
où s’exerce la souveraineté des Etats. La France pouvait faire partie du
Traité de Rome, être soumise à une juridiction supranationale dès 1958, mais
a hésité beaucoup car je crois que l’analyse politique qui avait été faite
à l’époque était juste, ce que d’autres Etats n’ont pas fait. Ils
l’ont ratifié à la légère, et ils se sont ensuite trouvés face à des
problèmes qu’ils n’avaient pas soupçonnés… Il faut toujours trouver un
élément positif, même dans des circonstances négatives.
Michèle
GUILLAUME-HOFNUNG (professeur, Faculté Jean Monnet à Sceaux)
C’est
une question quelque peu malicieuse : est-ce que finalement la Cour européenne
des droits de l’Homme n’est pas aux prises avec sa propre jurisprudence ? En
raison des difficultés que vous avez expliquées, elle risque de ne plus juger
dans un délai raisonnable, et elle-même a déjà critiqué
certains pays pour s’être mis dans cette situation... Dans la
recherche de solutions, elle va être confrontée à des exigences qui
l’obligeront à trouver un organe de filtrage qui n’encoure pas les
reproches qu’ont encouru un certain nombre d’autorités administratives indépendantes
qui manquent d’impartialité parce qu’un organe peut se trouver à la fois
associé à un stade de la procédure puis à un autre.
Michele
DE SALVIA
En
fait, je n’ai pas parlé du principal responsable de tout cela : le Comité
des ministres du Conseil de l’Europe. Il est responsable, mais il faut dire
aussi que la pratique et l’histoire ont fait qu’il est devenu le protecteur
des droits de l’Homme et le responsable de la situation de la Cour. Le
responsable, car il ne faut pas oublier que la Cour ne peut pas modifier une
situation interne. La Cour ne peut qu’accorder une réparation. C’est le
Comité des ministres qui, à partir des éléments contenus dans la partie
« en droit », élabore une stratégie et amène l’Etat, par des
procédés ou des pressions diplomatiques, à modifier une situation interne, à
changer une loi, etc. Or la situation de la Cour, l’engorgement qui résulte
à 25 % des problèmes de durée de procédure, ils ne sont pas nouveaux, ils
sont apparus vers le milieu des années 80. Depuis une dizaine d’années, le
Comité des ministres sait que certains Etats n’ont pas fait ce qu’ils
devaient faire. A défaut d’avoir un système rapide, un système judiciaire
qui puisse répondre de façon rapide, donc efficace, il faudrait que les Etats
adoptent des solutions de façon à ramener le problème de Strasbourg dans les
Etats. Pour l’instant, les Etats se déchargent sur Strasbourg, ne veulent pas
résoudre le problème à l’intérieur. Donc les requérants n’ont qu’une
seule voie, s’adresser à Strasbourg. Ceci est vrai pour le problème de durée
de la procédure, mais pas seulement. Or il y a eu un arrêt, l’arrêt Kudla
qui concerne la Pologne, un des pays qui connaît bien ces problèmes de durée
excessive, dans lequel la Cour a dit clairement : il est fait obligation aux
Etats de prévoir des voies de recours internes efficaces pour que le problème
de la durée excessive des procédures reste dans le cadre interne et
n’arrivent que marginalement à Strasbourg. C’est donc la faute à la fois
aux Etats et au Comité des ministres, qui n’imposent pas aux Etats un
comportement bien précis afin d’éviter la répétition, parce qu’en fait
le problème de la durée de la procédure est tellement simple : la
jurisprudence est consacrée. Il suffit d’appliquer la jurisprudence aux
faits, et ce qui est vrai pour le problème de la durée des procédures l’est
aussi pour certaines violations bien plus graves, par exemple, le défaut
d’enquêtes efficaces en Turquie concernant des disparitions de personnes. Là
aussi il y a un problème qui ne se limite pas au cas d’espèce. Il y a bien
des comportements qu’on peut voir décrits dans la jurisprudence de
Strasbourg. La Cour dit aux Etats indirectement : il faut faire ceci ou cela. Il
faut que les enquêtes soient efficaces. Le procureur, le parquet ne peut pas se
limiter à prendre note et à ensuite classer l’affaire sans suite.
Lorsqu’il y a mort d’homme, il doit enquêter. Et les Etats ne peuvent pas
rester passifs face à ce déferlement d’affaires. Hier on m’a dit qu’il y
a 10 000 affaires italiennes. Il y
a des solutions en cours. Il y a une loi qui prévoit un recours interne, mais
encore faut-il que le Parlement soit disposé à la voter.
Paul
TAVERNIER
Apparemment
il y a eu aussi des déclarations gouvernementales italiennes qui disent que des
réformes adoptées risquent de nécessiter plusieurs années avant de produire
des effets....
Sur
l’affaire Kudla, je dirai que la
Cour fait de grands efforts pour essayer de mettre les Etats devant leurs
responsabilités, mais cela peut aussi, comme l’a indiqué un des juges
dissidents, aboutir à un afflux supplémentaire de recours pour absence de
recours efficace sur le plan interne ... Mais ce serait une autre discussion…
Michele
DE SALVIA
Il
faut dire aussi que le problème de l’efficacité de la justice est tributaire
de la solution d’un autre problème. Ce sont en fait les acteurs de la procédure
interne qui parfois s’opposent. Dans certains pays, le nombre des avocats est
tellement important qu’ils rechignent à voir le nombre des voies de recours réduit
dans le pays. Pourquoi trois degrés de juridiction dans tous les cas ? C’est
un problème qui se pose. Pourquoi ne pas réduire le nombre des voies de
recours ?
Frédéric
ROLIN (professeur à l’Université d’Evry-Val d’Essonne)
J’aimerais
juste faire part d’une incompréhension, mais je suis certain qu’elle sera
levée au terme de votre réponse. Si on prend l’exemple du droit français,
il n’y aurait pas d’obstacle à ce que l’ensemble du contentieux sur la
durée excessive de procédure soit dérivé directement dans le droit de la
responsabilité nationale. Puisque la durée excessive de procédure est une
faute dans l’exécution du service public de la justice, il suffirait d’une
décision de la Cour qui dise que tant qu’on n’a pas exercé cette voie de
recours, on n’a pas épuisé les voies de recours internes, pour que les
choses soient réglées. Je précise que les deux voies sont actuellement
ouvertes et que si les avocats et les requérants ne suivent pas la voie
nationale, c’est pour une raison assez simple et assez matérielle : les
perspectives d’indemnités pour la partie, et les perspectives de frais irrépressibles
pour l’avocat, sont sensiblement améliorées s’ils se présentent devant la
Cour européenne plutôt que devant la juridiction nationale, et notamment
devant une juridiction administrative, mais pas uniquement. A mon avis, une
simple décision de la Cour européenne des droits de l’Homme, en ce qui
concerne le contentieux français, liquiderait une partie importante de
l’engorgement, et on pourrait ensuite, au niveau de la Cour, se consacrer à
ce qui est le point important, c’est-à-dire la répétition des durées
excessives et les dysfonctionnements du système qui fait que l’on constate
cette situation, et ce serait une discussion entre la Cour et l’Etat, et non
pas entre chaque requérant, l’Etat et la Cour, pour des litiges qui parfois
ont peu de portée et peu d’intérêt pour le développement des droits
fondamentaux.
Michele
DE SALVIA
Depuis
de nombreuses années, la situation française est en voie d’amélioration
parce que j’ai pris connaissance d’une décision qui constate en effet que
la voie de recours (art. L-781 du Code de l’organisation judiciaire) est
efficace parce qu’il y a une jurisprudence qui la sous-tend à présent.
Michèle
DUBROCARD
Tout
récemment la Cour a rendu une décision dans l’affaire Van
der Kar où elle reconnaît l’efficacité du recours fondé sur
l’article L-781 du Code de l’organisation judiciaire mais, malheureusement
pour les autorités françaises, uniquement à l’égard des procédures terminées
et donc le problème reste entier pour les procédures en cours. Cela ne
concerne pour l’instant que les procédures judiciaires et non pas les procédures
administratives. Or nous savons tous qu’un certain nombre de requêtes
relatives à des durées de procédure excessives concernent les procédures
administratives. Donc cela ne règle que partiellement le problème. Je me
permets de vous poser une dernière question : nous utilisons tous, très régulièrement
votre ouvrage le compendium de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Est-ce que vous comptez le mettre à jour régulièrement, au fur et à mesure
des décisions de jurisprudence ?
Michele
DE SALVIA
J’ai
donné la mise à jour à mon éditeur avant-hier, à jour jusqu’en janvier
2000, et il y aura une version russe, une version anglaise également.
Pour
la première partie de la question, je dois dire que la Cour ne contrôle pas le
résultat, mais seulement la procédure. Et cela en vertu d’une vieille
jurisprudence qui plonge ses racines dans les travaux préparatoires de la
Convention en 49-50 où l’on dit clairement que le juge de Strasbourg ne
pourra jamais contrôler ce que le juge a fait en partant de certains éléments
de fait qui lui sont présentés dans le cadre de l’article 6. Il y a une
jurisprudence constante que je peux lire, tirée de l’arrêt Schenk
(Suisse) : aux termes de l’article 19, la Cour a pour tâche d’assurer le
respect des engagements. Il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de
fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la
mesure où elle pourrait avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés
par la Convention. Voilà le point de départ.
|