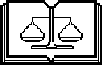|
La
Convention européenne des droits de l’Homme et le droit privé
L’affaire
Mazurek
ou
les conséquences incertaines d'un arrêt mal fondé
(1er
février 2000)
par
Dominique
Fenouillet-Laszlo
Professeur
à l’Université de Paris XI
Une
femme décède, laissant deux fils. Le premier, né hors mariage, a été légitimé
par le mariage de sa mère un an après sa naissance ; le second, né au cours
de ce même mariage, n'a été inscrit à l'état civil que sous le nom de jeune
fille de sa mère sans indication du mari de cette dernière ; conformément au
droit de la filiation, la légitimation par mariage confère donc au premier les
mêmes droits qu'à un enfant légitime alors que le second, n'étant pas
couvert par la présomption de paternité légitime en raison des mentions portées
sur son acte de naissance, n'est doté que d'une filiation maternelle adultérine.
Il
en résulte donc un concours successoral entre un enfant légitimé et un enfant
adultérin, situation envisagée par l'article 760 du Code civil qui dispose :
"Les enfants naturels dont le père ou la mère étaient, au temps de leur
conception, engagés dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes,
sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ;
mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu
droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes
(al. 1er). La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroîtra
aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle
se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires (al. 2)."
Le
Tribunal de grande instance et la Cour d'appel
ayant procédé à une dévolution inégalitaire de la succession par
application de ce texte, l'enfant adultérin saisit la Cour de cassation. Mais
son pourvoi fut rejeté par un arrêt de la première Chambre civile en date du
25 juin 1996.
Celle-ci considéra en premier lieu que la Convention de New York ne bénéficiait
qu'aux "enfants"
et ne permettait donc pas d'écarter une règle relative au statut successoral
d'un adulte. Elle estima en second lieu qu'il n'était pas possible de faire
application de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme
puisque ce texte ne visait qu'à
garantir l'égalité dans les droits et libertés reconnus par ladite Convention
et que la vocation successorale était étrangère au respect de la vie privée
et familiale protégé par l'article 8. Ayant épuisé les voies de recours
interne, l'enfant adultérin saisit la Cour européenne des droits de l'Homme.
Tels
sont les faits qui ont conduit la Cour à condamner la France, le 1er
février 2000, à réparer le dommage subi par M. Mazurek. L'analyse de l'arrêt
sera conduite en premier lieu dans l'ordre européen. Elle conduira à une appréciation
mitigée : la Cour européenne doit être approuvée pour la solution qu'elle
retient, mais critiquée pour la voie empruntée (I.). Il conviendra en second
lieu de s'interroger sur l'avenir du principe d'égalité en droit familial
interne (II).
I
• La condamnation de l'inégalité successorale française de l'enfant adultérin
par la Cour européenne
Pour
condamner la France, la Cour s'est fondée sur l'article 1er du
Protocole additionnel n° 1 combiné avec l'article 14 de la CEDH. Elle a considéré
qu'il n'existait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre la
vocation successorale amoindrie infligée à l'enfant adultérin et le but
poursuivi par la France, à savoir la protection du mariage, des devoirs en résultant,
et des intérêts moraux.
Alors
que la doctrine doutait de la question de savoir si "hériter est vraiment
un droit de l'Homme",
la Cour européenne répond donc par l'affirmative.
Si
le fondement retenu est regrettable (A), la solution finale doit en revanche être
approuvée (B).
A.
Le choix discutable de la norme de référence
L'article
14 de la CEDH a ici été associé à l'article 1er du Protocole
additionnel n°1, en vertu duquel "toute personne physique ou morale a
droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que
pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les
principes généraux du droit international". C'est donc l'égalité dans
le droit au respect des biens qui fonde la solution, solution retenue, il faut
le noter, à l'unanimité. Et ce fondement a été justement critiqué, comme
discutable techniquement (1°) et comme réducteur notionnellement. Il eut été
incontestablement préférable de fonder le raisonnement sur le droit au respect
de la vie privée et familiale (2°).
1°)
Une application discutable du droit au respect des biens
La
Cour a été critiquée pour avoir procédé à une "interprétation
extensive et à vrai dire déformante" de l'article 1er du
Protocole additionnel n°1.
La
Cour reproche à la loi successorale française de priver l'enfant de
"sa" propriété en ne lui reconnaissant qu'une vocation successorale
limitée. Elle reprend la même analyse que dans l'affaire Inze
du 28 octobre 1987. Mais cette analyse est contestable : la propriété découle
de la vocation successorale et ne lui préexiste pas ; limiter la vocation
revient donc à restreindre ab ovo la
propriété et non pas à priver une personne de "sa" propriété.
La
Cour croit pouvoir écarter la critique en se fondant sur le fait que la
succession est d'ores et déjà ouverte. Mais cet élément ne change rien à
l'affaire dans la mesure où, dès la mort de la défunte, les deux demi-frères
sont devenus propriétaires indivis des biens mais dans la limite de leur
vocation successorale, et donc à concurrence de 3/4 du patrimoine pour l'enfant
légitimé et de 1/4 pour l'enfant adultérin.
Reste
alors à invoquer l'existence, en droit européen, de notions autonomes et à
remarquer que l'article 1er vise sans doute le droit de propriété
mais qu'il protège, plus largement, le droit au respect des "biens".
Ce qui explique qu'un créancier ait pu bénéficier de cette protection européenne,
alors pourtant que la doctrine ne s'accorde pas à analyser son droit comme un
droit de propriété.
Cette autonomie des notions suffit-elle à sauver la mise en œuvre de ce texte
à la vocation successorale au plan technique ? La question renvoie au
concept de vocation successorale, dont on se souvient que la doctrine classique
des conflits de lois dans le temps l'analyse, avant ouverture de la succession,
comme une simple expectative. A supposer cette analyse retenue, on mesure sans
peine à quel point l'application de la notion de "bien" à une telle
prérogative conduit à étendre le champ d'application de la protection européenne
des droits de l'Homme.
En
outre, la doctrine
a critiqué la Cour pour avoir statué sur un fondement patrimonial, jugeant
qu'elle disqualifiait alors les droits de l'Homme. La critique, si elle doit être
tempérée (il ne faudrait pas oublier que le premier droit de l'Homme français
a tout de même été le droit de propriété inaliénable et sacré…), est
exacte : il eut été préférable, en l'espèce, de reprocher au droit français
la violation du droit au respect de la vie privée et familiale. Le regret
technique se double alors d'un regret au plan symbolique.
2°)
La dérobade regrettable à l'égard du droit au respect de la vie privée et
familiale
Le
plaignant se fondait sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de
l'Homme, ce texte célèbre qui protège le droit au respect de la vie privée
et familiale. La Cour de cassation avait écarté ce texte en jugeant que la
vocation successorale est étrangère au droit au respect de la vie privée, ce
que certains auteurs avaient jugé "raisonnable".
La Cour européenne n'a procédé à aucune exclusion : elle s'est contentée de
juger qu'elle "n'estim(ait) pas nécessaire" d'envisager cette
qualification puisque l'article 1er du Protocole additionnel
suffisait à condamner la loi française, et ce à 5 voix seulement contre 2. Ce
silence décidé à la seule majorité, qui manifeste un certain embarras, a été
regretté par la doctrine. Il eut été
symboliquement préférable et pratiquement plus conforme à la sécurité
juridique de condamner la France sur le fondement de l'article 8. Mais était-ce
possible ?
Que
recouvrent les notions de vie privée et de vie familiale ?
La
première concerne la personne, dans son corps et son esprit, isolément ou dans
ses relations extra-patrimoniales avec les autres ; elle confère à son
titulaire une double prérogative, le secret (cela ne vous regarde pas) et
l'autonomie (je fais ce que je veux).
La
seconde concerne la personne dans ses relations familiales. Strictement
entendue, elle ne confère à chacun que l'autonomie du choix du mode de vie
familial et, corollaire de l'autonomie, le droit de garder secret ce choix. Plus
largement entendue, elle intègre la liberté de faire établir un lien familial
(de couple ou de filiation) et de jouir des effets attachés à ce lien.
Quid,
alors, de la vocation successorale liée à la filiation et, plus généralement,
au lien familial ?
Relève-t-elle
de la vie privée ? Il nous semble, contrairement à la Cour de cassation, qu'il
n'était pas impossible de considérer que la question successorale relevait de
la vie privée. Il faut écarter l'argument tenant seulement à la nature
patrimoniale de la vocation successorale. Il est exact que la protection du
patrimoine ne relève pas en elle-même de la notion de vie privée.
Cela ne veut pas dire que la protection de la vie privée de la personne soit
cantonnée à son activité extra-patrimoniale et écartée dans le cadre
patrimonial : chacun connaît la célèbre jurisprudence invalidant les clauses
de contrat de travail limitant la liberté de la vie privée ou familiale du
salarié. Une personne peut donc fort bien profiter de la protection attachée
à la vie privée et familiale alors qu'elle se borne à agir dans le cadre
patrimonial. Or n'est-ce pas contrevenir à l'intimité de la vie privée que de
prendre en compte les circonstances de la naissance d'une personne pour déterminer
sa vocation successorale ? La nature du lien de filiation, élément de l'état
civil soumis à publicité, ne suffit pas à écarter la solution alors qu'il en
est de même du sexe et que chacun connaît la solution retenue en matière de
transsexualisme, solution qui distingue heureusement la publicité des éléments
de l'état civil et la liberté de vivre personnellement sans être inquiété.
La
vocation successorale relève-t-elle de la vie familiale ? Si l'on définit le
droit à la vie familiale strictement, la réponse est négative : les sanctions
successorales infligées à l'enfant adultérin ne portent pas atteinte à la
liberté qu'il a de choisir son mode de vie familial, dans la mesure où un
enfant ne choisit jamais les circonstances dans lesquelles il naît. La
conclusion est différente si l'on retient une définition large de la notion de
vie familiale. La vocation successorale est un effet du lien de famille, ici du
lien de filiation ; elle relève donc bien de la vie familiale largement
entendue comme intégrant établissement du lien et effets du lien. Partant, en
conférant à l'enfant adultérin, dans la succession de son auteur adultère,
des droits différents de ceux octroyés à l'enfant légitime dans la
succession de son auteur légitime, la loi attente à l'égalité dans la
jouissance du droit au respect à la vie familiale.
On
peut d'autant plus regretter la timidité de la Cour : 1) qu'elle contraste avec
l'audace dont elle a parfois fait preuve dans la définition de la liberté de
la vie privée ou de la vie familiale ; 2) qu'elle contraste avec le
raisonnement adopté dans la célèbre affaire Marckx,
le 13 juin 1979 ou encore dans l'affaire Vermeire
du 29 novembre 1991
; 3) qu'elle contraste avec l'affirmation, par l'arrêt Mazurek lui-même, de l'importance contemporaine du principe d'égalité
en Europe et de la nécessité d'une interprétation dynamique de la Convention
européenne, cet "instrument vivant à interpréter à la lumière des
conditions actuelles" ; 4) qu'elle aurait pu suivre l'exemple donné, en la
matière, par la commission Dékeuwer-Défossez,
qui avait justement préféré opter pour affirmer "de manière à la fois
plus abstraite et plus forte, l'identité des droits attachés au lien de
filiation" (§ 22 in fine).
L'esprit
de la CEDH invitait, nous semble-t-il à se fonder sur la notion de statut
familial, patrimonial ou personnel.
Cet arrêt montre, une nouvelle fois, l'urgence qu'il y a à réfléchir,
conceptuellement et non plus pragmatiquement, sur la notion de vie privée et
familiale.
B.
La condamnation inéluctable du droit
interne
La
solution retenue nous semble en revanche tout à fait pertinente dans sa
conclusion, même si elle eut gagné à être mieux motivée. Plutôt que de
condamner sur le terrain du défaut de proportionnalité entre la fin poursuivie
et le moyen retenu (1°), la Cour eut sans doute été mieux inspirée de
condamner pour défaut d'adéquation entre le moyen choisi et la fin poursuivie
(2°).
1°)
Le raisonnement retenu : le défaut de proportionnalité entre la fin et le
moyen
La
Cour recherche d'une part si l'inégalité de traitement dans le droit au
respect des biens dont pâtit l'enfant adultérin poursuit un but légitime et
d'autre part s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre la
fin poursuivie et le moyen retenu. Et la conclusion négative à laquelle elle
parvient est fondée non seulement sur des considérations générales (a), mais
aussi sur les circonstances spécifiques du cas (b), ce qui, évidemment, limite
de façon regrettable la portée de la solution retenue.
a)
La Cour conclut au défaut de proportionnalité entre la fin et les
moyens en se fondant sur deux considérations générales
1)
L'évolution générale de la famille
La
Cour note qu'"il ne peut être exclu que le but invoqué par le
gouvernement (qui affirmait vouloir préserver la famille légitime, les devoirs
issus du mariage) puisse être considéré comme légitime"… (§ 50). La
formule frappe par son peu d'enthousiasme lorsqu'on la compare à l'affirmation
contenue dans l'arrêt Marckx et selon
laquelle "il est en soi légitime voire méritoire de soutenir et
d'encourager la famille traditionnelle". La force éventuelle de la famille
légitime, en termes de natalité et surtout de stabilité, est donc relativisée,
à tort à notre sens,
par la Cour.
Elle
insiste sur le développement en fait des autres modes de vie familiaux et note
l'évolution tant juridique que sociologique de la famille :
"l'institution de la famille n'est pas figée" (§ 52).
2)
L'innocence de l'enfant
Surtout,
la Cour retient que "en tout état de cause", l'enfant adultérin est
innocent et "ne saurait se voir reprocher des faits qui ne lui sont pas
imputables" (§ 54). Cet argument, classique, est important car il donne à
l'appréciation portée par la Cour un soutien incontestable. Il est en effet
impossible de nier la non-culpabilité de l'enfant dans la commission d'un adultère
par ses auteurs. Un tel argument limite d'ailleurs la portée de l'arrêt : il
interdit notamment d'en déduire que sont condamnables les différences de
traitement patrimonial existant entre les couples d'adultes ayant choisi
librement tel ou tel mode de vie.
3)
L'existence d'un standard européen
contemporain en matière d'égalité des enfants
La
Cour note qu'il existe, quant au statut de l'enfant naturel et aux effets du
principe d'égalité, un standard européen, standard qui la guide ensuite dans
la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité qu'elle opère. Elle insiste
particulièrement sur l'importance actuelle du principe d'égalité au sein des
Etats membres du Conseil de l'Europe
et relève "une nette tendance à la disparition des discriminations à l'égard
des enfants adultérins" (§ 52). Rappelant enfin la nécessité d'une
interprétation évolutive de la Convention européenne, elle écarte l'argument
tiré de certaines décisions antérieures de la Cour, "les circonstances
de temps n'étant pas les mêmes".
b)
Malheureusement, la Cour n'a pas su se dégager totalement des
circonstances particulières du cas
On
notera en premier lieu qu'elle insiste sur la
légitimité de raccroc du demi-frère privilégié par le droit français.
La référence à "l'enfant naturel" n'est pas, à cet égard, un
hasard. On pouvait effectivement soutenir qu'un enfant légitimé par le mariage
de ses parents n'est pas "issu" de ce mariage puisqu'il n'a pas été
"conçu en mariage" et qu'il ne bénéficie donc en quelque sorte que
d'une légitimité de raccroc.
L'argument n'avait pas été invoqué devant la Cour de cassation ; il avait
d'ailleurs peu de chances de la convaincre vu l'interprétation extensive
qu'elle donne à l'article 760 du Code civil,
notamment en l'appliquant au profit de l'enfant adopté. Il avait en revanche été
soulevé devant la Cour européenne. Et l'on regrettera que cette dernière ait
implicitement retenu un tel élément de fait, dans le mesure où cet argument
n'est pas pertinent (v. infra) et où
il risque de conduire à restreindre la portée de l'arrêt au seul cas de cet
enfant "tout juste légitime".
On
regrettera en second lieu que la Cour note l'existence d'une
séparation de fait entre la mère et son mari lors de la naissance de
l'enfant adultérin. Et aussi qu'elle relève que le
divorce a suivi de peu la naissance. Il s'agissait ainsi comme l'a relevé
la doctrine d'un "adultérin sur mort-mariage". Ce faisant, elle
semble considérer que le lien juridique, l'institution, importe moins que la réalité
vécue, le fait : on pourrait ainsi être plus ou moins adultérin.
L'argument nous paraît peu pertinent, au moins au plan institutionnel. En
outre, il diminue la portée de l'arrêt, qu'il convenait de fonder sur un
principe et non sur des circonstances de fait.
De
ces divers éléments, la Cour conclut qu'"aucun motif en l'espèce ne peut
expliquer la différence de traitement". Cette conclusion est exacte. Mais
nous l'aurions souhaité fondée sur le défaut d'adéquation du moyen et de la
fin plutôt que sur le défaut de proportionnalité.
2°)
Le raisonnement préférable : le défaut d'adéquation entre la fin et le moyen
Il
suffisait de nier l'adéquation du but poursuivi et du moyen retenu. Il nous
semble en effet que deux buts différents se cachent sous cette expression générale
de protection de la famille légitime. Il peut s'agir d'une protection
institutionnelle ou d'une protection individuelle. Or, ni l'un ni l'autre de ces
deux buts ne peuvent être atteints par l'inégalité critiquée.
a)
La protection de l'institution. A
supposer établi que la société souhaite par là promouvoir la famille légitime,
jugée préférable dans l'intérêt général et individuel (en termes de
natalité, de stabilité…), la Cour aurait du dire 3 choses :
La
prévention est illusoire : à les supposer informés, les amants ne réfléchissent
pas au sort de leurs éventuels enfants avant de décider d'être fidèles ou
d'entretenir des rapports charnels adultérins. La vocation successorale de
l'enfant adultérin n'incite donc ni au mariage des amants, ni au respect de la
fidélité en mariage.
La
réparation de l'outrage causé au système juridique par la violation de
l'institution matrimoniale est inexistante, la sanction consistant à réparer
le tort fait à l'institution du mariage par la restriction des effets d'une
autre institution, la filiation, institution qui ne devrait tendre qu'à assurer
l'intérêt de l'enfant, est même symboliquement très mal venue pour le système
juridique.
b)
La protection des individus. La
protection des membres de la famille légitime n'est pas davantage de nature à
justifier la solution.
1°)
Y a-t-il réparation du tort causé aux victimes de l'adultère ? C'est peu
probable. Le dommage matériel
n'est pas réellement réparé (puisque c'est alors l'intégralité de la
vocation successorale de l'enfant qui devrait disparaître).
Quant au dommage moral, il est irréparable s'il est effectif et à tort réparé
s'il est, comme c'est bien souvent le cas, inexistant en fait (notamment lorsque
les enfants, légitime(s) et adultérin(s), sont élevés ensemble…). Le
principe d'une réparation forfaitaire est alors fictif et arbitraire. Parce que
l'existence et l'importance du dommage dépendent dans la réalité des
circonstances de fait, extrêmement diverses, la sanction abstraite et
inconditionnelle consacrée par le droit positif n'est pas satisfaisante.
2°)
Y a-t-il, enfin, sanction de la faute commise lors de l'adultère ? La réponse
est évidemment négative puisque ce sont les héritiers du défunt adultère
qui subissent cette sanction (et encore seulement l'enfant adultérin) et non
les auteurs de la violation du devoir de fidélité.
La
question de la légitimité du statut successoral inférieur de l'enfant adultérin
conduisait ainsi en réalité à se demander dans quelle mesure il était légitime
de faire produire, dans l'ordre vertical de la filiation, des conséquences à
la nature de la relation nouée, dans l'ordre horizontal, entre les auteurs de
l'enfant. Et la Cour européenne aurait sans doute été mieux inspirée à
fonder explicitement sa solution sur l'autonomie institutionnelle de la
filiation : parce qu'elle poursuit une finalité propre et distincte de celle du
mariage, finalité que nous avons cru pouvoir définir comme étant une
insertion harmonieuse de l'enfant dans une famille apte à le conduire le mieux
possible à l'âge adulte, la filiation n'a pas à dépendre, a priori, ni dans
son existence, ni dans ses effets, de l'union existant entre les auteurs de
l'enfant mais seulement du lien existant entre l'enfant et son auteur et de la
qualité de ce lien.
II
• L'avenir possible du principe d'égalité en droit familial interne
La
condamnation européenne conduit naturellement à s'interroger sur l'avenir de
l'égalité des filiations en matière successorale (A) mais aussi, plus généralement,
sur la portée de l'égalité en matière familiale (B).
A
• Le statut successoral de l'enfant adultérin
Une
réforme législative s'impose (1°) mais son contenu est incertain (2°).
1°)
La nécessité avérée d'une réforme législative
L'autorité
des décisions de la Cour européenne rend nécessaire une réforme législative.
a)
L'autorité de la décision de la Cour européenne des droits de l'Homme
Elle
passe par la distinction de la condamnation d'espèce et de l'interprétation la
fondant.
1)
L'autorité de la décision de condamnation
Le
dispositif de la décision de la Cour est la condamnation de la France à réparer
le dommage causé à l'enfant adultérin. Cette condamnation a autorité de la
chose jugée, et valeur de précédent, ce qui incitera sans doute d'autres
victimes éventuelles à porter le litige devant la Cour.
Le
résultat est que :
*
l'enfant protégé a une part supérieure à celle qu'il devrait avoir si l'on
appliquait le principe d'égalité entre les enfants ;
*
l'enfant adultérin touchera la part qu'il devrait avoir et qui lui est enlevée
pour être attribuée à l'enfant protégé, non pas à titre de droits
successoraux mais à titre d'indemnité reçue de l'Etat français, et donc sans
avoir à acquitter de droits fiscaux. A quoi il y aura lieu d'ajouter la réparation
du dommage moral éventuel.
En
bref, comme la doctrine l'a regretté, c'est le contribuable français qui est
le dindon de la farce !
2)
L'autorité des motifs de la condamnation
*
Les textes. La portée, au plan
interne, des textes consacrant le droit au respect des biens ou le droit au
respect de la vie privée et familiale est incontestée : ces textes ont non
seulement effet direct en France mais encore valeur supérieure aux lois
internes (art. 55 const. 1958).
*
Leur interprétation. La force de
l'interprétation donnée par la Cour européenne des droits de l'Homme est plus
limitée. Contrairement à la Cour de justice, la Cour européenne n'a pas le
pouvoir de rendre des arrêts d'interprétation que les Etats seraient tenus de
respecter. Il en résulte, en théorie, que ses décisions n'ont d'effet
obligatoire, juridiquement, qu'entre les parties aux litiges qu'elle a tranchés
spécialement. Pour autant, la doctrine insiste sur l'importance de
"l'autorité de la chose interprétée" (cf. F. Sudre),
autorité qui procède d'une sorte d'incorporation de l'interprétation au
texte-même et que la menace d'une nouvelle condamnation de l'Etat français par
la Cour européenne rend en fait considérable. Cette distinction entre
l'autorité de jure et l'autorité de
facto (cf. A. Rouhette) est
assez semblable, au fond, à celle qui s'attache en droit interne à l'interprétation
des textes par la Cour de cassation.
b)
Quelles sont donc les conséquences immédiates de l'affaire Mazurek ?
1)
Du côté des juridictions
Il
est probable que la Cour de cassation se pliera à la décision, ce qu'elle peut
d'ailleurs faire sans "perdre la face", puisqu'elle peut se fonder sur
l'article 1er du Protocole additionnel n°1, texte qui n'avait pas été
invoqué devant elle en 1996. Les juridictions inférieures peuvent, quant à
elles, écarter directement les dispositions de l'article 760 du Code civil.
Mais si certaines juridictions retiennent déjà cette solution,
il n'est pas sûr qu'elles fassent toutes preuve de la même audace, ne
serait-ce qu'en raison de la difficulté qu'il y a à déterminer la portée
substantielle de la décision européenne.
2)
Du côté des praticiens
Les
choses sont plus difficiles encore pour les officiers ministériels, qui ne sont
pas fonctionnaires représentants de l'Etat mais qui sont officiers publics. Le
nécessaire respect des intérêts de leurs clients les met dans une situation délicate.
Il
faut leur recommander la prudence tant que la Cour de cassation n'a pas statué.
Ils doivent donc informer les parties de l'incertitude existant en droit positif,
de préférence par écrit pour conserver la preuve de l'accomplissement de ce
devoir d'information. Il est plus difficile de déterminer le conseil qu'ils
doivent fournir aux parties. Certains suggèrent au notaire chargé de la
liquidation de la succession de tenter d'amener les parties à transiger
et, à défaut d'un tel accord seulement, de leur conseiller de saisir le
tribunal compétent. Un auteur a toutefois suggéré de conseiller, en toutes
hypothèses, la voie contentieuse, cette voie permettant à l'enfant légitime
de bénéficier d'une part successorale augmentée sans sacrifier l'enfant adultérin,
puisque celui-ci touchera la part que l'égalité commande de lui attribuer, à
titre d'indemnité versée par l'Etat français…
Ce conseil ne nous paraît pas judicieux : l'abus de droit est sanctionné dans
l'ordre européen ; en outre, si ce conseil conduit les parties à engager les
frais d'un procès et si la Cour de cassation renverse sa jurisprudence et
applique d'elle-même une dévolution successorale égalitaire, le remboursement
des frais du procès risquera d'être demandé par les parties au notaire pour
avoir donné un conseil risqué.
Outre
l'incertitude quant à la positivité actuelle des textes sanctionnant l'enfant
adultérin en droit successoral, le caractère symbolique de l'égalité des
filiations
rend nécessaire une réforme législative. Sans compter que l'incertitude
caractérise également la portée de l'égalité successorale protégée par
l'arrêt Mazurek.
2°)
La détermination incertaine de la réforme substantielle
La
substance même de cette réforme pose problème. La difficulté vient de ce que
plusieurs dispositions concourent à doter l'enfant adultérin d'un statut véritablement
dérogatoire. La décision européenne les condamne-t-elle toutes identiquement
ou faut-il procéder à des distinctions ? La doctrine a dénoncé, à
juste titre, l'existence d'un "nid à contentieux" rendant
"urgente l'intervention du législateur".
Deux questions apparaissent : le domaine de la réforme et la portée de
celle-ci.
a)
Le domaine de la réforme
Quelles
dispositions réformer ? Les dispositions spécifiques relatives à l'enfant
adultérin varient quant au bénéficiaire de la discrimination et quant à la
nature du particularisme du statut successoral, qui peut être relatif à la
quotité des droits ou à leur nature. Indépendamment de cette diversité, il
faut garder présente à l'esprit l'innocence de l'enfant adultérin, qui est
une constante : quelle que soit la disposition considérée, en effet, elle
frappe un enfant qui n'est pour rien dans la faute de ses auteurs.
-
La personnalité du protégé
La
condamnation européenne ne vise explicitement que le cas de l'article 760 du
Code civil, qui règle le concours de l'enfant adultérin et des enfants légitimes
du mariage protégé. Que décider relativement à l'article 759 du Code civil,
texte qui règle le concours entre l'enfant adultérin et le conjoint trompé ?
La
doctrine est souvent plus hésitante.
On
notera toutefois que la décision de la Cour européenne était fondée sur le défaut
de proportionnalité entre le moyen et la fin poursuivie, fin qui consistait
dans la protection de la famille légitime et non pas dans celle des enfants légitimes.
Le raisonnement suivi par la Cour à l'égard de l'article 760 semble
rigoureusement transposable ici. Et ce texte nous paraît d'autant plus condamné
par le principe d'égalité que l'inadéquation démontrée plus haut entre le
moyen retenu et la finalité poursuivie existe tout autant dans les deux cas,
que l'enfant adultérin soit en concours avec le conjoint trompé ou les enfants
du mariage protégé.
La
seule limite tient à l'insuffisance manifeste de la vocation successorale du
conjoint survivant. Cette insuffisance, que chacun reconnaît, ne tient pas à
l'existence d'un enfant adultérin ; elle existe en toute hypothèse dès lors
qu'un enfant occupe le premier ordre et concourt sur la succession avec le
conjoint du défunt. Mais elle prend ici une dimension particulière en raison
des circonstances de fait. Dans une famille unie, le fait tempère la sécheresse
de la vocation légale, en ce sens que les enfants ne chasseront pas leur auteur
des biens du défunt et resteront bien souvent en indivision pour ne pas
modifier brutalement les conditions de vie du survivant. Ici en revanche, il ne
faut pas compter sur le sentiment pour tempérer l'insuffisance des droits du
conjoint survivant ; on peut même craindre que l'enfant adultérin réclamera
le respect immédiat et rigoureux de ses droits. L'insuffisance du statut
successoral du conjoint survivant risquera de produire en fait des conséquences
dramatiques en présence d'un d'enfant adultérin.
La
réforme du droit successoral actuellement en discussion au Parlement
associe effectivement les deux questions puisqu'elle améliore sensiblement le
sort du conjoint survivant en même temps qu'elle consacre l'égalité
successorale des enfants.
2)
La nature de la distinction : la quotité des droits ou la nature des droits
La
plupart des dispositions spéciales portent atteinte à l'égalité en valeur
des droits dans la mesure où elles restreignent la quotité des droits
successoraux de l'enfant adultérin. Tel est le cas non seulement de la
disposition ici sanctionnée par la Cour européenne mais encore d'autres
textes, tels l'article 759 du Code civil, qui règle le concours entre l'enfant
adultérin et le conjoint trompé, ou encore les articles 908 et 1097 qui
restreignent la capacité qu'a l'enfant adultérin d'être gratifié à titre
gratuit par son auteur adultère.
La
restriction des droits de l'enfant adultérin est, dans tous ces cas, destinée
à sanctionner l'adultère et préserver la famille légitime. L'inadéquation démontrée
plus haut entre le but poursuivi et la mesure envisagée condamne ces
dispositions. Et leur suppression devrait s'accompagner de l'abrogation de
l'article 915-2, qui prévoit que l'enfant peut abandonner sa vocation
successorale réduite et lui préférer un droit à aliments, texte qui perdrait
toute justification.
La
proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale le 8 février 2001 et
tendant à réformer le droit successoral prévoit effectivement l'abrogation de
l'ensemble de ces textes.
Dans
deux cas, en revanche, c'est la nature des droits attribués et non leur quotité
qui est particulière : les articles permettent une attribution préférentielle
particulière de biens au conjoint ou
aux enfants légitimes (art. 761) ou une attribution anticipée de biens à
l'enfant adultérin par son auteur adultère et en règlement de ses droits
successoraux (art. 762).
Ces
dispositions sont destinées à assurer la protection des individus, en évitant,
pour la première, que le conjoint et les enfants légitimes soient expulsés du
logement familial ou de l'entreprise familiale… par l'enfant adultérin et,
pour la seconde, que famille légitime et enfant adultérin se déchirent au
moment du partage. A partir du moment où l'égalité en valeur est assurée,
ces deux dispositions, qui nous semblent procéder d'un esprit d'apaisement et
de protection réelle des intéressés, ne nous semblent pas condamnées par la
décision européenne.
Elles
disparaîtront pourtant si la proposition de loi déposée adoptée par
l'Assemblée nationale en première lecture le 8 février 2001 est définitivement
adoptée puisque seraient abrogés les articles 759 à 764 du Code civil.
b)
La portée de la réforme
1)
La question matérielle
L'abrogation
pure et simple de diverses dispositions (art. 760, 908, 915-2 C. civ.) devra
donc accompagner une réforme substantielle du statut successoral du conjoint
survivant.
Comme
souvent, la disparition du statut spécial renverra l'éventuelle réparation du
tort subi par les victimes de l'adultère au droit commun, de la responsabilité
civile. Faut-il craindre alors que la disparition du statut spécifique aille de
pair avec un accroissement du contentieux ? Ce risque ne nous paraît pas considérable,
même s'il est possible qu'effectivement la responsabilité civile soit utilisée
à des fins punitives, principalement dans les familles où la découverte
intempestive de l'adultère surviendra au jour du règlement de la succession.
2)
La question temporelle
Plus
délicate est la question de la portée temporelle de la réforme.
Le
droit commun transitoire conduit à considérer que l'égalité doit jouer
pleinement dans les successions non encore ouvertes au jour de l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi (c'est de l'application immédiate) mais qu'elle ne
peut, en revanche, produire effet dans les successions déjà ouvertes (ce
serait de la rétroactivité). En outre, si des actes juridiques ont été
conclus pour régler la dévolution de la succession, leur validité sera appréciée
par application de la loi en vigueur au jour de leur conclusion ; ils
continueront en outre de produire leurs effets après l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi, sauf à considérer que l'égalité est d'ordre public et doit prévaloir
dans le futur (ce qui nous semble être le cas).
Parce
que ces solutions ne sont pas satisfaisantes, à divers égards, il est
indispensable que la réforme législative contienne des dispositions
transitoires permettant de donner à l'égalité la plus grande portée
possible tout en respectant autant que possible la sécurité juridique.
Il est regrettable que la réforme actuellement à l'étude n'ait pratiquement
rien prévu à ce sujet
puisqu'elle se borne à prévoir l'application des nouvelles dispositions à
l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la nouvelle
loi.
B.
Le statut familial français
Cette
décision de la Cour européenne invite à s'interroger plus largement sur
l'avenir du principe d'égalité en droit familial interne, et ce, que l'on
suive la doctrine qui considère que cette décision européenne transforme
l'article 14 de la Convention en un texte "autonome"
ou que l'on explique la solution européenne par une interprétation large du
droit au respect des biens ou encore que l'on préfère invoquer le droit au
respect de la vie privée et familiale. L'affaire Mazurek conduit ainsi au réexamen de toutes les différences de
traitement, dans le statut patrimonial (via l'article 1er du
Protocole additionnel n° 1 : régime matrimonial, régime successoral…) et
dans le statut extra-patrimonial (autorité parentale, nom, établissement du
lien de filiation…) procédant du lien familial, qu'il s'agisse du lien de
filiation ou de couple.
Le
raisonnement de la Cour, qui insiste sur l'innocence de l'enfant, n'est évidemment
pertinent que pour le statut de l'enfant (1°) ; il est sans portée pour le
statut des adultes (2°), ceux-ci ayant bien souvent volontairement choisi le
statut qui les régit. Indépendamment de cette distinction fondamentale, il
faut se garder du mythe de l'égalité à tout prix : la famille est une
institution ; à ce titre, elle ne peut nier les différences de fait existant
entre les familles.
1°)
Le statut des enfants
L'égalité
ne saurait remettre en cause le statut attaché à la minorité : si l'enfant
est placé sous l'autorité de ses père et mère, ce qui restreint sa liberté
en matière de vie privé, de religion, de vie familiale…, c'est pour le protéger
contre son immaturité et contre des décisions qui lui seraient néfastes. Pour
le reste, l'égalité justifierait certaines réformes, dans le statut
patrimonial mais surtout dans le statut personnel.
a)
Le statut patrimonial
La
protection de l'enfant contre les avantages matrimoniaux
que l'un de ses auteurs peut consentir à son nouveau conjoint fait
incontestablement partie des dispositions discriminatoires condamnées par le
principe d'égalité. La Cour de cassation, critiquée par la doctrine, a
interprété l'enfant du premier lit comme étant l'enfant d'un précédent
mariage et a refusé d'en faire profiter l'enfant naturel né avant le mariage
considéré.
Pourtant, l'article 1527 n'était pas destiné à protéger le mariage mais
l'enfant qui n'est pas issu de ce mariage contre les dispositions intempestives
de son auteur. La réforme doit
permettre d'élargir la protection de l'article 1527 alinéa 2 à l'enfant
naturel d'un précédent lit.
b)
Le statut personnel
Le
statut personnel recèle plus de distinctions. Mais elles ne sont pas toutes
contraires à la Convention européenne des droits de l'Homme. Une différence
de traitement entre enfant légitime et enfant naturel n'est condamnable que si
elle ne poursuit pas un but légitime ou si elle n'est pas proportionnée à ce
but.
Rares
sont les dispositions dont la finalité
est de promouvoir l'institution matrimoniale. Il en existe quelques unes en matière
d'établissement du lien de filiation (fin de non-recevoir à une action en
contestation ou à un établissement du lien de filiation, différence de
prescription, personnes pouvant agir), mais elles ne sont pas légion.
D'autres
procèdent de différences de fait ou de droit, existant entre ces deux types
d'enfant, différences pertinentes au
regard de l'objet de la règle considérée.
1)
L'établissement du lien de filiation naturelle
Mater
semper certa est. Il est devenu banal de prôner la consécration en droit
français de l'adage "mater semper
certa est" : l'égalité avec l'enfant légitime imposerait de se
contenter des mentions de l'acte de naissance pour établir le lien de filiation
naturelle. Cette interprétation, consacrée en son temps par la Cour européenne,
vient d'ailleurs d'être retenue par une décision du Tribunal de grande
instance de Brive-la-Gaillarde du 30 juin 2000.
L'égalité dans la jouissance des droits et libertés issus de la CEDH ne
suffit pourtant pas, à notre sens, alors qu'une différence considérable sépare
enfant légitime et enfant naturel sur ce point : il existe, relativement à
l'enfant légitime, un engagement parental pris par les époux au jour du
mariage, alors qu'un tel engagement volontaire est sans équivalent à l'égard
de l'enfant naturel. Prétendre que cet établissement automatique de la
filiation découle du droit à une vie familiale suppose de réduire la
filiation juridique à n'être que le décalque du lien de sang. C'est nier
toute l'essence volontaire du lien de filiation.
Le
refus du double lien de filiation incestueuse. Ne conviendrait-il pas d'abolir
également l'article 334-10 qui empêche l'établissement du double lien de
filiation relativement à l'enfant incestueux ? Parce qu'il restreint les droits
de l'enfant en se fondant sur les circonstances de sa conception, la doctrine
l'a suggéré.
Hypocrite, cette solution peut
toutefois se justifier pour une raison symbolique : la société marque la répugnance
extrême attachée à ce tabou social essentiel. Et cette répulsion morale,
largement partagée en Europe, serait sans doute suffisante pour justifier
l'admission de cette restriction des droits de l'enfant auprès de la Cour européenne.
-
Les effets du lien de filiation naturelle
L'égalité
de statut est écartée dans deux cas principaux.
Le
premier est celui de l'autorité parentale : elle est plus souvent unilatéralement
attribuée sur l'enfant naturel que sur l'enfant légitime. L'élargissement de
l'attribution conjointe a été proposé pour "responsabiliser les pères"
naturels. On peut discuter de l'efficacité de l'attribution de l'autorité si
la réalité du lien paternel reste incertaine. On peut aussi faire valoir que
le mariage a souvent tissé, ne serait-ce qu'un instant, des liens entre
l'enfant légitime et son père, alors que rien de tel ne peut être présumé
relativement à l'enfant naturel. Est-il dès lors vraiment contraire à l'égalité
de la jouissance des droits et libertés d'attribuer l'autorité à la mère,
alors que c'est elle qui élève l'enfant, qu'un autre aura peut-être seulement
conçu avant de le reconnaître
? L'égalité ne suffit pas, en réalité, à condamner le droit français de
l'autorité parentale ; cette condamnation ne peut procéder que d'une réflexion
relative à cette institution qu'est l'autorité parentale, et notamment à la
part qui doit être faite, en son sein, aux divers éléments qui sont le lien
de sang, la volonté d'assumer l'enfant, la charge effective de ce dernier.
Le
second est celui du nom. Chacun sait que le principe patronymique est réservé
à la famille légitime, sous réserve du cas de l'enfant reconnu par ses deux
auteurs et acquérant alors le nom de son père. Mais, là encore, y a-t-il
vraiment atteinte à l'égalité entre les enfants ? Au-delà des arguments
relatifs à la préservation symbolique de la paternité,
l'unité propre à la famille légitime (unité de domicile, d'autorité) ne
justifie-t-elle pas que le principe patronymique lui soit réservé ? La réforme
actuellement en discussion au Parlement
unifierait dans une certaine mesure les règles d'attribution du nom puisque
l'article 57 du Code civil donnerait désormais aux parents la liberté soit de
choisir l'un de leurs deux noms soit d'accoler leurs deux noms lorsque la
filiation de l'enfant est établie simultanément à l'égard de l'un et
l'autre.
2°)
Le statut des adultes
L'égalité
entre les couples est un principe incertain, dans la mesure où la nature du
lien de couple établi (mariage, pacte civil de solidarité, concubinage
"simple"…) procède généralement d'un choix volontaire des
adultes. Pourrait toutefois effectivement être discutée la question de la légitimité
de la protection de telle ou telle famille plus que telle ou telle autre : elle
devrait être appréciée à l'aulne du critère de proportionnalité.
L'égalité
entre les adultes conduit enfin à apprécier toutes les distinctions
s'imposant aux intéressés : restriction de l'accès à tel ou tel statut de
couple (condition d'âge, d'hétérosexualité, condition de santé mentale…),
restriction à l'octroi de telle ou telle prérogative dans l'ordre de la parenté.
La Cour est pour l'heure assez respectueuse de la compétence législative des
Etats sur le premier point au moins.
La seule question délicate est relative au nom, et la réforme législative en
cours serait de nature à supprimer toute discrimination entre homme et femme
sur ce point.
B. Vareilles, note préc. ; J.-P.
Marguénaud, obs. préc..
V. les hésitations de J. Massip,
obs. préc., B. Vareille, note
préc., A. Gouttenoire-Cornut,
note préc.
La doctrine craint ainsi la remise en question d'actes juridiques antérieurs
pour erreur ou lésion. C'est oublier que, en principe, la cause de la
nullité s'apprécie au jour de l'acte ; or à ce jour, la lésion
n'existait pas puisque les droits de l'enfant adultérin étaient ceux sur
la base desquels le partage a été réalisé ; de même, au jour de l'acte,
la loi interne étant ce qu'elle était, aucune erreur ne pourra être
invoquée. Reste l'argument consistant à faire valoir qu'une libéralité a
procédé d'un mobile erroné puisqu'elle a été consentie en considération
d'une législation ayant été modifiée ensuite. Mais la disparition de la
cause est-elle prise en compte en droit positif ? En tout état de cause,
les dispositions transitoires auraient le mérite de supprimer toutes les
discussions.
|