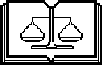|
|
Actes de la Septième Session d'information (arrêts rendus en
2000, Cahiers du CREDHO n° 7)
|
|
Affaire Caloc |
Débats |
Affaire Van Pelt |
Affaire Duroy et Malaurie
|
|
La
Convention et le droit pénal
Garde
à vue et mauvais traitements :
l’affaire
Caloc (20 juillet 2000)
par
Dominique
Allix
Professeur
à l'Université Paris-Sud (Paris XI)
Le
29 septembre 1988, vers 14 heures, M. Caloc se présente sur convocation à la
brigade de gendarmerie du Lorrain (en Martinique) pour être entendu sur la
plainte d'un entrepreneur qui le soupçonnait d'avoir saboté deux bulldozers.
Placé
en garde à vue, il tente quelques minutes plus tard de s'échapper pour
rejoindre sa femme. Il est aussitôt rattrapé et ramené dans les locaux de la
brigade où les gendarmes parviennent à le maîtriser.
Peu
de temps après, il est examiné par un médecin, le docteur Thomas, qui
constate qu'il ne se plaint d'aucune douleur et ne présente aucune lésion.
Il
est interrogé de 19 à 23 heures, passe la nuit en chambre de sûreté, puis de
nouveau interrogé, il est libéré en fin de matinée.
Le
lendemain, il se fait examiner par un médecin, le docteur Keclard, qui constate
: "une forte contusion prédeltoïdienne droite avec limitation de la
mobilité de l'épaule droite...des traces d'enserrement aux deux poignets avec
douleurs et limitation des mouvements...des douleurs lombaires avec scoliose
transitoire due à une rétractation musculaire".
M.
Caloc décide alors de porter plainte - ce qu'il fait le 18 novembre 1988 - auprès
du procureur de la République de Fort de France contre les services de la
gendarmerie du Lorrain pour coups et blessures volontaires et produit à l'appui
de cette plainte le certificat médical du docteur Keclard.
Une
enquête est ouverte, mais après audition de l'intéressé et des médecins qui
l'avaient examiné, cette plainte est classée sans suite, les éléments portés
à la connaissance du parquet ne pouvant, en l'état, justifier des poursuites pénales.
M.
Caloc qui n'entend pas en rester là réitère donc sa plainte en se constituant
partie civile et engage une procédure qui, après qu'une information
approfondie et minutieuse ait été diligentée, se solde, quelques années plus
tard, par un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Basse-Terre le 15 décembre 1994.
De
cet arrêt, il ressort :
-
qu'il y a bien eu violence mais que la preuve n'est pas rapportée que Caloc ait
été frappé ou battu ;
-
que la preuve n'est nullement rapportée que Caloc ait subi des sévices après
l'action initiale des gendarmes visant à le maîtriser et que c'est à ce
moment seulement qu'il a fait l'objet de violences dont les conséquences
corporelles ont été constatées par le docteur Keclard ;
-
que l'usage de la force était parfaitement légitime, les violences commises à
cette occasion n'ayant pas excédé ce qui est admissible en la matière.
M.
Caloc juge alors utile de se pourvoir en cassation mais, par arrêt du 6 mars
1996, la Chambre criminelle rejette ce pourvoi et relève que : "en référant
aux résultats des expertises médicales et aux témoignages et déclarations
recueillis au cours de l'enquête et de l'information, la Chambre d'accusation a
exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges
suffisantes contre quiconque d'avoir volontairement commis des violences à l'égard
du requérant".
C'est
dans ces conditions qu'estimant avoir fait l'objet de mauvais traitements et dénonçant
la durée de la procédure, M. Caloc décide de saisir la Commission qui, par 28
voix contre une, devait conclure, en ce qui concerne les mauvais traitements, à
la non-violation de l'article 3, et, en ce qui concerne la durée de la procédure,
à la violation de l'article 6 §1.
L'affaire
lui ayant été déférée par la Commission, la Cour a conclu à son tour, par
six voix contre une, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 3 de la
Convention, et, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6 §1
de la Convention.
1
• Sur la non-violation de l'article 3
La
Cour rappelle :
-
que lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard
de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue nécessaire par son
comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue en principe une
violation du droit garanti ;
-
que lorsqu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne
santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il
incombe à l'Etat de fournir une explication plausible quant à l'origine des
blessures, faute de quoi l'article 3 de la convention trouve manifestement à
s'appliquer.
A
• Ces principes étant rappelés, la Cour se prononce tout d'abord sur
l'absence alléguée d'enquête effective en examinant ce grief sous l'angle
d'une violation procédurale de l'article 3.
Rappelant
que des obligations processuelles peuvent être dégagées, dans divers
contextes, de dispositions normatives de la Convention lorsque cela a été perçu
comme nécessaire pour garantir que les droits consacrés par cet instrument ne
soient pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs, la Cour précise
que "lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux
mains de la police ou d'autres services comparables de l'Etat, des traitements
contraires à l'article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général
imposé à l'Etat par l'article 1 de la Convention de reconnaître à toute
personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la
Convention, requiert par implication qu'il y ait une enquête officielle
effective". Une enquête, précise encore la Cour, qui doit pouvoir mener
à l'identification et à la punition des responsables, enquête à défaut de
laquelle il serait possible dans certains cas à des agents de l'Etat de fouler
aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur
contrôle.
La
question de savoir s'il était approprié ou nécessaire de constater une
violation procédurale dépendait donc des circonstances particulières de l'espèce.
Or,
estime la Cour, il ne saurait être soutenu que la procureur de la république
dans le cadre de l'enquête préliminaire menée suite à la plainte du requérant
n'ait pas procédé de manière effective à une enquête, ni qu'il ait fait
preuve d'inertie ou de manque de diligence, pas plus qu'il n'est contesté que dès
qu'elle fut saisie de la plainte avec constitution de partie civile la Chambre
d'accusation de Basse-Terre effectua de nombreuses diligences pour établir les
faits, ni qu'elle les accomplit avec une particulière minutie.
B
• Quant aux allégations de violences commises lors de la tentative de fuite
du requérant, la Cour -comme dans l'affaire Klass
c/ Allemagne, 22 septembre 1993- "n'aperçoit pas de circonstances
particulières propres à douter des constats des juridictions nationales quant
à l'origine de ces douleurs et séquelles physiques qui peuvent être considérées
comme consécutives aux violences commises lors de la tentative de fuite du requérant".
Recherchant
alors si la force utilisée était en l'espèce proportionnée, la Cour conclut
qu'il n'a pas été démontré que la force employée lors de l'intervention ait
été excessive ou disproportionnée.
Formule
lourde de conséquences puisqu'elle laisse clairement entendre que c'était au
requérant, dont il est établi qu'il avait tenté de s'enfuir, de rapporter la
preuve des mauvais traitements qu'il prétendait avoir subi. Dans son opinion
dissidente sous l'arrêt Klass du 22
septembre 1993, le juge Pettiti s'étonnait
déjà qu'une simple tentative de fuite puisse dispenser l'Etat d'avoir à
justifier de la légitimité de la riposte de ses agents.
C • Quant
aux allégations de violences commises par les gendarmes postérieurement à la
fuite - le requérant prétendait avoir subi des violences après la visite du
docteur Thomas et , en particulier, être resté enchaîné en chambre de sûreté
les bras écartés pendant la nuit - la Cour reconnaît que les lésions subies
par le requérant peuvent cadrer avec cette version des faits, mais elle observe
qu'ayant eu l'avantage d'entendre le requérant ainsi que divers témoins, les
juridictions nationales avaient conclu que le requérant s'était blessé en résistant
à son arrestation lors de sa tentative de fuite et qu'il n'avait fait l'objet
d'aucun autre mauvais traitement après cet incident.
Estimant
alors qu'aucun élément propre à remettre en cause les constats de la Chambre
d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, ni de nature à étayer les allégations
de l'intéressé devant les organes de la Convention, n'a été fourni, la Cour
est d'avis, avec la Commission, que les allégations du requérant quant au
traitement qu'il aurait subi après la visite du premier médecin en fin d'après-midi
le 29 septembre 1988 ne sont pas étayées de façon suffisamment précises et
suffisamment exemptes de contradiction pour que la Cour puisse conclure à une
violation de l'article 3.
Il
reste qu'en privilégiant - au-delà de tout doute raisonnable - l'explication
suivant laquelle les douleurs et séquelles physiques présentées par le requérant
à l'issue de sa garde à vue ne seraient imputables qu'aux violences commises
lors de sa tentative de fuite, la Cour ne se prononce aucunement sur les
conditions de détention qui auraient pu être, à elles seules, inhumaines et dégradantes.
2
• Sur la violation de l'article 6 §1
A
• La Cour rejette tout d'abord l'exception préliminaire soulevée par le
Gouvernement : la requête serait incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention, le requérant n'ayant
formulé aucune demande de dommages et intérêts devant les juridictions pénales
saisies de sa plainte avec constitution de partie civile et l'arrêt de non-lieu
du 15 décembre 1994 motivé par l'absence de charges suffisantes laissant
intactes les prétentions de caractère civil du requérant...
Notant
que cette exception a déjà été examinée par la Commission qui a décidé de
la rejeter, la Cour la rejette à son tour en renvoyant à l'analyse de la
Commission.
Analyse
dont on retiendra :
-
qu'en portant plainte avec constitution de partie civile, le requérant
entendait obtenir réparation du préjudice subi du fait d'une infraction pénale
;
-
que la procédure s'étant terminée par un non-lieu, une action civile fondée
sur la responsabilité des gendarmes était vouée à l'échec et n'était qu'un
recours illusoire dans la mesure où le requérant qui n'a pu démontrer le
bien-fondé de ses allégations devant les juridictions pénales n'avait aucune
chance de le faire devant les juridictions civiles ;
-
que le droit à indemnité revendiqué par le requérant dépendait donc de
l'issue de la plainte, c'est à dire de la condamnation des auteurs des sévices
incriminés, et revêtait un caractère civil nonobstant la compétence des
juridictions pénales.
B
• Restait alors à se prononcer sur la durée de la procédure au regard des
exigences de l'article 6.
Rappelant
que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des
parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire, la Cour relève
avec la Commission :
-
que la procédure fut d'une durée de plus de sept ans s'agissant de la seule
instruction de la plainte avec constitution de partie civile du requérant ;
-
que près de deux ans furent nécessaires afin que le président de la Chambre
d'accusation de Basse-Terre soit désigné pour instruire cette plainte, les
autorités judiciaires ayant au préalable considéré à tort que les faits
litigieux n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'une constitution de
partie civile.
Or,
estime la Cour, une diligence particulière s'imposait aux autorités
judiciaires saisies s'agissant de l'instruction d'une plainte déposée par un
individu en raison de violences prétendument commises par des agents de la
force publique à son encontre et même si la Chambre d'accusation de
Basse-Terre s'est livrée à une enquête spécialement approfondie et
minutieuse, au total la diligence requise n'a pas été observée en l'espèce.
"Souvent
l'injustice n'est pas dans le jugement, elle est dans les délais", des délais
dont la Cour a estimé qu'ils avaient causé au requérant un tort moral certain
- celui d'avoir nourri de faux espoirs pendant sept ans ? - pour lequel 60 000
F. lui ont été octroyés.
|
|
Débats
Michèle
DUBROCARD
A
mon sens, cette affaire n’aurait jamais dû aller devant la Cour. La
Commission avait pris le soin de prendre sa décision dans sa formation plénière
(28 juges contre 1), et le rapport avait été rendu quasiment à l’unanimité.
Avec un tel écart de voix, on pouvait s’attendre à ce que l’affaire puisse
rester au niveau de la Commission. C’est avec une grande surprise que nous
avons appris au niveau du gouvernement que la Cour avait été saisie, et cette
dernière n’a fait que confirmer le rapport très fouillé qu’avait fait la
Commission, lequel rapport s’appuyait sur l’arrêt de la Chambre
d’accusation qui était lui-même étonnamment étayé. Il est rare en effet
de voir des arrêts de Chambres d’accusation dire n'y avoir lieu à suivre et
faire, comme en l’espèce, une dizaine de pages ; la Chambre d'accusation
avait pris le problème point après point, s’était posée tout un
ensemble de questions pour essayer d’éclaircir au mieux cette affaire. Je
pense que de ce point de vue là le gouvernement français n’a rien à dire.
Sur la durée de la procédure non plus : c’est vrai qu’elle a été longue.
On peut l’expliquer par le dépaysement de l’affaire et le fait que la
Chambre d’accusation ait elle-même fait procéder à de nombreux examens et
à de nouvelles investigations, mais il est vrai que globalement 7 ans, c’est
long... Pour une fois, nous sommes très satisfaits de l’arrêt rendu par la
Cour.
Gilbert
BITTI
Après
l’agent, c’est le conseil qui intervient ... Il y a un mot que vous avez
prononcé qui me semble très important, c’est le mot contradiction. Caloc
n’a en effet pas arrêté de se contredire. Il commence par produire un
certificat où il a une douleur à l’épaule gauche, puis d’un seul coup, en
cours de procédure, ce sera à l’épaule droite, puis à l’épaule gauche.
En 1994, il va ensuite déclarer que les policiers lui ont fait passer 8 heures
dans une chambre où là il a eu les bras écartés et qu’on lui a fait subir
le supplice de la croix !…
Dominique
ALLIX
La
première contradiction, ce n’est pas Caloc, mais les médecins qui en sont à
l’origine. Le docteur Thomas affirme qu'il ne s'est rien passé pendant
l'arrestation et qu'il n'a rien constaté d'anormal. Puis le docteur Keclard,
confronté à ce curieux constat, explique : c'est normal, les bleus et les
courbatures apparaissent 48 heures après !
En
réalité, les gendarmes étaient confrontés à une tentative de rébellion et
il fallait que force reste à la loi. Le gouvernement français n'a d'ailleurs
jamais contesté qu'il y avait eu usage de la force. On ne peut pas arrêter
quelqu'un qui se débat, qui tente de s'échapper, en lui donnant un morceau de
sucre… cela ne marche pas.
Mais
fallait-il rendre un arrêt de 30 pages pour expliquer qu'il n'y avait pas eu
violation de l'article 3 et laisser planer un doute sur la manière dont cette
garde à vue s'était déroulée au motif que les déclarations de l'intéressé
étaient contradictoires ?
Michèle
DUBROCARD
Très
rapidement, j’ajoute un élément d’information supplémentaire. Dans
l’affaire Selmouni, nous avons été
condamnés, et il est important de prendre en compte l’activité du Comité de
prévention de la torture qui avait rendu un rapport manifestant quelques préoccupations
à l’égard de la garde à vue dans les locaux de la police. En revanche, les
rapports du Comité de prévention de la torture ont toujours été des rapports
assez élogieux à l’égard de la gendarmerie, et on peut se demander également
dans quelle mesure la Cour européenne n’a pas pris en considération, sans le
dire, les rapports que rend régulièrement le Comité de prévention de la
torture à l’égard de la gendarmerie…
Dominique
ALLIX
Je
pense que cet arrêt aurait été le bienvenu si, s'agissant d'apprécier la
proportionnalité de la force utilisée, la Cour n'était pas tombée dans
l'erreur de l'affaire Klass. En effet, la Cour laisse entendre que c'était an requérant
qui avait tenté de s'enfuir de prouver que les moyens de contrainte utilisés
étaient disproportionnés. Or comme le soulignait le juge Pettiti
dans son opinion dissidente sur l'affaire Klass
: fournir une explication plausible à l'origine des blessures - ce dont le
gouvernement devait rapporter la preuve - c'est prouver aussi que les blessures
n'excèdent pas ce qui est raisonnable…
Véronique
CHAUSSARD-HUGUES (ancien gendarme en brigade territoriale)
Mon
propos ne souhaite remettre en cause ni la valeur de l'arrêt présenté, ni la
légitimité de la requête d'Adrien Caloc, tels que l'exposé du professeur Allix
nous les présente. Cependant, trois choses m'ont interpellée dans cette
affaire.
La
première, c’est qu’effectivement le premier médecin n’a pas remarqué de
traces sur le corps de M. Caloc. C’est possible puisqu’au tout début de la
garde à vue, nous, gendarmes, faisons intervenir un médecin afin de savoir si
la garde à vue est juridiquement
valable, c'est-à-dire si elle "est compatible avec l'état de santé de
l'individu".
La
seconde remarque concerne les bleus. M. Caloc est en garde à vue, il cherche à
s’échapper. L’officier de police judiciaire présent essaie avec les deux
autres gendarmes de le maîtriser. Il peut s’en suivre alors selon le degré
de résistance et de volonté du mu mis en cause, des "bleus" ou des
ecchymoses liés à la lutte. En précisant cependant que la présence des bleus
a posteriori ne prouve aucunement leur imputation à la garde à vue. La visite
médicale de M. Caloc a lieu quelques jours après la fin de sa garde à vue…
Il faut noter que les menottes ont un système à clips, ce qui a pour conséquence,
à vouloir les retirer de force, de les serrer encore davantage. Elles peuvent
donc effectivement laisser des marques à la personne qui cherche à s'en défaire.
De plus, il peut très bien s'être fait du mal lui-même en cherchant à
s'enfuir. L'intéressé lui-même parle de "panique". L'arrêt est très
précis puisqu'il dit : "il s'est blessé…" et ne semble pas mettre
en cause la lutte qu'il apparaît avoir de lui-même engagé de par son
attitude.
Troisième
point important : lorsqu’il dit qu’il "avoir été enchaîné les bras
en croix dans une chambre de sûreté", un "cachot". Depuis le
bagne de Toulon, Les moyens de détention de police ont évolué. D'une part,
les chambres de sûreté sont des lieux faits de béton (il n’y a pas
d’anneau) et une personne qui y est présente de par sa garde à vue, se voit
retirer sa ceinture, sa cravate, et un certain nombre d’objets avec lesquels
elle pourrait justement porter atteinte à son intégrité physique. Il y a une
fenêtre, certes (il ne s'agit pas d'un "cachot" comme le déclare M.
Caloc), celle-ci est généralement équipée de pavés de verre pour éviter
toute tentative d'évasion, ou de suicide (pendaison à la crémone, par
exemple). D’autre part, ce sont des lieux entretenus et régulièrement visités
(comme le faisait remarquer le représentant du gouvernement) : nos bureaux sont
le plus souvent contigus à ces chambres de sûreté et la gendarmerie n'apprécie
pas de travailler dans les mauvaises odeurs…
J’ai
le sentiment à la fin de cet exposé que les conditions et les moyens
d'exercice de la police judiciaire décrits (selon les termes de M. Caloc) font
appel à une vision judiciaire d'il y a 100 ans, au moins… Les moyens de
police ont évolué, même aux Antilles !
Arlette
HEYMANN-DOAT
Je
pense qu’on fait là une erreur d’interprétation. Il n’y a pas de
question sur le fond. On n’est pas dans le cas Selmouni.
On est dans la question, comme Dominique l’a bien montré, de procédure. Si
la France a été condamnée, c’est sur la longueur de la procédure
judiciaire, pour voir si oui ou non il y avait eu mauvais traitements dans le
cadre de cette garde à vue. Sur ce point, je trouve que l’arrêt Caloc
est remarquable et doit être médité. Il va dans le sens de ce que va faire la
France d’ailleurs, c’est-à-dire que la police et la gendarmerie ne doivent
pas craindre des enquêtes de procédure judiciaire de plaintes, au contraire,
on doit les mener avec célérité et toute la question est là. La France doit
être capable de prouver que sa police agit de façon conforme au droit et à la
Convention européenne des droits de l’Homme. C’est cela que dit la Cour, ce
n’est pas une question de fond, c’est une question de forme. On doit mener
rapidement des procédures d’enquêtes sur toutes les allégations de mauvais
traitements qui auront été faits dans le cadre des gardes à vue.
Dominique
ALLIX
Vous
avez tout à fait raison, mais en un quart d’heure, il est très difficile
d’expliquer le détail de la procédure. En réalité, ce qui a entraîné des
longueurs dans la procédure, ce n’est pas du tout l’enquête préliminaire
de trois mois, et ensuite toutes les expertises... mais là où la procédure a
été mal enclenchée, c’est lorsqu’au regard de l’article 687, à propos
de la délocalisation de l’affaire, il y a eu un pourvoi en cassation. On a
estimé d’abord que c’était contraventionnel et qu’il n’était donc pas
possible de se constituer en partie civile, qu’il n’y avait pas lieu à délocalisation
; il y a eu une procédure et des incidents qui en ont retardé le cours. Mais
ce n’est pas le fait des services de gendarmerie, qui ont agi conformément
aux réquisitions du parquet.
Michele
DE SALVIA
Pourquoi
un arrêt Caloc ? Parce que c’est
une allégation grave, sérieuse (l’article 3 de la Convention), mais aussi
pour « laver » le gouvernement de tout soupçon. Il faut replacer
cette affaire française dans son contexte. La France est un pays important en
Europe, mais c’est un des 41 pays du Conseil de l’Europe. Il y a d’autres
situations : en Lituanie, en Turquie, en Grèce aussi. Cet arrêt a un effet
didactique. On peut le montrer, on peut faire un recours. On va en Turquie, on
dit : voilà ce qu’il faut faire, voilà ce que vous ne faites pas, voilà
pourquoi vous êtes condamnés. Il a une grande utilité.
|
|
La
Convention et le droit pénal
L’équité
de la procédure en appel et en cassation :
l’affaire
Van Pelt (28 mai 2000)
par
Olivier
Bachelet
Allocataire
de recherche à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
« Quand
on est contumax, on ne peut récuser, et on n’est point admis à récuser par
procureur ». C’est en réponse à
cette affirmation qu’est intervenu, dans le prolongement de l’affaire Poitrimol
c/ France,
l’arrêt Van Pelt du 28 mai 2000. De
manière plus générale, cette affaire porte sur la conventionnalité du
principe selon lequel toute personne mise en cause, dans le cadre d’une procédure
pénale, et absente sans excuse valable, lors de son jugement, perd son droit à
être défendu. Incidemment, cet arrêt vient confirmer la jurisprudence de la
Cour, ayant mené à la censure du système français, s’agissant de
l’irrecevabilité du pourvoi en cassation formé par le prévenu qui ne
s’est pas constitué prisonnier en exécution de la décision attaquée.
En
l’espèce, après son extradition de l’Espagne vers la France, le requérant
– de nationalité néerlandaise – avait été inculpé, fin 1987, pour
infraction à la législation sur les stupéfiants, contrebande et intérêt à
la fraude. L’instruction permit de révéler l’existence d’un réseau
international de trafic de stupéfiants et mena à la mise en cause de plusieurs
personnes de nationalités différentes.
Renvoyé
devant le tribunal correctionnel de Bobigny, en janvier 1990, le requérant fut
condamné pour trafic de stupéfiants à dix-huit années d’emprisonnement et
à l’interdiction du territoire français. Toutefois, la Cour d’appel de
Paris infirma ce jugement au motif que « s’il existe à l’encontre de
Van Pelt les charges très lourdes de culpabilité relevées par le tribunal, il
subsiste néanmoins un très léger doute, mais qui doit lui profiter et entraîner
la relaxe ». Sur pourvoi du procureur général, la Cour de cassation
cassa cet arrêt en soulignant la contradiction des juges d’appel ayant
constaté l’existence de lourdes charges et, pourtant, prononcé la relaxe.
Renvoyée
devant la Cour d’appel d’Amiens, en mars 1993, l’affaire fit l’objet
d’un premier renvoi aux fins, notamment, de citation du requérant. Après
plusieurs demandes de renvoi, les avocats de la défense produisirent deux
certificats médicaux indiquant que le requérant avait été hospitalisé et
demandèrent, une nouvelle fois, le renvoi de l’affaire. La Cour d’appel
rejeta cette demande, au motif que les certificats produits étaient trop imprécis
pour justifier l’absence du requérant, et statua sur le fond sans que les
avocats de la défense ne soient entendus. Sur le fondement d’éléments
objectifs issus du dossier, venant corroborer les accusations et témoignages,
les juges d’appel confirmèrent le jugement de première instance et délivrèrent
mandat d’arrêt à l’encontre du requérant. La Cour de cassation déclara,
en octobre 1995, irrecevable le pourvoi formé par le requérant et refusa donc
d’apprécier le refus opposé par la Cour d’appel d’entendre les avocats
de M. Van Pelt. Elle fonda sa décision sur le fait que, n’ayant pas déféré
au mandat d’arrêt décerné contre lui, le requérant « ne justifiait
d’aucune circonstance l’ayant mis dans l’impossibilité absolue de se
soumettre en temps utile à l’action de la justice » (§ 30).
Le
requérant saisit alors les organes de Strasbourg afin qu’ils constatent la
violation de l’article 6 de la Convention en raison du caractère excessif de
la durée de la procédure, de l’impossibilité d’un plaidoyer de la défense
sur le fond devant la Cour d’appel de renvoi et du rejet pour irrecevabilité
du pourvoi par la Cour de cassation.
1.
S’agissant de la violation alléguée de l’article
6 § 1, de la Convention, sur le fondement d’une durée déraisonnable
de la procédure, la Cour reprend sa jurisprudence traditionnelle. Ainsi, elle détermine,
au préalable, la période à prendre en considération qui, selon elle, s’étend
de l’arrestation du requérant en Espagne – donc, avant même son
extradition vers la France – jusqu’au prononcé du dernier arrêt de la Cour
de cassation. A la suite, elle rappelle les critères permettant d’apprécier
le caractère raisonnable, ou non, de la durée de la procédure, en particulier
la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes. Or, en l’espèce, la Cour souligne la grande
complexité de l’affaire, liée au caractère international du trafic de stupéfiants.
En outre, elle précise qu’au cours de la phase d’instruction, ayant duré
un peu moins de trois ans, le magistrat instructeur a diligenté de nombreux
actes et a, notamment, entendu à six reprises le requérant. Enfin, elle relève
que la phase de jugement a donné lieu à quatre instances différentes en
seulement sept années, ce qui ne permet pas d’imputer un délai excessif aux
autorités judiciaires compétentes. Dès lors, la Cour conclut à la non
violation de l’article 6 §
1, quant à la durée de la procédure.
Si
cette solution peut être discutée, comme l’indiquent deux juges
dans leur opinion partiellement dissidente jointe à l’arrêt, notamment au
regard de la période de dix-huit mois séparant l’arrêt de la Cour d’appel
de renvoi et celui de la Cour de cassation, ce n’est pas sur la question de la
durée de la procédure que repose l’intérêt essentiel de l’arrêt Van
Pelt. En effet, c’est surtout
au regard des deux autres violations alléguées de la Convention que
l’argumentation de la Cour révèle toute sa pertinence.
2.
S’agissant de l’impossibilité pour les avocats de la défense de
plaider au fond devant la Cour d’appel de renvoi, le requérant appuie son
raisonnement sur la jurisprudence antérieure de la Cour européenne qui a déjà
condamné à plusieurs reprises un tel obstacle à l’exercice des droits de la
défense.
Le Gouvernement français, quant à lui, expose une argumentation proche de
celle développée lors de l’affaire Poitrimol
en affirmant, de manière lapidaire, que « le requérant ne pouvait se
dispenser de comparaître, à moins de produire une excuse valable », ce
qui implique qu’« il ne pouvait se faire représenter par un avocat en
son absence » (§ 59).
Afin
de trancher cette opposition, la Cour relève, au préalable, qu’il ne lui
appartient pas de se prononcer sur la manière dont la Cour d’appel a apprécié
les certificats médicaux produits par le requérant dans la mesure où il
s’agit « d’éléments de preuve relevant de l’appréciation
souveraine des juges des juridictions internes » (§ 64).
Ceci constitue donc une application de sa jurisprudence traditionnelle selon
laquelle « si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès
équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves
en tant que telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit
interne ».
Abordant
de manière plus directe la question de l’impossibilité pour les avocats du
requérant de plaider en son absence, la Cour souligne que la comparution d’un
prévenu revêt une importance capitale au regard tant du droit de celui-ci à
être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses
affirmations et de les confronter avec les dires de la victime ainsi que des témoins.
Ceci implique donc que le législateur s’emploie à décourager les absences
injustifiées. Toutefois, selon la Cour, le droit de tout prévenu à être
effectivement défendu par un avocat fait partie des éléments fondamentaux du
procès équitable. Or, ce droit ne saurait disparaître du seul fait de
l’absence aux débats de la personne mise en cause. En effet, la sanction
d’une absence injustifiée consistant en la suppression du droit à
l’assistance d’un défenseur apparaît disproportionnée dans la mesure où
« les exigences légitimes de la présence des accusés aux débats
peuvent être assurées par d’autres moyens que la perte du droit à la défense » (§
67).
Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1, combiné
avec l’article 6 § 3, c),
de la Convention.
Cette
solution apparaît largement inspirée de celle dégagée dans l’arrêt Poitrimol bien qu’un point important distingue les deux affaires.
En effet, dans l’arrêt Poitrimol,
la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait refusé à l’avocat de la défense
la possibilité de plaider au fond au motif que le prévenu n’avait pas déféré
au mandat d’arrêt décerné par le Tribunal correctionnel.
En revanche, dans notre arrêt, si la Cour d’appel de renvoi adopte une
solution identique, elle la fonde de manière différente, en relevant le caractère
imprécis et non circonstancié des certificats médicaux produits par le prévenu.
Ainsi, alors que, dans l’arrêt Poitrimol,
la décision litigieuse était fondée sur un motif de droit, emprunté à une
jurisprudence bien établie,
dans notre arrêt, le fondement invoqué repose sur un motif de fait.
Cette
différence est d’importance. En effet, à la lecture de l’arrêt Poitrimol, il apparaissait que seule était en cause l’ancienne règle
jurisprudentielle, puisée dans les principes généraux de la procédure pénale,
selon laquelle le prévenu qui se dérobe à l’exécution d’un mandat
d’arrêt, sans justification valable, n’est pas en droit de se faire représenter
en justice. La Cour européenne semblait alors vouloir éviter qu’une personne
mise en cause puisse être condamnée en son absence, sans moyen de défense et
sans aucun recours
et , au seul motif qu’elle
s’était soustraite à l’exécution d’un mandat de justice. Avec l’arrêt
Van Pelt, la Cour paraît aller
beaucoup plus loin puisqu’elle affirme qu’en toutes hypothèses, même en présence
d’une excuse considérée comme injustifiée par les juges nationaux, le requérant
doit pouvoir être défendu en son absence par un avocat. Cette position
implique donc, en pratique, un véritable « droit à ne pas assister à
son procès »,
sauf à créer de nouvelles sanctions afin de s’assurer de la présence du prévenu.
Une
telle solution semble être une interprétation scrupuleuse de l’article 6 §
3, c), de la Convention qui offre au défendeur une alternative,
soit comparaître lui-même à l’audience, soit y renoncer et se faire représenter
par un avocat de son choix. L’arrêt Van
Pelt paraît également être la conséquence logique des droits reconnus à
la personne mise en cause par la Convention. En particulier, la possibilité
laissée au prévenu de ne pas assister aux débats va dans le sens de son droit
à garder le silence. En effet, comme le note le juge Bonello dans son opinion concordante jointe à l’arrêt Van
Geyseghem c/ Belgique, « si au nom des avantages reconnus qu’en
retire l’administration de la justice, il fallait considérer la présence de
l’accusé à son procès comme une condition préalable à toute défense, on
pourrait faire valoir les mêmes arguments pour l’obliger à renoncer à son
droit au silence, c’est-à-dire invoquer aussi l’intérêt d’une bonne
administration de la justice ».
Toutefois,
l’arrêt Van Pelt paraît largement
critiquable dans la mesure où il vient remettre en cause le principe de la
comparution personnelle des parties, pourtant destiné à assurer l’effectivité
du dialogue contradictoire sur les preuves et à permettre aux juges de former,
en connaissance de cause, leur intime conviction. Ainsi, l’objectif premier du
procès pénal – à savoir, la manifestation de la vérité – se retrouve
dans une situation particulièrement choquante de dépendance par rapport au bon
vouloir du défendeur. Même si quelques atténuations peuvent être apportées
à cette règle, notamment celle prévue par l’article 411, alinéa 1er,
du Code de procédure pénale pour les infractions de faible gravité,
passibles d’une peine inférieure à deux ans d’emprisonnement,
l’obligation de comparaître demeure un principe fondamental.
Or, l’article 6 § 3, c), de la Convention, comme le soulignait le
gouvernement français dans l’arrêt Poitrimol,
ne confère pas à la personne mise en cause un droit général de « représentation »,
mais simplement un droit à l’« assistance » d’un avocat. Ceci
implique donc que le prévenu, ou l’accusé, soit présent à l’audience
puisqu’« on n’assiste pas une personne absente ».
Par conséquent, comme l’indiquait le juge Pettiti
dans son opinion dissidente jointe à l’arrêt Poitrimol, l’interprétation dégagée par la Cour européenne
semble remettre en cause l’exigence primordiale de comparution personnelle et
mener à une rupture de l’égalité des armes puisque la victime se voit alors
privée du pouvoir de contredire, de « démasquer son
adversaire »
et du droit à être confrontée
à lui.
De
plus, l’arrêt Van Pelt apparaît
difficilement compatible avec la jurisprudence Kremzov
c/ Autriche dans laquelle la Cour a affirmé, toujours sur le fondement de
l’article 6 § 3, c), de la Convention, que tout accusé devant être mis en
mesure de se défendre lui-même, l’Etat avait l’obligation positive
d’assurer sa comparution personnelle au procès, même en l’absence de
demande de sa part, lorsque l’enjeu du procès apparaît particulièrement
important
– ce qui semble bien être le cas en l’espèce, eu égard aux peines
encourues par le prévenu –. Surtout, cet arrêt menace d’entraîner à un véritable
bouleversement de la procédure pénale française, d’une part, quant à la
phase d’instruction qui devrait pouvoir se dérouler en l’absence de la
personne mise en examen, simplement représentée par un avocat et, d’autre
part, quant à la phase de jugement puisque le juge verrait largement compromise
sa tâche de personnalisation de la sanction, impliquant « qu’il ait au
moins vu et interrogé la personne mise en cause ».
3.
Enfin, s’agissant de l’irrecevabilité du pourvoi en cassation du requérant,
la Cour reprend sa jurisprudence antérieure.
Elle considère qu’une telle irrecevabilité, fondée uniquement sur le fait
que le demandeur ne s’est pas constitué prisonnier en exécution de la décision
de justice faisant l’objet du pourvoi, contraint l’intéressé à
s’infliger d’ores et déjà la privation de liberté résultant de la décision
attaquée. Or, cette décision ne peut être considérée comme définitive tant
qu’il n’a pas été statué sur le pourvoi ou que le délai de recours ne
s’est pas écoulé. Dès lors, il est porté atteinte à la substance même du
droit de recours puisqu’est imposée au requérant « une charge
disproportionnée, rompant le juste équilibre qui doit exister entre, d’une
part, le souci légitime d’assurer l’exécution des décisions de justice
et, d’autre part, le droit d’accès au juge de cassation et l’exercice des
droits de la défense » (§ 73).
Ainsi, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1, de la Convention.
En
procédure pénale, le principe général veut que le pourvoi en cassation et le
délai du recours soient suspensifs d’exécution jusqu’au prononcé de
l’arrêt de la Chambre criminelle. Toutefois, une exception prévoit que le
mandat d’arrêt décerné à l’encontre du condamné, comme c’est le cas
en l’espèce, doit produire ses effets.
L’arrêt Van Pelt va donc à
l’encontre de cette dernière règle en considérant que la peine privative de
liberté résultant d’une décision non encore définitive ne doit pas être
exécutée. Cette jurisprudence complète ainsi la solution dégagée dans
l’arrêt Khalfaoui c/ France qui
concernait l’hypothèse du condamné n’ayant pas fait l’objet d’un
mandat d’arrêt et, pourtant, obligé de se constituer prisonnier au plus tard
le jour de l’examen de son pourvoi en cassation.
Néanmoins,
l’une des justifications avancée par ces deux arrêts peut être critiquée,
comme l’indique le juge Loucaides
dans son opinion dissidente jointe à l’arrêt Khalfaoui.
En effet, la Cour se fonde en partie sur le fait qu’en cas de cassation de
l’arrêt attaqué, l’obligation du requérant de se constituer prisonnier
apparaît particulièrement injuste et contraire à la présomption
d’innocence.
Or, dans cette hypothèse, le placement en détention provisoire de la personne
mise en cause avant son jugement apparaît également injuste et devrait mener
à une remise en cause de cette procédure pourtant admise par la jurisprudence
de la Convention afin d’éviter tout risque de fuite.
Quant
à la sanction procédurale consistant à déclarer irrecevable le pourvoi en
cassation du condamné récalcitrant, la Cour dénonce l’idée selon laquelle
« la justice ne devrait pas dire le droit à l’égard de celui qui se dérobe
à ses commandements ».
Cette position, qui est dans l’exact prolongement de sa jurisprudence antérieure,
consacre donc un véritable droit au juge de cassation.
Face
à la multiplication des condamnations, dont l’arrêt Van Pelt est l’une des illustrations, quelle a été l’attitude
de la France ?
Dans
un premier temps, la Chambre criminelle a refusé de se plier à la
jurisprudence de la Cour européenne, ce qui a mené aux arrêts
Omar et Guérin.
Ce n’est qu’en 1999, par une décision Rebboah
citée par le gouvernement dans notre arrêt
(§ 72), que la Cour de cassation a décidé d’abandonner sa jurisprudence en
matière d’irrecevabilité du pourvoi fondée sur le défaut d’exécution
d’un mandat d’arrêt.
Néanmoins,
l’hypothèse prévue par l’ancien article 583 du Code de procédure pénale,
concernant l’obligation de mise en état, demeurait applicable. Seule la loi n°
99-515 du 23 juin 1999 était venue en réduire la portée au moyen de quelques
aménagements procéduraux. Mais ceci ne suffit pas
et la Cour européenne condamna la France sur le principe même de l’article
583. Démontrant
l’influence grandissante de la jurisprudence de Strasbourg, le Parquet général
de la Cour de cassation décida alors de renoncer à inviter les condamnés restés
libres à se constituer prisonniers la veille de l’examen de leur pourvoi.
Finalement, la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 mit définitivement fin à
l’obligation de mise en état, en abrogeant les articles 583 et 583-1 du Code
de procédure pénale.
Toutefois,
l’« acharnement »
des autorités françaises à ne pas tirer promptement toutes les conséquences
de la jurisprudence Poitrimol menace
d’avoir de fâcheuses incidences. Notre arrêt en est un exemple,
ainsi que l’affaire Papon.
En
outre, il apparaît que plusieurs autres dispositions du Code de procédure pénale
demeurent en contradiction avec la jurisprudence de la Cour européenne. Ainsi,
s’agissant du droit au juge de cassation, l’article 575 du Code semble
s’opposer aux principes dégagés par la Cour de Strasbourg dans la mesure où
il restreint considérablement le droit de la partie civile à former un pourvoi
à l’encontre d’un arrêt de la Chambre de l’instruction.
De même, l’article 636 du Code, qui prive le contumax de tout pourvoi en
cassation, apparaît nettement contestable.
Enfin, dans le domaine du droit – discutable – à la « représentation », l’article 630 du Code, qui exclut la présence
d’un avocat de la défense lors d’une procédure de contumace, semble
heurter de front les conclusions dégagées dans l’arrêt Van Pelt.
Sur ce point, la Cour de Justice des Communautés Européennes a d’ailleurs récemment
relevé, après avoir fait référence à la jurisprudence de la Cour européenne,
que l’article 630 du Code de procédure pénale français est incompatible
avec le droit à être défendu, droit qui « occupe une place éminente
dans l’organisation et le déroulement d'un procès équitable et [qui] figure
parmi les droits fondamentaux qui résultent des traditions constitutionnelles
communes aux Etats membres ».
Michele
DE SALVIA
C’est
un arrêt qui se situe dans le prolongement de plusieurs affaires que vous avez
citées, mais également d’affaires qui ne sont pas mentionnées dans cet arrêt,
affaires qui ont été examinées il y a une quinzaine d’années concernant la
procédure de contumace où le problème a été posé de façon tout à fait
claire par rapport à la situation italienne d’avant 1989 où le système
excluait la purgation de la contumace.
CEDH, arrêt Poitrimol
c/ France du 23 novembre 1993, op.
cit. : « La suppression
[du droit à être défendu] se révèle
disproportionnée dans les circonstances de la cause : elle privait M. Poitrimol,
non recevable à former opposition contre l'arrêt de la cour d'appel, de sa
seule chance de faire plaider en seconde instance sur le bien-fondé de
l'accusation en fait comme en droit » (§ 35).
S’agissant de la procédure criminelle et, en particulier, de l’article
630 du C.P.P., la Cour européenne des droits de l’Homme a effectivement
estimé, dans un arrêt récent, que « sanctionner
la non-comparution du requérant par une interdiction aussi absolue de toute
défense apparaît manifestement disproportionné » et conclu sur
la violation de l’article 6, § 1, combiné avec l’article 6, § 3, c)
(CEDH, arrêt Krombach c/ France du
13 février 2001, op. cit., §
90).
|
|
La
Convention et le droit pénal
La
présomption d’innocence et la liberté de la presse :
l’affaire Du Roy et Malaurie (3 octobre 2000)
par
Me
Thierry MASSIS
Avocat
au Barreau de Paris
Ancien
membre du Conseil de l'Ordre
Au
fil de ses arrêts, la Cour européenne modifie le paysage juridique français
pour le mettre aux normes de la Convention européenne. Tous les domaines de
droit sont concernés : pénal, civil, commercial, à tel point que les
Entretiens de Saintes ont consacré leur septième colloque à la question :
"Fait-on encore la loi chez soi ?, colloque qui s'interroge sur les
incidences de la Convention européenne sur la loi nationale. Mais il était une
forteresse qui semblait être protégée des assauts de la Cour européenne :
les lois sur la liberté de la presse.
Héritées
de la haute tradition de la Déclaration des droits de l’Homme qui postulait
le principe de liberté, ces lois semblaient à l’abri de toute critique de
l’article 10 de la Convention.
À
cet égard, la Cour de cassation rejetait d'une manière quasi constante les
pourvois formés sur une prétendue incompatibilité entre la loi sur la presse
et la Convention européenne.
Mais,
pour la troisième fois, la Cour de Strasbourg vient de condamner la France pour
violation de l’article 10 de la Convention européenne de la sauvegarde des
droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La
censure de la Cour européenne a pour origine l'article 2 de la loi du 2 juillet
1931 qui interdit de publier toute information relative à des constitutions de
partie civile n’est pas conforme à l’article 10.
L’affaire
a pour origine un article rédigé par M. Guillaume Malaurie,
journaliste, dans l’hebdomadaire « L’Evènement
du Jeudi » dont le directeur de publication de l’époque était M.
Albert du Roy.
Cet
hebdomadaire a, dans son numéro du 11 au 17 février 1993, publié un article
intitulé « Sonacotra, quand la
gauche fait le ménage à gauche ».
Cet
article mettait en cause un ancien dirigeant de la Sonacotra (Société
nationale de construction de logements pour les travailleurs), M. Michel Gagneux
et les relations entretenues par ce dernier avec la nouvelle direction de la
Sonacotra.
Cet
article indique que les dirigeants actuels de la Sonacotra « ont
déposé une plainte pour abus de confiance et de biens sociaux contre leur prédécesseur
Michel Gagneux. »
Le
journaliste saluait le courage des anciens dirigeants dans les termes suivants :
« Echec
à la raison d’Etat ! En provoquant une plainte pour abus de confiance et
de biens sociaux contre leur prédécesseur Michel Gagneux, les dirigeants de la
Sonacotra ont fait acte de courage".
M.
Michel Ganeux s’estimait victime de l’infraction prévue à l’article 2 de
la loi française du 20 juillet 1931, qui dispose : « Il est interdit
de publier, avant décision judiciaire, toute information relative à des
constitutions de partie civile faites en application de l’article 63 du Code
d’Instruction criminelle (Code de Procédure Pénal, article 85), sous peine
d’une amende de 120.000 F édictée par le dernier alinéa de l’article 39
de la loi du 29 juillet 1881».
Les
juridictions internes ont toutes réagi de la même manière en reconnaissant la
culpabilité du journaliste et du directeur de la publication.
Aux
termes de son jugement en date du 9 juillet 1993, le Tribunal correctionnel de
Paris relève que les dispositions de l’article 2 de la loi du 2 juillet 1961
sont conformes à l’article 10, dans la mesure où elles s’inscrivent
parfaitement dans le cadre des restrictions à la liberté d’expression
autorisée par la Convention.
La
Cour d’appel confirme le principe de la culpabilité et renforce l’analyse
des premiers juges pour l’article 10.
Les
requérants ont formé un pourvoi en cassation.
La
Cour de cassation, dans un arrêt en date du 19 mars 1996, estime que
l’article 2 de la loi du 2 juillet 1961 est compatible avec les dispositions
de l’article 10.
Cette
décision a été soumise à un recours porté devant la Commission européenne
des droits de l’Homme (ancien régime).
La
procédure suivie devant la Cour a abouti à la décision du 3 octobre 2000.
Comme
toujours, dans ce type d’affaires, la Cour européenne a été confrontée à
un conflit de valeurs.
Nous
allons montrer, dans un premiers temps, les enjeux du débat posé par cette
affaire (I) avant de donner les principes de solution dégagés par la Cour
(II).
I
• Les enjeux du débat
Comme
toute affaire de presse, la Cour européenne était confrontée à la problématique
classique : le conflit entre la liberté d’expression et le respect de la
personne. La liberté d’expression est une sentinelle de la démocratie. Elle
est consacrée par les grands textes :
-
article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
-
article 1er de la loi de 1881 ;
-
les normes internationales (article 10, article 19 du Pacte).
La
liberté d’information n’est pas absolue. Elle comporte des limites :
le respect des droits d’autrui.
Plusieurs
textes concourent au respect des droits d’autrui :
•
la loi du 2 juillet 1931. L’article 2 de la loi du 2 juillet 1931 est un texte
de circonstance.
L’objet
de cette loi était de réformer le Code d’instruction criminelle en
permettant au juge d’instruction saisi d’une plainte avec constitution de
partie civile de ne pas inculper les personnes visées par cette plainte et de
rendre un non-lieu sans inculpation.
L’article
2 de cette loi avait pour objet de lutter contre le chantage qui se faisait par
la publicité lorsqu’une personne était l’objet d’une information
judiciaire après dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile de
M. Deligny
;
•
le Code civil.
L’article
9.1. du Code Civil édicte que chacun a droit au respect de la présomption
d’innocence.
•
les articles 11 et 91 du Code de procédure pénale qui édictent : "Le
secret de l'instruction … la
faculté pour une personne mise en examen qui a fait l'objet d'une décision de
non-lieu à demander des dommages intérêts au … "
II
• Le principe de solution dégagé par l'arrêt : la prééminence de la
liberté d'expression
La
requête du journaliste était essentiellement fondée sur l’économie du
texte de l’article 2 de la loi du 2 juillet 1931. Elle soutenait que le délit
prévu par ce texte emportait une restriction à la liberté d’information, dès
lors qu’il existe une information judiciaire ouverte en application de
l’article 85 du Code de procédure pénale, c’est-à-dire sur plainte avec
constitution de partie civile.
Elle
en déduisait l’interdiction objective d’information, cette infraction ayant
pour effet d’écarter le public de façon définitive de renseignements
relatifs à des procédures judiciaires en cours qui intéressent l’intérêt
général. C’était d’ailleurs le cas en l’espèce, car le contentieux
concernait un article de presse consacré à une affaire judiciaire d’intérêt
public, à savoir le conflit entre l’ancienne et la nouvelle direction d’une
société publique particulièrement dans le secteur social, la Sonacotra. Et
c’est ce caractère général et absolu de l’interdiction qui va entraîner
la conviction de la Cour.
La
Cour rappelle avec force les principes fondamentaux qui se dégagent de la
jurisprudence de l’article 10 : la liberté d’expression constitue
l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Elle vaut non
seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur et considérées
comme inoffensives, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent.
Au vu de ce principe, la nécessité d’une quelconque restriction à
l’exercice de la liberté d’expression doit se trouver établie de manière
convaincante.
La
Cour relève :
1°)
La sanction prononcée à l’encontre des requérants n’était pas nécessaire
dans une société démocratique
Se
fondant sur la liberté d’information qui doit être la plus large en ce qui
concerne les questions judiciaires d’intérêt public. Dans un attendu qu’il
convient de rappeler, la Cour relève l’incompatibilité existant entre
l’article 2 de la loi du 2 juillet 1931 et l’article 10 de la Convention.
Elle estime que cette interdiction objective d’informer n’est pas nécessaire
dans une société démocratique, même si les juridictions internes l’ont
estimé justifiée pour protéger la réputation d’autrui et garantir
l’autorité judiciaire.
Cette
sanction ne protège pas toutes les personnes d’une manière égale.
2°)
Le caractère disproportionné d’atteinte à la liberté d’information
Sans
l’évoquer précisément, la Cour européenne estime que l’atteinte portée
à la liberté d’information par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1931
n’est pas proportionnée au but légitime poursuivi par l’Etat.
En
l’espèce, la proportionnalité fait manifestement défaut car ce texte français
édicte un régime d’interdiction absolue.
En
outre, la Cour relève que tout mécanisme protecteur des droits des personnes
mises en cause rend non nécessaire l’interdiction absolue prévue par la loi
de 1931.
3°)
Les limites apportées par la Cour par la présomption d’innocence.
Il
est sûr que l’article 2 de la loi du 2 juillet 1931 constituait une garantie
de la présomption d’innocence et était un moyen efficace de lutter contre
les informations abusives.
Certes,
d’autres dispositions protègent la présomption d’innocence. À cet égard,
il est important de relever que la Cour précise que les journalistes qui
doivent rédiger des articles sur des procédures pénales en cours doivent ne
pas franchir les bornes fixées aux fins d’une bonne administration de la
justice et respecter les droits de la personne mise en cause et présumée
innocente. C'est parce qu'il existe d'autres mesures de protection que la Cour
européenne a estimé que l'article 2 n'était pas nécessaire dans une société
démocratique.
Conclusion
Par
cette décision, la loi du 29 juillet 1881 est-elle atteinte par l'article 10?
C'est
un débat essentiel aujourd'hui.
Déjà
quarante décisions de la Cour de cassation ont écarté l'application de la
Convention. Mais cette décision témoigne d'une évolution non seulement au
niveau de la Cour européenne, mais aussi en ce qui concerne les juridictions
internes.
Par
jugement en date du 25 avril 2001, la 17ème chambre de la presse a
estimé que le délit d'offense à Chef d'État prévu par l'article 36 de la
loi du 29 juillet 1981 est incompatible avec les dispositions des articles 6 et
10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
La
conformité de la loi du 29 juillet 1981 par rapport à la Convention européenne
est d'une brûlante actualité
Michele
DE SALVIA
C’est
un arrêt qui s’inscrit dans le droit fil de nombreux arrêts qui ne
concernent pas que la France.. Le pays qui a été le plus condamné pour la
violation de la liberté d’expression est le Royaume-Uni, suivi par l’Autriche,
la France, la Norvège, etc. Mais c’est par rapport à cette jurisprudence que
l’on voit qu’il n’y a pas eu de nivellement vers le bas. On l’applique
avec la même rigueur aux pays de l’Ouest comme aux pays de l’Est. La liberté
d’expression dans la philosophie même de la Cour est l’assise de la démocratie.
C’est la garantie que la démocratie peut continuer à vivre. L’arrêt qui a
donné lieu à le plus de critiques, très virulentes, c’est l’arrêt Jersild
où l’on retrouvait l’apologie de l’intolérance et de la haine raciales
impute à un journaliste de télévision danois qui a permis à des skinheads de
se montrer sous leur jour véritable, dans le cadre d’une émission de télévision
consacrée aux problèmes de société. Ces skinheads ont traité les étrangers,
entre autres, d’êtres inférieurs, de singes, etc. Le journaliste a été
condamné. Le Danemark a été condamné. La liberté d’informer doit être
quasiment absolue et les limites sont pratiquement minimes. Si on prend l’échelle
de la marge d’appréciation, on peut dire qu’en matière de liberté
d’expression elle est très large lorsqu’il s’agit de sauvegarder la
morale et certains principes moraux, la susceptibilité ou les croyances
religieuses ; par contre, lorsqu’il s’agit d’interférer dans le travail
des journalistes lorsqu’ils informent, et lorsqu’ils critiquent les
personnalités politiques, la marge est extrêmement réduite. C’est un
enseignement de la Cour qui nous dit : faites attention, ne touchez pas à la
presse, car en touchant à la presse, vous touchez à la démocratie.
L’arrêt
qui va être commenté par M. Haïm est un arrêt exemplaire dans lequel la Cour
dit : la jurisprudence a été jusqu’ici celle-là, maintenant pour les
raisons qui suivent, nous estimons qu’il faut changer d’optique. Là aussi
il y a une passerelle avec le droit communautaire, parce qu’en fait, la Cour
de Strasbourg reprend intégralement des principes qui ont été élaborés dans
le cadre communautaire et consacrés par la jurisprudence de la Cour de Justice.
|
|
|