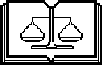|
La
Convention et le droit administratif
L’application
de l’article 6 aux fonctionnaires et agents publics :
la
jurisprudence Pellegrin (suite),
les
affaires Frydlender (27 juin 2000),
S.M.
(18 juillet 2000),
Lambourdière
et Satonnet (2 août 2000)
par
Victor
Haïm
Commissaire
du gouvernement
à
la Cour administrative d’appel de Paris
Professeur
associé à l’Université de Paris XI
Nous
n'allons pas aborder maintenant les rapports entre la Cour européenne des
droits de l’Homme et le droit administratif : les litiges relevant des
juridictions financières (Cour de discipline budgétaire et financière), la
plupart des litiges relatifs aux étrangers et la police administrative telle
que mise en œuvre dans le contrôle de l'abattage rituel de la viande, relèvent
du droit administratif.
Mais
il est vrai que le contentieux des agents publics est à la fois symbolique et
quantitativement important. En outre, il a été le siège d'une importante évolution
initiée par un arrêt Pellegrin c/ France
(n° 28541/95) du 8 décembre 1999.
Je
voudrais, dans le court laps de temps qui m'est imparti, essayer d'exposer la
logique de cet arrêt (I), avant d'en voir la portée (II).
I
• La logique de l'arrêt Pellegrin c/ France
Avant
l'arrêt Pellegrin c/ France (n°
28541/95) du 8 décembre 1999, la Cour européenne des droits de l’Homme opérait
une double distinction :
‑
d'abord entre fonctionnaires recrutés par voie de décision unilatérale et
agents non titulaires ‑ assimilés dans nombre d'Etats membres du Conseil
de l'Europe à des salariés de droit privé ;
‑
ensuite, à l'intérieur de la première catégorie, entre les litiges relatifs
au recrutement, à la carrière et à la cessation d'activité qui « sort(ai)ent,
en règle générale, du champ d'application de l'article 6 § 1 »
et les autres litiges qui entraient dans le champ d’application de cet
article.
Estimant
qu'il importait d'assurer un traitement égal des agents publics dans les Etats
parties à la Convention, indépendamment du système d'emploi pratiqué sur le
plan national, et quelle que soit en particulier la nature du rapport juridique
entre l'agent et l'administration, la Cour a voulu, avec l'arrêt Pellegrin
c/ France, dégager une interprétation de la notion de « fonction publique
» qui ne soit pas liée au mode de recrutement - contrat ou recrutement
unilatéral -, mais à la nature des fonctions et des responsabilités
exercées par l'agent (Pellegrin c/ France, § 64).
Pour
ce faire, elle s'est appuyée sur la jurisprudence que la Cour de Justice des
Communautés européennes a élaborée
pour définir le sens et la portée de l'art. 48 § 4 du Traité C.E.E. qui prévoit
une dérogation au principe de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur
de la Communauté pour les « emplois dans l'administration publique ».
Dans
son arrêt de principe du 17 décembre 1980, Commission
c/ Belgique la Cour de Justice des
Communautés européennes a décidé que la dérogation ne concernait que les
« emplois comportant une participation, directe ou indirecte, à
l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la
sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités
publiques » et supposent ainsi de la part de leurs titulaires – pour
reprendre les termes mêmes de l’analyse que la Cour européenne des droits de
l’Homme donne de cette jurisprudence.
« l'existence d'un rapport particulier de solidarité avec l'Etat ainsi
que la réciprocité de droits et devoirs qui sont le fondement du lien de
nationalité. »
Dans
une communication publiée au J.O.C.E. n° C 72 du 18 mars 1988, que la Cour
européenne des droits de l'Homme vise et reproduit largement, la Commission
européenne a fait la synthèse de cette jurisprudence en distinguant :
‑
d'une part, "les activités qui relèvent d« une participation directe ou
indirecte à l'exercice de la fonction publique et aux fonctions qui ont pour
objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ».
Il
s'agit des « fonctions spécifiques de l'Etat et des collectivités
assimilables telles que les forces armées, la police et les autres forces de
l'ordre, la magistrature, l'administration fiscale et la diplomatie » ainsi que
des « emplois relevant des ministères de l'Etat, des gouvernements régionaux,
des collectivités territoriales et autres organismes assimilés, des banques
centrales dans la mesure où il s'agit du personnel (fonctionnaires et autres
agents) qui exerce les activités ordonnées autour d'un pouvoir juridique
public de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public telles que l'élaboration
des actes juridiques, la mise en exécution de ces actes, le contrôle de leur
application et la tutelle des organismes indépendants ».
Les
emplois relevant de cette première catégorie sont couverts par la dérogation
au principe du libre accès aux emplois.
‑
d'autre part, les emplois sans rapport avec l'exercice de la puissance publique
et la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat et des activités
suffisamment éloignées des précédentes pour ne pouvoir que très
exceptionnellement relever de l'exemption prévue à l'article 48 § 4 du traité
CEE.
Il
s'agit essentiellement des emplois dans :
-
les organismes chargés de gérer un service commercial tels que les transports
publics terrestres, maritimes ou aériens, la distribution d'électricité ou de
gaz, les postes et télécommunications ou les médias (radio télédiffusion) ;
-
les services opérationnels de santé publique ;
-
l'enseignement ou la recherche à des fins civiles dans les établissements
publics.
Cette
jurisprudence avait été dégagée par la Cour de Jutice des Communautés européennes
pour apprécier si et dans quelle mesure la nationalité pouvait être un critère
pertinent de recrutement. Par sa jurisprudence Pellegrin c/ France (§§ 64-67),
la Cour européenne des droits de l’Homme
l'a sortie de son contexte pour en faire un critère du droit à un procès
équitable garanti par l'art. 6 § 1 de la CEDH. Ceci l’a amenée à
distinguer trois cas de figure :
-
Si le requérant occupe un emploi « comportant une mission d'intérêt général
ou une participation à l'exercice de la puissance publique et s'il détient
ainsi une parcelle de la souveraineté de l'Etat qui a donc un intérêt légitime
à exiger de ces agents un lien spécial de confiance et de loyauté » (Pellegrin
c/ France, § 65), il n'a pas droit au procès équitable garanti par l'art.
6 § 1 de la Convention pour le jugement d'un litige l'opposant à son
administration.
-
La même règle s'applique lorsque le requérant n'est pas un agent de l'Etat,
mais un agent public local qui compte tenu de la nature de ses fonctions et de
ses responsabilités, participe directement ou indirectement à l'exercice de la
puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux
de la collectivité publique qui l'emploie.
-
Dans le cas contraire, s'il n'entre dans aucun des cas de figure envisagés à
l'instant, il a droit à un procès équitable.
Enfin,
selon la Cour européenne des droits de l’Homme, le contentieux des
prestations sociales et des pensions doit faire l'objet du procès équitable
garanti par l'art. 6 § 1 quels que soient les fonctions ou l'emploi de l'agent
public.
Ainsi, dans un arrêt du 2 août 2000,
Deschamps c/ France (req. n° 37925/97) la Cour ne fait pas même allusion
à sa jurisprudence Pellegrin c/ France pour
admettre l'applicabilité de l'art. 6 § 1 de la Convention à un litige relatif
aux prestations familiales et au supplément familial de traitement des
fonctionnaires. Et dans un arrêt du 21 novembre 2000, Piscopo c/ Italie (req. n°
44357/98), elle décide que l'art. 6 § 1 est applicable au recours que l'intéressé
avait introduit afin d'obtenir une pension en raison d'une infirmité contractée
pendant le service militaire.
II
• La portée de l'arrêt Pellegrin c/ France
La
jurisprudence Pellegrin c/ France de
la Cour a été constamment reprise dans tous les arrêts rendus au cours de
l'année écoulée.
Ainsi
c'est par référence expresse à cet arrêt qu'il a été jugé que l'art. 6 §
1 est applicable lorsque le requérant avait été recruté par contrat pour
occuper un emploi de concierge dans une école publique (CEDH 30 mars 2000, Procaccini c/ Italie, req. n° 31631/96), de chef de section
autonome au sein du Service de l'expansion économique du M.E.F. (CEDH 27 juin
2000, Frydlender c/ France, req. n°
30979/96), de directeur d'un Centre médico-psychopédagogique communal (CEDH, 2
août 2000, Satonnet c/ France, req. n°
30412/96) et de médecin spécialisé en gynécologie employée par une unité
sanitaire locale (CEDH 21 novembre 2000, Cecchini
c/ Italie, req. n° 44332/98).
De
même, s'agissant de fonctionnaires et non plus d'agents contractuels, il a été
jugé que l'art. 6 § 1 était applicable à un agent de bureau de la fonction
publique territoriale (CEDH, 18 juillet 2000, S.M.
c/ France, req. n° 41453/98), à un adjoint administratif de l'Assistance
publique (CEDH, 2 août 2000, Lambourdière
c/ France, req. n° 37387/97) et à un « assesseur principal » en poste à
l'Institut national de criminologie et chargé essentiellement de missions de
recherche, d'information et d'expertise (CEDH, 26 octobre 2000, Castanhiera
Barros c/ Portugal, req. n° 36945/97).
Par
contre, c'est sans surprise - au regard du critère dégagé par Pellegrin c/ France - que la Cour européenne des droits de
l’Homme a jugé que l'art. 6 § 1 n'était pas applicable au jugement du
recours introduit par un sous-officier pour faire reconnaître son droit à
percevoir une indemnité de service nocturne pour l'activité qu'il avait
accomplie en tant que sous-officier des inspections ou en tant qu'officier de
garde (CEDH, 5 décembre 2000, Mosticchio
c/ Italie, req. n° 41808/98)
On
notera que, dans une affaire assez comparable, le Conseil d'Etat avait considéré,
au contraire, que l’art. 6 § 1 était applicable (Conseil d'Etat, ass., 5 décembre
1997, Mme Lambert, Rec.
p. 460, A.J.D.A. 1998, p. 149 concl. Bergeal)
Cette
jurisprudence Pellegrin c/ France,
qui a été saluée comme « globalement positive », m'apparaît pourtant
comme difficile à mettre en œuvre (A) et, surtout, comme contestable dans son
fondement même (B).
A
• Une jurisprudence difficilement opérationnelle
Le
critère de la participation à l'exercice d'une mission d'intérêt général
ou de la puissance publique n'est pas sans rappeler celui de la participation à
une mission de service public administratif que les juridictions françaises
avaient dégagé pour déterminer la juridiction compétente pour connaître des
actions contentieuses des agents publics contractuels.
On
sait que cette jurisprudence aboutissait à des situations qui auraient été
cocasses si elles n'avaient pas concerné des personnes dont les besoins et le
niveau socio-économique ne sont pas de ceux qui prédisposent à apprécier des
subtilités qui font la joie des apprentis juristes et des praticiens. Il
suffira de rappeler ces morceaux d'anthologie que sont Dme Vve Mazerand
ou Comm. de Grand-Bourg de Marie-Galante
c/ Mme Lancelot.
On
sait aussi qu'il y a été mis fin par l'arrêt du tribunal des conflits du 25
mars 1996, Berkani .
Parce
qu'elle repose sur la même logique, loin de simplifier et d'apporter la lumière,
la jurisprudence Pellegrin c France, doit
déboucher sur les mêmes incertitudes et les mêmes discussions.
Au
demeurant, l'arrêt lui-même en est une bonne illustration !
En
effet, ainsi qu'il est expressément souligné (§§ 8 et suiv.), si M.
Pellegrin a été recruté par le ministère français de la Coopération et du
Développement, ce n’est pas pour travailler pour le compte de
l'administration française, mais « en qualité de coopérant conseiller
technique du ministre de l'Economie, de la Planification et du Commerce de la
Guinée équatoriale ». Le contrat précise, d’ailleurs, que « le requérant
est mis à la disposition du gouvernement de la République de la Guinée équatoriale »
et vise la loi du 13 juillet 1972,
laquelle précise que les personnels qu’elle concerne sont placés « sous
l’autorité du gouvernement de l’Etat étranger ».
Il
apparaît ainsi qu'à supposer même que M. Pellegrin occupait un emploi «comportant
une mission d'intérêt général ou une participation à l'exercice de la
puissance publique » des autorités de la République de la Guinée équatoriale,
il ne détenait aucune « parcelle de la
souveraineté de l'Etat » français avec lequel il était en litige.
Par
contre, toujours sur la base du principe adopté par la Cour, un requérant qui
a attendu 9 ans avant de voir rejeter son recours tendant à ce que lui soit
reconnu le droit de percevoir une indemnité de service nocturne
‑contentieux patrimonial s'il en est ! – n’a pas droit à un procès
équitable parce qu'il est sous-brigadier (CEDH, 5 décembre 2000, Mosticchio
c/ Italie, req. n° 41808/98).
Si
on cherche les raisons de ce caractère peu opérant de la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’Homme, il y a d'abord et évidemment la
difficultés qu’il y a à dire où passe la frontière entre ce qui relève de
la participation à l’exercice de la puissance publique et ce qui n’en relève
pas.
Il
y a aussi le caractère artificiel de cette jurisprudence souligné par les
juges qui ont émis une opinion dissidente : un critère dégagé pour déterminer
les limites qui peuvent être apportées au droit des ressortissants des Etats
membres de la Communauté à occuper un emploi public dans un Etat dont ils ne
sont pas ressortissants ne peut raisonnablement servir de critère au droit à
un procès équitable !
Mais
il y a aussi et surtout le fait qu'en dernière analyse la jurisprudence se
situe dans le droit fil d'une lecture de l'art. 6 § 1 qui témoigne, pour citer
l'appréciation peu élogieuse d'un membre éminent de la Cour
d'une certaine propension à « se replier frileusement dans le cocon d'une
interprétation étriquée et pusillanime » que rien ne justifie et que tout
condamne.
B
• Le sens et la portée de l’art. 6 § 1 de la Cour européenne des droits
de l’Homme
Pour
que l'art. 6 § 1 trouve à s'appliquer, il faut que soit cumulativement rempli
un certain nombre de conditions :
-
il doit y avoir « contestation » sur un « droit » que l'on peut prétendre,
au moins de manière défendable, reconnu en droit interne ;
-
il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse ;
-
cette contestation peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que
son étendue ou ses modalités d'exercice ;
-
enfin, selon la Cour européenne des droits de l’Homme, il faut aussi - pour ne pas dire surtout
- que le droit en question soit un droit «de
caractère civil ».
La
Cour semble s'attacher à une lecture littérale de cette dernière condition.
Or l° cette lecture ne se justifie pas et 2° même si elle se justifiait, elle
ne pourrait pas donner un fondement juridiquement acceptable à la jurisprudence
de la Cour.
1)
Une lecture apparemment littérale que rien ne justifie
Périodiquement
la Cour européenne des droits de l’Homme relève qu' « il faut retenir,
conformément à l'objet et au but de la Convention, une interprétation
restrictive des exceptions aux garanties offertes par l'art. 6 § 1 ».
Sur la base d’une telle profession de foi, il est clair qu’une lecture littérale
de l’art. 6 § 1 ne peut se justifier.
En
fait, elle ne peut se justifier pour trois raisons.
1°
Il y a d'abord la raison que donnait le juge De
Mayer pour s'écarter de l'opinion majoritaire dans l'affaire Pierre-Bloch c/ France :
« une distinction des droits civils et des droits politiques (est) en elle-même
assez étrange du point de vue de l'étymologie ».
2°
Qu'il s'agisse de la Convention européenne des droits de l’Homme ou des
Protocoles additionnels, dans les deux cas il est toujours précisé que le
texte a été fait « en français et en anglais » et que « les deux textes
font également foi ». Or, la version anglaise de l'article retient la notion
de « civil rights » et n’a pas une portée
aussi restreinte ou étroite que la version française. Ainsi dans la partie
qu'ils consacrent aux civil rights,
MM. Stanley de Smith et Rodney Brazier
(Constitutional and administrative law, Penguin, 6e édit.,
part V, pp. 421 et suiv.) traitent de ce que nous appellerions les droits
civiques et les libertés publiques.
Il
semble donc que, si elle voulait être cohérente avec ses prétentions affichées
la Cour devrait donner à l'art. 6 le sens et la portée que permettent et
appellent l'étymologie et la version anglaise du texte.
3°
Mais ce n'est pas tout ! On peut dire que la jurisprudence de la Cour qui oppose
les droits civils aux droits civiques est trois fois contraire à la Convention
européenne des droits de l’Homme.
1)
La Convention européenne s'ouvre par une révérence marquée à la Déclaration
universelle des droits de l'Homme et affirme solennellement qu'elle « tend à
assurer la reconnaissance et l’application universelles et effectives des
droits qui y sont énoncés». Or, l’art. 8 de la Déclaration universelle des
droits de l'Homme proclame solennellement que « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes
contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la
constitution ou par la loi. » et son art. 7 garantit l’égalité devant la loi et le droit
à une protection égale contre toute discrimination.
Dès
lors, en développant une jurisprudence qui repose sur l’idée que l’art. 6
§ 1 permet une interprétation qui prive la majorité des justiciables du droit
à un procès équitable – sans lequel il n’y a pas de « recours
effectif » -, la Cour méconnaît la lettre et l’esprit d’une
Convention qu’elle a pour mission d’appliquer !
2)
La jurisprudence de la Cour est incompatible avec l'art. 13 de la Convention
européenne des droits de l’Homme qui stipule que « Toute personne dont les
droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a
droit à l'octroi d'un recours effectif
devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise
par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ».
En
effet, ce que l’art. 13 vise ce sont « les droits … reconnus par la
Convention » – tous les droits et
pas uniquement les seuls droits civils. Et, dès lors qu’on aura admis
qu’il n’y a pas de recours effectif sans procès équitable, on ne voit pas
ce qui justifierait en droit une jurisprudence qui refuse le droit à un procès
équitable alors qu’à l’origine du litige il y a la violation d’un droit
commis par une administration, c’est-à-dire par une personne agissant dans
l'exercice de ses fonctions officielles.
3)
Enfin, elle est aussi contraire aux stipulations de l'art. 60 de la Convention,
« Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme
limitant ou portant atteinte aux droits de l'Homme et aux libertés
fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute
Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie
contractante est partie. »
Or,
d’une part, il ne ressort d'aucune des analyses des droits étrangers rapportées
dans le texte des décisions de la Cour que des pays membres du Conseil de
l'Europe aient admis que, devant des juridictions de droit commun, qu'elles
soient civiles, commerciales ou administratives, certains requérants avaient
droit au procès équitable dont d'autres se trouvaient privés.
D’autre
part et surtout, ni le juge administratif, ni le juge judiciaire français n'ont
jamais considéré qu'il y avait deux types de procès ‑ l'un entouré de
garantie lui assurant un caractère équitable lorsque l'enjeu du litige est de
l'ordre du civil ; l'autre dispensé de ces mêmes garanties lorsqu'il s'agit de
droits civiques.
Il
est vrai que pendant un temps le Conseil d'Etat a considéré, comme le fait la
Cour européenne des droits de l’Homme depuis l’arrêt Pellegrin, que la proximité du pouvoir brûlait les ailes et que
certains, de ce fait, se trouvait naturellement privés du droit à un procès
équitable – et même d’une parodie de procès. C'est la théorie de l'acte
de gouvernement appliquées aux fonctionnaires et agents d’autorité. Mais
elle a été abandonnée en 1875 !
Aujourd'hui
les règles applicables à la carrière des agents des collectivités publiques
placés près des organes de décisions sont différentes (Conseil d'Etat ass.,
13 mars 1953, Tessier, Rec. C.E. p. 133, D. 1953, p. 737 concl. J. Donnedieu de Vabres, G.A.J.A.
12e édit. n° 79) ; mais devant le juge, les règles applicables aux
litiges qui les opposent à leur administration sont exactement les mêmes que
celles qui s'appliquent aux agents occupant le bas de la hiérarchie.
Ainsi
la jurisprudence Pellegrin constitue non
seulement une violation des principes énoncés aux art. 13 et 60 et dans le préambule
de la Convention, mais aussi - au regard de l’évolution de la jurisprudence
des juridictions françaises en matière de droit au recours des fonctionnaires
et agents publics - une véritable régression.
2)
Une lecture littérale qui, en tout état de cause, ne pourrait pas donner un
fondement en droit à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’Homme.
Ajoutons
que même s'il était acceptable de prendre le § 1er de l'art. 6 au
pied de la lettre, cela ne permettrait certainement pas de rendre la
jurisprudence de la Cour sur le champ d’application de l’art. 6 § 1
acceptable.
1)
D'une part, alors que dans son arrêt Pellegrin
c/ France (§. 60) la Cour entend
confirmer ce qu'elle a dit dans son arrêt Pierre-Bloch
c/ France au sujet des litiges en matière électorale (§ 51), à savoir
qu'« un contentieux n'acquiert pas une nature « civile » du seul fait qu'il
soulève aussi une question d'ordre économique», on peut faire remarquer que,
conformément à ses prétentions affichées de toujours retenir une interprétation
restrictive des exceptions aux garanties offertes par l'article 6 § 1
conformément à l'objet et au but de la Convention, elle aurait été mieux
inspirer de juger qu'un contentieux ne perd pas sa nature « civile » du seul fait qu'il ne
soulève pas uniquement une question d'ordre économique.
Ce
n’est pas parce qu’un litige oppose un fonctionnaire d’autorité à son
administration qu’il n’a pas un enjeu essentiellement, voire exclusivement
patrimonial pour l’intéressé.
Alors
qu'elle rappelle à l'occasion que l'issue de la procédure doit être
directement déterminante pour le droit en question (CEDH, Gr.Ch., 27 juin 2000,
Frydlender c/ France, n° 30979/96, §
27), comment la Cour peut-elle prétendre que sa jurisprudence est fidèle à la
lettre ou, a fortiori à l'esprit de
l'art. 6 de la Convention ?
C'est
d'ailleurs l'objection principale formulée dans les opinions dissidentes.
2)
D'autre part et surtout, aux termes de la version française de l'art. 6 § 1 «
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la. loi qui décidera des contestations sur ses droits et
ses obligations de caractère civil,... ».
On
peut lire et relire cet article ; jamais on ne pourra y voir qu'il ne vise
que les seuls litiges dans lesquels les droits et les obligations de caractère
civil sont l'objet même des conclusions à
l'exclusion de ceux dans lesquels le juge doit décider de ces droits et
obligations au niveau des moyens.
Pour
le dire autrement, quand la Cour juge qu'un requérant ne peut se prévaloir de
l'art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme lorsque ses
conclusions devant la juridiction nationale étaient relatives à des élections,
à sa carrière dans la fonction
publique ou à ses impôts parce que, s'il y a bien contestation sur ses droits
civils que sont les revenus de sa famille ou son patrimoine, c'est uniquement au
niveau des moyens et non au niveau des conclusions, elle lui dénie le droit à
un procès équitable sur la base d’une interprétation restrictive du texte
que rien ne justifie.
Ainsi
à l'issue des quelques réflexions qui précèdent, il apparaît que le juge De
Mayer n'a pas noirci le tableau en brocardant l' « interprétation étriquée
et pusillanime » de l'art. 6 retenu par la Cour. Le contentieux de la fonction
publique en est un bon exemple. Mais la même observation aurait pu être faite
si le contentieux examiné avait été celui de l'impôt ou des élections. Et
aujourd’hui, au regard des leçons qu’on peut tirer non seulement de l’arrêt
Pellegrin, mais aussi d’autres décisions
jurisprudentielles récentes (si j’ai bien entendu les propos tenus par
certains des intervenants qui m’ont précédé), on peut légitimement se
demander si la Cour, dans le souci - sans doute légitime - de ne pas se laisser
submerger par des recours toujours plus nombreux, ne se transforme pas en
machine à fabriquer du « non droit à un procès équitable ».
Michele
DE SALVIA
Je
suis malheureusement obligé de m’éclipser et vous allez juger la Cour par
contumace !
La loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel
civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats
étrangers précise (art. 3) « Sous réserve des règles propres à
l'exercice des fonctions judiciaires, les personnels visés par la présente
loi servent, pendant l'accomplissement de leurs missions, sous
l'autorité du Gouvernement de l'Etat étranger ou de l'organisme auprès
duquel ils sont placés, dans des conditions arrêtées entre le
Gouvernement français et les autorités étrangères intéressées…
Art. 6. Right to a fair trial.
|