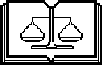|
Le respect de la vie privée et familiale
Le cadavre et le droit au
respect de la vie familiale
(arrêt Pannullo et Forte du 30 octobre 2001)
par
Anne DEBET
Maître de conférences à
l'Université de Paris II
Une nouvelle condamnation de la
France est intervenue dans l’arrêt Pannullo et Forte le 30 octobre 2001.
L’affaire était tragique. Elle
donne l’occasion à la Cour européenne des droits de l’Homme d’élargir encore le
champ du droit au respect de la vie familiale, pour l’appliquer cette fois à des
questions concernant la sépulture.
Les requérants, un couple de
ressortissants italiens (M. Vincenzo Pannullo et Mme Forte), vinrent en France
pour que leur fille de 4 ans, Erika, y soit opérée. C’est à l’Hôpital Marie
Lannelongue, hôpital réputé pour son service de chirurgie thoracique, que
l’opération eut lieu. Malheureusement, après une série de complications,
l’enfant, prénommée Erika, mourut le 24 juin 1996.
Les requérants portèrent plainte
auprès du Procureur de la République et une information sur les causes de la
mort fut ouverte le 1er juillet 1996. Le juge
d'instruction ordonna une autopsie le 3 juillet 1996, autopsie qui fut pratiquée
le 9 juillet suivant. Plusieurs prélèvements furent effectués pour un examen
complémentaire éventuel. Le magistrat aurait alors été prévenu par un des
médecins que les prélèvements de viscères ayant été effectués, le corps pouvait
être rendu à la famille. Le rapport d’autopsie daté du 25 juillet 1996 conclut
que la mort d’Erika est intervenue dans un contexte infectieux respiratoire
aigu. Les services de l’Institut Médico-Légal, où était conservé le corps,
s’inquiétèrent à de nombreuses reprises (en juin 1996, en août 1996 et le 15
janvier 1997) de la durée du dépôt du corps et en informèrent le juge
d’instruction chargé de l’affaire. En septembre 1996, une autre expertise (cette
fois anapathologique) fut ordonnée par le juge, expertise qui concernait les
viscères et ce dernier ne reçut le rapport définitif des experts que le 29 avril
1997. Ce rapport concluait à l’absence de faute médicale.
A compter de la date de
l’autopsie, les requérants firent de multiples démarches pour récupérer le corps
et les autorités italiennes intervinrent à de nombreuses reprises. Pourtant, ce
n’est que le 14 février 1997 que le juge d’instruction (ou plutôt le doyen des
juges d’instruction, en l’absence du premier juge, parti en vacances) délivra le
permis d’inhumer à la requête du Procureur de la République.
Le 19 février 1997, Erika fut
enterrée au cimetière de Terracina. Elle ne devait pas encore reposer en paix
puisqu’une autre autopsie fut ordonnée ultérieurement par le Tribunal de Rome.
Au début du mois de septembre 1997, les requérants furent informés du classement
de leur dossier.
Les parents de l’enfant, très
affectés par cette longue attente, portèrent l’affaire devant les juridictions
européennes.
Ils engagèrent d’abord une
action contre la France, mais aussi contre l’Italie, cette dernière étant
accusée de ne pas leur avoir apporté le soutien nécessaire dans leurs démarches
pour récupérer le cadavre de leur enfant. Les requérants invoquaient en
particulier les lacunes de l’autorité consulaire. Le 16 avril 1998, la
Commission rejeta cette dernière requête en estimant que les autorités
italiennes n’avaient aucune responsabilité directe dans le retard mis pour
restituer le corps.
Les requérants dirigeaient
principalement leur requête contre la France. Ils invoquaient une violation de
l’article 3. La non restitution du corps de leur fille aurait constitué une
torture ou un traitement inhumain et dégradant. La Cour, dans sa décision sur la
recevabilité, en date du 23 novembre 1999, déclare ce grief irrecevable, au
motif que la situation n’atteignait pas le seuil de gravité requis pour entrer
dans le champ d’application de l’article 3.
Autre grief déclaré
irrecevable : celui fondé sur l’article 9 de la Convention. Les requérants
affirmaient que l’article 9 était violé car, catholiques pratiquants, ils
n’avaient pas pu pendant de nombreux mois donner une sépulture religieuse à leur
fille, ni prier sur la tombe de leur enfant. La Cour considère que ces questions
sont déjà examinées au titre de l’article 8 et que, par conséquent, il n’y a pas
lieu de retenir le grief fondé sur l’article 9.
C’est donc sur l’article 8 qu’a
porté le débat devant la Cour européenne des droits de l’Homme.
Le gouvernement ne contestait
pas que le délai mis pour restituer le corps avait été très long. Il soulignait
que ce retard était imputable soit à l’inertie des experts soit à une mauvaise
compréhension de la matière médicale par le juge. Le gouvernement français
considérait que les mesures ordonnées visaient un but légitime : la prévention
des infractions, mais il disait s’en remettre à la sagesse de la Cour européenne
pour déterminer s’il existait un juste équilibre entre le but légitime visé par
ces mesures et le droit au respect de la vie familiale et privée des requérants.
La Cour européenne constate que
le corps de l’enfant aurait pu à l’évidence être rendu au parent après
l’autopsie. Eu égards aux circonstances de l’affaire et au caractère dramatique
pour les requérants de la perte de leur enfant, la Cour constate que les
autorités françaises n’ont pas ménagé un juste équilibre entre le droit des
requérants au respect de leur vie privée et familiale et le but légitime visé.
Elle conclut à une violation de
l’article 8 et elle attribue une satisfaction équitable au requérant
(remboursement des frais de séjour, de transport, des frais et honoraires) et
surtout 100 000 francs au titre du préjudice moral (alors que le gouvernement
français proposait pour sa part 30 000 francs).
L’affaire Pannullo et Forte
c/France est importante non pas tant en ce qui concerne le délai mis pour
restituer le corps, (I) mais en ce qu’elle consacre une extension du
droit au respect de la vie familiale (II).
I • Le délai de restitution du
corps
Dans l’affaire Pannullo et
Forte, une autopsie avait été ordonnée. Il convient donc de s’intéresser
dans un premier temps au régime de l’autopsie, pour déterminer si la pratique de
celle-ci constitue en elle-même une violation de l’article 8 de la Convention
(A). Il faut ensuite préciser quelle règle préside à la restitution du cadavre
en droit interne, pour voir si les normes internes, sont, en elles-mêmes,
contraires aux exigences européennes (B).
A.- Le régime de l’autopsie
L’autopsie est une atteinte à
l’intégrité du cadavre qui peut être vécue de façon douloureuse pour les
familles. La question du consentement de ces familles à l’autopsie doit donc
être posée.
M. Pannullo et Mme Forte
souhaitaient qu’une enquête sur les causes du décès soit ouverte. Par
conséquent, il est certain qu’ils ne s’opposaient pas à l’autopsie. On peut
néanmoins envisager des situations dans lesquelles des parents contesteraient
sur le fondement de l’article 8, c’est à dire du droit au respect de la vie
privée et familiale, la pratique des autopsies. Encore faudrait-il pour cela que
La Cour européenne étende le droit au respect de la vie familiale au droit
d’empêcher une atteinte corporelle sur le cadavre d’un proche. Il n’est pas
évident que la Cour européenne adopterait une telle attitude d'autant qu’en
droit interne les médecins doivent restituer le corps intact pour ménager les
sentiments des familles. C’est le but de la restauration tégumentaire prévue par
l’article L. 1232-5 du Code de la santé publique : “Les médecins ayant procédé à
un prélèvement sur une personne décédée sont tenus d’assurer une restauration
décente de son corps”.
La principale critique que l’on
pourrait adresser au droit français en matière d’autopsie, c’est son absence de
précision et la diversité des régimes des différentes autopsies. L’article L.
1232-3 du Code de la santé publique dispose qu’ “aucun prélèvement à des fins
scientifiques autres que celui ayant pour but de rechercher les causes du décès
ne peut être effectué sans le consentement du défunt exprimé directement par le
témoignage de la famille. Lorsque le défunt est mineur, ce consentement est
exprimé par un des titulaires de l’autorité parentale. La famille est informée
des prélèvements effectués en vue de rechercher les causes du décès”.
Ainsi, il faut, à l’instar du
Comité consultatif national d’éthique,
établir une distinction entre les différents types d’autopsies. L’autopsie ayant
pour but de rechercher les causes du décès peut être pratiquée même en cas
d’opposition du défunt et de sa famille et tout ce qu’une telle autopsie
requiert, c’est l’information de la famille.
Pour les prélèvements à des fins médicales, le consentement du défunt est, en
principe, présumé. En revanche, l'autopsie pratiquée à des fins scientifiques
requiert le consentement du défunt exprimé par le témoignage de la famille.
Cette exigence a entraîné d'après le rapport d’Alain Claeys, rapporteur du
projet de loi de révision des lois bioéthiques, une chute du nombre des
expertises médico-scientifiques.
Les autopsies à des fins scientifiques ne sont jamais pratiquées, mais la
raréfaction des autopsies concerne aussi les autopsies à finalités médicales.
Dans le projet de loi relatif à
la bioéthique adopté par l'Assemblée nationale, l'article L. 1232-3 est modifié.
L'article L. 1232-1 du projet précise que “le prélèvement d'organe sur une
personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins
thérapeutiques ou scientifiques. Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que
la personne n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel
prélèvement. Ce refus peut être exprimé par tout moyen, notamment par
l'inscription sur un registre national de traitement automatisé prévu à cet
effet (…). Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du
défunt, il doit s'efforcer de recueillir le témoignage de ses proches sur
celle-ci et les informe de la finalités des prélèvements envisagés”.
Est donc affirmée fermement pour toutes les autopsies, aussi bien à but
thérapeutique que scientifique, la règle selon laquelle le consentement est
présumé. L'autopsie ordonnée pour déterminer les causes du décès disparaîtrait
donc du Code de la santé publique. Elle pourrait à l’évidence, comme c’est le
cas aujourd’hui, toujours être ordonnée sans le consentement de la famille et
même sans son avis.
Des difficultés peuvent donc
surgir pour ce type d'autopsie (et pour les autres si la loi devait être votée).
La famille se révolte parfois contre cette atteinte portée au cadavre sans son
consentement.
Des parents ont ainsi tenté de
contester la législation française sur le fondement, entre autres, de la
Convention européenne des droits de l’Homme. Le Tribunal administratif de Nantes
n’a pas fait droit à ces demandes en constatant, le 6 janvier 2000, que
l’autopsie, ayant pour but de connaître les cause du décès, réalisée sans le
consentement de la famille, ne constituait pas une atteinte à l’intégrité du
cadavre (art. 225-17 du Code pénal), ni une atteinte à l’intégrité de l’espèce
humaine et qu’elle ne pouvait être regardée comme un traitement inhumain et
dégradant (art. 3 CEDH).
Une telle question pourrait être
éventuellement posée à la Cour européenne. Il reste que l'autopsie pratiquée
dans le but de rechercher les causes du décès a, à l'évidence, un but légitime
et respecte le rapport de proportionnalité exigé par la Cour européenne. Ainsi
le régime de l’autopsie n'était-il pas mis en accusation dans l'affaire
Pannullo et Forte. Ce qui était principalement en cause dans l’arrêt
Pannullo et Forte c’est la durée mise pour restituer le corps.
B.- La restitution du corps à la
famille
L’hôpital est devenu le lieu
ordinaire de la mort. Par conséquent, le droit hospitalier précise les modalités
de la restitution du corps à la famille. Les proches doivent d’abord être averti
de l’aggravation de l’état du malade et de son décès. Le corps est déposé à la
chambre mortuaire,
sorte de chambre froide spécialement aménagée, où il peut être présenté aux
familles. L’existence de ces chambres permet aux familles de disposer du temps
nécessaire pour organiser les obsèques. Le Code général des collectivités
territoriales régit les soins à apporter au corps ainsi que les modes de
transport.
Quand le corps du malade n’a pas été réclamé dans un délai de dix jours, il est
inhumé par les soins de l’hôpital.
L’établissement médical doit garantir le respect dû au mort et le respect dû au
cadavre.
L’acte de décès est, quant à
lui, dressé par l’officier d’état civil.
La déclaration de la mort à ce dernier doit être faite dans les vingt-quatre
heures. L’inhumation ne peut être faite sans autorisation donnée par l’officier
d’état civil.
Ce dernier ne pourra la délivrer que sur certificat d’un médecin constatant le
décès.
Le permis d’inhumer précise le jour et l’heure à partir duquel l’opération peut
avoir lieu, un délai de vingt-quatre heures devant être respecté entre le moment
du décès et l’inhumation.
En cas de mort violente et
suspecte, la situation est un peu différente. Le médecin, pour dresser le
certificat de décès, doit procéder à un examen minutieux et détaillé du corps.
Il doit déterminer s'il existe ou non un obstacle médico-légal à l'inhumation.
S'il n'y en a pas, l'officier d'état civil pourra délivrer le permis d'inhumer.
En cas d'obstacle, l'autorité
judiciaire doit être informée.
Dans l’affaire Pannullo et Forte, le texte de droit interne pertinent
était l’article 74 du Code de procédure pénale qui précise qu'en cas de
découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la
cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire, qui en est
avisé, en informe immédiatement le Procureur de la république. Ce dernier se
transporte sur les lieux et procède aux premières consultations.
Le Procureur de la république peut aussi requérir information pour les
recherches des causes de la mort. Il s’agit là d’une procédure dérogatoire de
droit commun qui ne met pas en mouvement l’action publique et n’admet pas la
constitution de partie civile.
Cette information a pour seul but de connaître les causes de la mort et le
magistrat instructeur n'est donc pas saisi de l'ensemble des faits. Le juge
d'instruction peut, par commission rogatoire, déléguer un officier de police
judiciaire pour accomplir les diligences tendant à élucider les causes de la
mort.
L’article 74 du Code de
procédure pénale ne s’applique qu’en cas de mort suspecte. Il s’agit d’une mort
qui ne paraît pas naturelle, n’est pas à l’évidence de nature criminelle et
semble susceptible de receler les éléments d’un crime ou d’un délit. Tel est le
cas par exemple des suicides suspects, des intoxications douteuses et au premier
chef des accidents mortels d’origine thérapeutique comme dans l’arrêt
Pannullo et Forte. Dans ce domaine, la plainte est toujours transmise au
parquet.
Le Procureur de la République
peut sur le fondement de l’article 74 ordonner l’autopsie du cadavre. L’officier
de police judiciaire fait alors transporter le corps à l’Institut médico-légal.
Une fois ces opérations
réalisées et si l'enquête a permis d'établir que la mort procède d'une cause
naturelle ou qu'il s'agit d'une mort violente survenue dans des circonstances
qui ne permettent pas de retenir une faute imputable à un tiers, le Procureur
peut autoriser l’officier d’état civil à procéder à l’inhumation.
En l’espèce, ce n’était pas le
dispositif légal lui-même qui était contesté mais la longueur des procédures. En
vertu de l’article 161 du Code de Procédure pénale, le juge a le devoir de fixer
des délais pour le dépôt des rapports d’expertises.
Si ces délais ne sont pas respectés, il a le pouvoir d’intervenir, ce qu’il
n’avait pas fait dans l'affaire soumise à la Cour européenne des droits de
l’Homme. L’inertie des experts et la mauvaise compréhension par le juge de la
matière médicale (ce qui semble inquiétant au vu des informations qui lui
avaient été transmises) ont eu des résultats tragiques. Le cadavre de la fille
des requérants a été conservé pendant des mois dans une chambre frigorifique.
Dans l'affaire Pannullo et
Forte, la Cour européenne sanctionne des dysfonctionnements spécifiques,
elle ne remet pas en cause le régime de l’expertise pénale. Tout au plus
exige-t-elle une diligence accrue des juges d'instruction dans ce domaine.
L'arrêt de la Cour européenne est, en revanche, très novateur s’agissant de
l’étendue du droit au respect de la vie familiale.
II.- L’extension du champ
d’application de l’article 8 : la Convention européenne protectrice de la
sépulture
La protection du cadavre a
suscité un contentieux restreint devant les organes européens, contentieux qui
concerne en très grande partie la France. En effet, une recherche Hudoc
sur le site de la Cour européenne des droits de l’Homme avec les entrées “cadavre”
ou “sépulture” permet de trouver quelques rares décisions, dont une
grande majorité concernent la France.
L'affaire Pannullo et Forte
concernait un aspect spécifique de ce contentieux. Il était relatif au droit des
familles sur les cadavres et non à la liberté individuelle en matière de
funérailles.
S’agissant des libertés
fondamentales, il est nécessaire de faire état de la liberté reconnue en France
d’organiser ses funérailles, liberté qui doit toutefois s’exercer dans le cadre
du respect de l’ordre public.
La loi du 15 novembre 1887
précise que tout majeur ou mineur en état de tester peut régler les conditions
de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil et religieux
à leur donner et le mode de sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de
veiller sur l’exécution de sa volonté.
Le droit au respect de ses
funérailles porte sur le mode d’inhumation (choix du cimetière), sur le sort du
cadavre après la mort (incinération, enterrement...) et également sur le souhait
d’être enterré avec telle ou telle personne. Ceux qui restent respectent la
volonté émise par anticipation avant la mort. Cependant, la liberté de la
personne est loin d'être absolue. En effet, la sépulture n'est pas seulement un
droit, elle est une obligation. Le choix du mode de sépulture est limité :
inhumation, immersion pour les décès en mer, encore que cette pratique ait en
grande partie disparu, ou crémation, mais la légalité des autres modes de
sépulture, non prévus par le Code des collectivités territoriales, semble
douteuse. L'exigence d'une sépulture est, en outre, d'ordre public.
S’agissant de la liberté d’une
personne d’organiser ses funérailles, la Commission européenne avait déjà eu
l’occasion de préciser dans une décision X. c/RFA, le 10 mars 1981,
que le souhait d’une personne de faire disperser ses cendres dans son jardin est
si intimement lié à la vie privée qu’il entre dans le champ d’application de
l’article 8 CEDH. Pour la Commission, cependant, des considérations d’intérêt
public peuvent justifier la réglementation de l’inhumation, à condition de ne
pas priver l’individu de tout choix personnel. Comme en l’espèce le requérant
disposait d’un choix quant aux modalités de ses funérailles, il n’y avait pas
violation de l’article 8.
Le respect dû aux morts est un
principe fondamental. Il prolonge le respect dû à la personne humaine.
Il convient donc de voir ici
quels sont les droits de la famille sur la personne du défunt pour montrer que
l’arrêt Pannullo et Forte apporte un fondement neuf à ces droits
A.- Les droits de la famille sur
le cadavre
La nature juridique du cadavre
(1) est déterminante pour préciser quels sont les droits de la famille sur
celui-ci (2).
1.- La nature juridique du
cadavre
Le cadavre s'entend de la
dépouille mortelle, des restes humains, des ossements et des cendres de la
personne.
Pendant très longtemps, on s’est
demandé en droit civil quelle était la nature juridique du cadavre et s’il avait
des droits. Certains auteurs, comme Demogue, ont voulu reconnaître au cadavre
une demi-personnalité juridique.
Le cadavre serait à mi-chemin entre l’être humain et la chose. On a aussi
proposé de donner au cadavre le statut de personne inanimée, statut temporaire
qui durerait cinq ans.
Le droit pénal n'a pas pris
clairement position sur le sujet. Les articles 225-17
et suivants, qui concernent l’intégrité du cadavre figurent dans le titre II du
Code pénal (“ Des atteintes à la personne humaine ”) et plus précisément dans le
Chapitre V de ce titre II (“ Des atteintes à la dignité de la personne ”).
L'atteinte à l'intégrité du cadavre est un délit nouveau, créé par le Nouveau
Code pénal. Ce délit est distinct de la traditionnelle profanation de sépulture.
Cette nouvelle disposition va plutôt dans le sens d'une personnification du
cadavre.
Auparavant, la loi ne s'intéressait en effet qu'à la sépulture, objet de droit.
Le cadavre n'était donc protégé que de manière indirecte.
En faveur de la personnification
du cadavre, on peut aussi citer un arrêt du Conseil d'Etat du 2 juillet 1993,
l'arrêt Milhaud, dans lequel le Conseil affirme que le patient décédé
reste, pour le médecin, une personne humaine.
Selon un auteur, d'une manière
générale, “la jurisprudence répugne à traiter la dépouille comme un objet, du
moins tant qu'il s'agit d'une mort relativement récente”.
Mais progressivement a été
consacrée l’idée que le cadavre est une chose. Il n’existe en droit civil que
deux catégories dans lesquelles le cadavre pouvait être rangé, soit il était un
être humain sujet de droit, soit il était un bien meuble, objet de droit. Or, le
mort n’est plus un sujet de droit. Selon l’expression souvent reprise de Planiol,
“les morts ne sont plus des personnes ; ils ne sont rien”.
Les dépouilles mortelles, les cendres doivent donc être considéré comme des
objets.
Historiquement d’ailleurs, comme
le souligne M. Labbée dans sa thèse,
la loi des XII tables permettait au créancier impayé de saisir le cadavre du
défunt. En cas de pluralité de créanciers, chacun pouvait emporter un morceau.
En Egypte ancienne, il était fréquent de mettre en gage un cadavre. Au Moyen-Âge
existait la procédure de rétention et de saisie de cadavre.
Plus récemment, une décision du
tribunal de la Seine de 1932
montre que le cadavre peut être considéré comme une chose. Un entrepreneur de
pompes funèbres refusait de rendre le cadavre aux héritiers, qui contestaient la
facture. Le tribunal ordonne la restitution, non sur le fondement du caractère
insaisissable du cadavre, mais sur celui du respect de l’ordre public et de la
bonne foi. La Cour de cassation a elle aussi considéré que le cadavre était une
chose. Elle a consacré la possibilité de l’existence d’un contrat de dépôt sur
un cadavre. Dans une affaire soumise à la Cour de cassation le 17 juillet 1991,
le corps d’une personne décédée dans un hôpital privé s’était trouvé, après
quatre jours sans conservation, dans un état de décomposition avancée au moment
de la mise en bière en présence de ses proches. Ces derniers invoquaient la
réglementation hospitalière imposant le dépôt des corps dans une chambre
mortuaire et l’obligation pour l’hôpital de procéder à une inhumation au bout de
dix jours. La Cour de cassation déduit de cette réglementation que l’hôpital en
tant que dépositaire est tenu vis-à-vis de la famille et des proches de veiller
à la conservation des corps pendant une durée pouvant atteindre dix jours. Par
conséquent il y avait une faute de l’hôpital du fait de cette décomposition
constatée au bout de quatre jours. Certains auteurs, comme M. Gautier
ont été choqués par cette décision qui désacralisait le cadavre.
En effet, si le cadavre est une
chose,
il est une chose sacrée, hors commerce, qui ne peut faire l'objet d'un contrat.
Il a une valeur exclusivement morale. Par conséquent, il est en principe
indisponible, encore qu’il puisse avoir une valeur pécuniaire après un certain
temps (momies…). Quels sont donc les droits que la famille exerce sur cette
chose ?
2.- Les droits de la famille sur
le cadavre
La famille peut exercer
différents droits s’agissant du cadavre. Au delà de l’objet lui même (la
dépouille ou les cendres), elle a le droit de défendre l’image du défunt. Ce
droit appartenant à la famille a été consacré, pour la première fois, par le
Tribunal de la seine le 16 juin 1858,
dans une affaire concernant l'actrice Rachel. Le Tribunal prend soin de préciser
que nul ne peut sans le consentement formel de la famille reproduire ou livrer à
la publicité les traits d’une personne sur son lit de mort. Ce droit est absolu
et a son principe dans le respect que commande la douleur des familles.
Plus récemment, la Chambre
criminelle de la Cour de cassation a aussi constaté une atteinte à l’intimité de
la vie privée prévue par les articles 226-1 et 6 du Code pénal s’agissant de la
dépouille mortelle de François Mitterrand. La Cour de cassation considère que le
respect de la vie privée est dû à la personne humaine qu’elle soit morte ou
vivante.
L’incrimination prévue aux
articles précités ne concernait que les lieux privés, elle ne s’appliquait donc
pas aux photos du préfet Erignac, photos prises après son assassinat alors qu'il
gisait sur la chaussée et ensuite publiées. La Cour d’appel de Paris le 6
février 1998 affirme qu’elle protège non le défunt mais les sentiments
d’affection et la vie privée de la famille.
La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre cet arrêt, le rejette en se
fondant sur le fait que cette image était attentatoire à la dignité de la
personne humaine.
Les héritiers du défunt sont
aussi chargés de défendre la mémoire des morts contre les diffamations ou les
injures. Il n'y a diffamation ou injure contre la mémoire des morts que dans le
cas où il y a eu une intention de porter atteinte à la considération des
héritiers, époux ou légataires universels.
Le défunt n'est donc pas titulaire d'un “droit à l'honneur”.
Ces décisions et ces
dispositions législatives garantissent le respect dû aux morts, mais les
sentiments de la famille sont aussi pris en compte et c’est elle qui agit. Pour
certains auteurs, il existerait un droit du cadavre à la protection de
l’intégrité de son image. Mais cette idée va à l’encontre du principe selon
lequel le défunt n’a pas de personnalité juridique.
On admet aussi que la famille a
sur le cadavre (sur la chose : dépouille ou cendres) un droit de copropriété
familial assez particulier. Le cadavre a une valeur morale considérable pour la
famille et une valeur pécuniaire presque nulle. Il appartient au juge en cas de
désaccord entre les héritiers de procéder à l’attribution de cet objet. En
raison de son caractère spécifique, il ne peut pas être soumis aux règles
habituelles du partage.
La question qui a été posée le
plus fréquemment aux juges a été de savoir comment régler, en l’absence de
testament, la dévolution du cadavre.
Si le cadavre était un bien classique, il suivrait les règles de dévolution
successorale traditionnelles.
Mais les juges ont adopté, pour
le cadavre, un régime très proche de celui des souvenirs de famille,
en faisant référence à une copropriété familiale.
La notion de copropriété
familiale
a été admise depuis longtemps par le droit belge, en particulier par un arrêt de
la Cour de cassation du 2 novembre 1868.
En droit interne, on cite souvent un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux de
1891 qui rappelle que le corps mort d’un individu appartient à la famille de
celui-ci comme n’importe quel objet de la succession.
Ce principe est repris dans une décision du Tribunal de grande instance de Lille
du 5 décembre 1996, qui précise que la dépouille mortelle d’un individu fait
l’objet d’une copropriété familiale.
Le Tribunal fait référence à l’article 16-2 du Code civil
appliquant ainsi la protection du corps humain, prévue par le Code civil, au
cadavre.
Quand le défunt n’a rien exprimé
concernant ses funérailles, les juges règlent le conflit en se tournant
généralement vers la personne qui est, selon eux, la mieux placée pour
déterminer ce qu’auraient été les dernières volontés du défunt.
Il n’y a pas d’ordre préétabli, mais le conjoint vient généralement en premier
et est préféré aux frères et aux soeurs. La concubine peut avoir son mot à dire
si le concubinage était stable.
Les père et mère sont généralement consultés et ils organisent les funérailles
de leur enfant quand celui-ci n’a pas d’autre famille.
Il arrive que les père et mère s’opposent comme dans une affaire soumise au
Tribunal de grande instance de Lille le 25 janvier 2001.
La jurisprudence consacre un principe fondamental dans ce domaine : celui de la
stabilité de la sépulture
Des différends récents
concernent l’urne funéraire. Celle-ci est soumise à un régime beaucoup moins
strict que les dépouilles mortelles puisqu’il est seulement précisé dans le Code
général des collectivités territoriales que l’urne peut être placée dans un
columbarium ou remise à la famille.
L'urne n'est donc pas vraiment protégée quand elle se trouve en dehors du
cimetière,
ce qui peut sembler choquant.
Elle peut être déplacée au gré des changements d’humeur de la personne à qui
elle est remise.
Le Tribunal de grande instance
de Lille, le 23 septembre 1997, affirme que l’urne funéraire, à l’instar de la
dépouille mortelle,
fait l’objet d’un droit de copropriété familiale, inviolable et sacré.
L’épouse qui a organisé les funérailles, même si elle vivait séparée de son
époux, a donc la possibilité d’emporter l’urne pour la garder chez elle et ce,
même si elle prive les frères et soeurs de la possibilité de venir se recueillir
dans le columbarium. La copropriété familiale va jusqu’au partage des cendres si
le défunt l’a souhaité.
Les tribunaux internes ne sont
désormais plus les seuls à être saisis de questions touchant aux funérailles et
à la sépulture. Les requérants, dans l’affaire Pannullo et Forte,
s’étaient tournés vers la Cour européenne.
B. Le fondement européen de la
protection de la sépulture : le droit au respect de la vie familiale
On peut s'intéresser aux
fondements qui ont été rejetés (1) avant d'étudier le fondement retenu (2) par
la Cour européenne pour rendre sa décision.
1.- Les fondements rejetés
Si l’on suivait la jurisprudence
française en matière de dépouille mortelle, la Cour européenne aurait dû placer
le débat sur le fondement de l’article 1 protocole 1, le droit de chacun au
respect de ses biens. En l’espèce on aurait pu aller jusqu'à considérer qu’il y
avait atteinte à la substance du droit de propriété, puisque l’atteinte même
temporaire avait empêché les requérants d’utiliser les biens comme ils le
voulaient et conformément aux usages. Cette solution aurait sans doute semblé
choquante.
La Cour européenne a refusé,
comme cela a été vu antérieurement, d'examiner les arguments fondés sur
l'article 9 de la Convention européenne.
Pourtant, la liberté religieuse joue sans doute un rôle important en matière de
sépulture. La sépulture correspond à l'idée de la nécessité d'un retour du corps
à la terre. Le monde des morts doit être séparé de celui des vivants. Dans les
grandes religions monothéistes, l'accent est souvent mis sur la nécessité de
donner une sépulture aux morts. Le judaïsme exige ainsi le respect de
l'intégrité du corps humain et l'ensevelissement du cadavre.
Pour les musulmans, le respect de la dépouille mortelle est un des devoirs les
plus fondamentaux de la religion et l'ensevelissement est un rite obligatoire.
Le christianisme imposa pendant longtemps la nécessité d'un ensevelissement du
cadavre. Le Pape Léon XIII condamna la pratique de la crémation le 19 mai 1886.
Ainsi, les personnes désirant se faire incinérer se trouvaient privées de
sépulture ecclésiastique. C'est le pape Paul VI qui leva l'interdiction en 1963.
L'Eglise catholique admet l'incinération mais elle garde toujours une préférence
pour l'inhumation. L'atteinte à l'intégrité du cadavre n'est, en principe, pas
interdite. Les prélèvements et les autopsies sont autorisés car la résurrection
concerne le corps spirituel et non le corps terrestre. Mais, toute famille
chrétienne doit pouvoir organiser des funérailles. L'enterrement du mort, après
la cérémonie religieuse, est fondamental pour les catholiques et, plus
généralement, pour l’ensemble des chrétiens. M. Pannullo et Mme Forte pouvaient
donc légitimement invoquer l’article 9 de la Convention.
Mais c'est sur le fondement du
droit au respect de la vie familiale que la Cour européenne condamne la France.
2.- Le fondement retenu : le
droit au respect de la vie familiale
La Cour européenne constate la
violation de l’article 8 dans l’affaire Pannullo et Forte. Si la solution
à laquelle elle aboutit est incontestable, son raisonnement manque néanmoins de
netteté. La Cour européenne ne prend pas le temps de préciser si, ici, il est
question de la vie privée ou de la vie familiale. Ce n’est qu’au détour d’une
phrase qu’elle indique qu’est en cause, dans cette affaire, le respect effectif
de la vie familiale. Même si cette affirmation semble tomber sous le sens, on
peut regretter, malgré tout, ces temps anciens où la Cour européenne expliquait
longuement et de manière très pédagogique lequel des droits garantis par
l’article 8 s’appliquait et pourquoi. Sans doute ne s’agit-il là que d’une
décision de section, mais tout de même, la solution consacre une nouvelle
extension du champ d’application de l’article 8, nouvelle extension qui aurait
pu être expliquée.
De plus, et pour continuer sur
la forme de l’arrêt, on ne saisit pas très bien pourquoi la Cour européenne
rappelle l’existence d’obligations positives sur le fondement de l’article 8.
Elle montre que le régime des obligations positives se rapproche de celui des
ingérences, mais elle semble finalement considérer qu’il y a en l’espèce une
ingérence. Assiste t-on progressivement à la convergence, tant souhaité par les
auteurs, entre obligations positives et ingérences
ou s’agit-il seulement d’approximations contestables de la part de la Cour ? La
Cour européenne aurait sans doute gagné à faire connaître plus clairement sa
position.
L'arrêt Pannullo et Forte
n’annonce sans doute pas une modification des méthodes européennes, mais il
consacre l'extension du champ d'application de la Convention. Le droit au
respect de la vie familiale implique le droit de pouvoir enterrer son enfant. La
position adoptée par la Cour européenne doit être approuvée. Le travail de deuil
d’un être cher ne peut véritablement commencer qu’à partir de l'organisation
sociale des funérailles. Ce travail implique une renonciation et la vue du
cadavre est essentielle dans la prise en compte de la réalité. Une mort sans
cadavre et sans sépulture rend à l'évidence le deuil plus douloureux.
Pour accepter la mort, renoncer au défunt et comprendre le sens de la
séparation, un support matériel est indispensable, c’est-à-dire une dépouille
mortelle et une sépulture. Aussi, la condamnation de la France par la Cour
européenne était-elle prévisible et ne choquera-t-elle sans doute personne.
On peut se demander si
l’invocation de la Convention européenne ne risque pas de venir appuyer des
demandes réellement pathologiques, comme celle de ces deux enfants qui voulaient
garder le corps de leur mère cryogénisé
dans le sous-sol de leur villa, ce que le Préfet avait refusé. Le Tribunal
administratif de Saint-Denis de la Réunion, le 21 octobre 1999,
et la Cour administrative d’appel de Bordeaux, le 29 mai 2000,
ont considéré que ce refus était justifié en se fondant sur l’article L. 2223-9
du Code général des collectivités territoriales.
La cryogénisation n’est pas un mode d’inhumation et, dans une propriété privée,
seule l’inhumation est autorisée par le Code des collectivités territoriales.
Les requérants ont dit vouloir porter le débat devant la Cour européenne des
droits de l’Homme. Il serait tout de même très surprenant que le droit au
respect de la vie familiale englobe le droit de continuer à vivre près du
cadavre d’une mère, d’un père ou d’un enfant.
Le droit fondamental de l’Homme
à assurer la sépulture de ses proches, fondé sur l’article 8, doit rester dans
les limites fixées par la Cour européenne. En définitive, ce que M. Pannullo et
Mme Forte demandaient c’est seulement de pouvoir enterrer leur mort. Cette
affaire est l’occasion pour la Cour européenne d’un retour aux sources des
droits fondamentaux. On peut désormais imaginer Antigone saisissant la Cour
européenne pour réclamer le droit de donner une sépulture décente à son frère
Polynice.
M. Paul
Tavernier
Merci, Mlle Debet pour cet
exposé très intéressant et très riche. Malheureusement nous devons passer
directement aux deux derniers exposés, parce qu’il faut non seulement respecter
la liberté d’expression de l’auditoire, mais il faut aussi respecter celle des
intervenants.
Je donne la parole immédiatement
à Patrice Rolland que nous connaissons déjà tous puisqu’il est déjà intervenu à
plusieurs reprises dans les colloques du CREDHO. Il va nous parler non pas d’un
arrêt, mais d’une décision de recevabilité. Nous avons introduit une innovation
dans les colloques du CREDHO et nous ne nous sommes pas limités aux arrêts. Nous
avons retenu quelques décisions particulièrement intéressantes.
Civ. 2ème, 17 juillet 1991, Bull. civ. II, n° 233, p.
122 ; RTD civ. 1992. 412. Voir cependant, Amiens, 26 novembre 1996,
LPA 1997, n° 83, p. 34. Dans le domaine pénal, la Cour d’appel
d’Amiens a refusé, dans une décision rendue le 26 novembre 1996, de
qualifier de vol des prélèvements médicaux d’organes non autorisés par les
parents. Selon elle, l'indisponibilité du corps humain faisait obstacle à
toute propriété ou appropriation du corps humain.
|