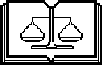|
|
AFSHARI
(Reza),
“An Essay on Islamic Cultural Relativism in the Discourse of Human Rights”
Human Rights Quarterly, vol.16, n°2, May 1994, pp. 235-276.
L’auteur, exilé iranien,
refusant d’être “banni” de sa propre culture en raison de son sécularisme,
ouvre son article, tenant autant du papier d’humeur que de la contribution
universitaire, sur l’évocation de geôliers iraniens violant une jeune
fille avant de l’exécuter pour qu’un “ennemi de l’Islam” ne périsse vierge
(les vierges étant censées aller au paradis). M. Afshari n’en réfute pas
moins l’échec allégué de la laïcisation et le soi-disant triomphe de la
ré-islamisation en Iran, qui ne doit son succès qu’à la coercition.
L’auteur s’affirme convaincu que le sécularisme, phénomène dominant de la
civilisation contemporaine, vit toujours car la société civile a refusé de
se fondre dans un moule totalitaire. De nombreux canons et usages naguère
dénoncés comme impies réapparaissent, y compris certaines dispositions de
la loi sur la protection de la famille promulguée par le Shah en 1967 et
1975. Si le régime impérial était un mauvais mélange de despotisme
oriental et de modernisation, le régime de l’Ayatollah est un amalgame
précaire de tradition et de modernisation. Ses tentatives pour transformer
l’Islam en idéologie politique se sont paradoxalement soldées par une
sécularisation croissante de son discours. De même, à l’échelle régionale
la majorité de la population n’est pas favorable à une ré-islamisation,
les islamistes n’étant soutenus que parce qu’ils dénoncent des dictatures
corrompues.
Comparant la critique
islamiste de l’universalité des droits de l’Homme à la critique marxiste
du temps de la guerre froide, l’auteur fait sien le “ pluralisme culturel
” et le “ relativisme éthique ” de certains Occidentaux (Alison Dundes
Renteln, Richard Falk, Rhoda Howard) qu’il juge compatible avec
l’universalité des droits de l’Homme. Critiquant la compréhension
néoféministe pour le port du hijeb, M. Afshari rappelle que
celui-ci est imposé aux femmes iraniennes et que le discours (au sens
foucaldien) sur la dignité et l’authenticité est réactionnaire. Affirmant
que les islamistes n’ont, au mieux, qu’une conception instrumentaliste de
la démocratie (comme les nassériens et les baasistes avant eux), il doute
sérieusement de la possibilité de rendre la Chariaâ compatible avec
la Déclaration universelle des droits de l’Homme, malgré les efforts des
“néotraditionnalistes” insistant sur l’ijtihad. Finalement, M.
Afshari plaide pour la laïcité et l’application stricte de la Déclaration
universelle.
Ph. G.
|
|

|
|
BACCOUCHE (Néji),
“Les droits de l’Homme à travers la Déclaration des droits de l’Homme de
l’Organisation de la conférence islamique”, Cahiers de l’Institut du
droit européen et des droits de l’Homme (Montpellier), n°5, 1996,
pp.13-32.
L’auteur, professeur à la
Faculté de droit de Sfax procède à une lecture de la “Déclaration des
droits de l’Homme en Islam” adoptée au Caire le 5 août 1990 par la
conférence des ministres des affaires étrangères de l’O.C.I. Dès le début
on est surpris par l’affirmation de l’auteur selon laquelle l’O.C.I “ne
peut procéder à la création d’instruments régionaux à contenu islamique”.
Sur quelle base repose une telle affirmation et comment se justifie
l’adoption de la Déclaration du Caire qui est un instrument international
sans toutefois avoir le caractère contraignant d’un traité et qui de
surcroît revêt un caractère islamique dès lors qu’il se réclame des
principes et des règles de l’Islam?
L’objectif de l’auteur est
de s’interroger sur le fait de savoir dans quelle mesure les droits
fondamentaux consacrés au plan universel ont inspiré cette déclaration ou
bien si celle-ci exprime une conception islamique des droits de l’Homme.
Si elle n’institue pas d’organes de protection des droits de l’Homme, la
Déclaration souligne l’adhésion des États musulmans à “la Charte des
Nations-Unies et aux droits fondamentaux de l’Homme”. Mais pour Néji
Baccouche “la Déclaration du Caire ne constitue pas une relecture de
l’Islam. Elle nous paraît plus un instrument de défense d’une identité
religieuse et culturelle qu’une véritable déclaration de reconnaissance de
droits spécifiques”. La démarche de l’auteur suit un cheminement logique
en trois parties correspondant à trois constats: l’Islam inspire les
droits de l’Homme (I), la Chariaâ transcende les droits de l’Homme
(II), la Déclaration du Caire n’est pas une relecture de l’Islam (III).
La Déclaration exprime la
volonté de reconnaître un ensemble de droits mais dans le cadre de la
Chariaâ. Si le principe d’égalité est mentionné ce n’est pas en termes
de droits mais de devoirs et de responsabilité. Ce qui a l’avantage
d’éviter d’aborder la question de l’égalité des sexes. En fait, si “la
femme est l’égale de l’homme en dignité, elle a ses propres droits et ses
propres devoirs” (article 1er) ce qui permet de situer cette déclaration
dans la stricte fidélité aux lois islamiques qui accordent un statut
particulier à la femme. Le droit à la vie et à l’intégrité est reconnu
dans la limites de la Chariaâ qui autorise notamment la
flagellation ou la mutilation de la main du voleur (article 2 et 3).
L’exercice de nombreux droits énoncés dans la Déclaration - droit d’asile,
droits économiques et sociaux ou droits politiques - est conditionné par
le respect des règles de la Chariaâ qui parfois constituent de
véritables freins. Ceci fait dire à l’auteur que loin de s’inscrire dans
une perspective de modernisation et d’adaptation de la Chariaâ,
cette Déclaration “s’est limitée à rappeler le cadre islamique inviolable
pour la plupart des droits qu’elle a consacré”. Cette absence d’Ijtihad
(innovation) des rédacteurs de la Déclaration présente l’inconvénient de
conditionner la jouissance des droits et des libertés au respect de la
Chariaâ pour laquelle de nombreux juristes musulmans sont en désaccord
sur le nombre de normes qui la composent.
Un autre facteur
d’incertitude réside dans le problème de l’interprétation des règles de la
Chariaâ dont dépendrait en fin de compte le constat de conformité
ou non des droits que l’on cherche à protéger. Ainsi à défaut d’être un
texte de promotion significative des droits de l’Homme, la Déclaration du
Caire s’inscrirait selon l’auteur dans “une perspective d’affirmation
d’une identité menacée d’autant plus que les régimes politiques des pays
musulmans sont vulnérables sur deux préalables que supposent les droits de
l’Homme: l’État de droit et la légitimité démocratique”. Cette approche
fondamentalement conservatrice qui illustre l’influence des
traditionalistes au sein de l’O.C.I. (Arabie saoudite) s’avère en fin de
compte contre productive se limitant à réaffirmer la primauté de la
Chariaâ - ce qui n’est pas une innovation en soi - et surtout situant
le standard des droits proclamés en deçà de ce qui est reconnu par les
constitutions de certains pays musulmans que l’on ne peut considérer comme
des modèles de démocratie (Tunisie et Syrie notamment).
A. B.
|
|

|
|
KTISTAKIS (Yannis),
La loi sacrée
de l’Islam et les citoyens grecs musulmans,
Athènes/Thessalonique, Ed. Sakkloulas, 2006, 198 p.
L’ouvrage de M.
Yannis Ktisatkis, intitulé en grec « Ιερός
νόμος του Ισλάμ και μουσουλμάνοι έλληνες πολίτες »
que l’on pourrait traduire en français par « La loi sacrée de
l’Islam et les citoyens grecs musulmans », est sorti en Grèce au
cours de l’année 2006 aux éditions juridiques grecques Sakkoulas et
devrait être prochainement traduit et édité en langue française.
Ce livre a la
particularité d’aborder un sujet pas ou peu connu, du moins par les
juristes français. En effet, M. Ktisakis traite dans ce livre de
l’application de la sharia vis-à-vis des citoyens de
nationalité grecque et de confession musulmane. A notre
connaissance, peu d’ouvrages parlent de cette situation d’un point
de vue juridique, la minorité musulmane de Grèce ayant fait l’objet
plutôt d’études sociologiques et historiques.
Le livre que nous
présentons ici a donc un intérêt à plusieurs titres. En effet, en
premier lieu, s’il semble s’inscrire dans un cadre purement interne,
à savoir, l’application ou non d’un droit spécifique à l’égard d’une
minorité donnée sur le territoire national grec, il peut en fait
être vu aussi comme un cas spécifique intéressant du point de vue du
droit international puisqu’il semblerait que ce soit la seule
application tolérée du droit musulman réglant les questions d’ordre
familial et d’héritage pouvant surgir entre coreligionnaires sur le
territoire européen. La Grèce, membre de l’Union européenne,
laisserait un ou des membres d’une minorité de nationalité grecque
mais de religion musulmane de régler tout litige, dirons-nous
personnel (droit de la famille : mariage, divorce…droit de
succession) avec une personne de religion musulmane selon les
dispositions religieuses de droit musulman. Il faut préciser que
l’exemple de l’île de Mayotte présente aussi cette caractéristique
mais l’auteur précise que l’application sur cette île tombe en
désuétude de même que dans le cas de Chypre qui avait des
dispositions de droit musulman à l’égard de la communauté turque
musulmane. Ainsi, la Sharia s’applique donc sur le territoire
national grec et donc sur une partie du territoire de l’Union
européenne.
Deuxièmement, cette
possibilité est laissée alors que la Grèce a, pour l’ensemble de ses
citoyens et ce quelque soit leur croyance, religion personnelle
(orthodoxe, musulmane, catholique, protestante….) un droit civil
propre (Code civil de 1946). Si la Grèce n’est pas un pays laïc,
elle n’applique pas non plus un droit religieux spécifique aux
orthodoxes qui constituent la majorité de sa population. Si les
mariages orthodoxes sont reconnus par les autorités publiques
grecques et que, selon le code civil lui-même le mariage peut-être
célébré religieusement par un prêtre de l’Eglise orthodoxe orientale
ou/et par un officiant d’un autre dogme ou/et religion reconnu par
la Grèce, le mariage civil a aussi fait son apparition et par,
ailleurs, à notre connaissance, le divorce et autres sujets de droit
de la famille et les questions d’héritage ont toujours été régis par
le droit civil grec et non selon le droit canonique orthodoxe grec.
Se pose alors la question de l’égalité du citoyen devant la loi,
puisque les citoyens grecs musulmans pourraient choisir entre le
droit civil grec et le droit musulman alors que les citoyens grecs
non musulmans ne pourraient se référer qu’à un seul type de droit.
Troisièmement, le
règlement de conflits et les décisions de droit musulman se fait par
le biais d’une institution musulmane appelée « Mufti » contrôlée par
le tribunal de première instance de la même circonscription. Mais là
encore, cette situation réserve encore une particularité puisqu’en
droit musulman le juge n’est pas le Mufti qui n’est que l’interprète
du droit musulman, mais le cadi. Jusqu’en 1913, nous dit l’auteur,
leurs deux rôles étaient séparés puis le Mufti s’est transformé en
juge religieux d’après la loi grecque 2345/1920. La Grèce a donc,
tout en voulant respecter le droit musulman et ses sujets, attribué
plus de compétences que n’en avait le Mufti originairement.
L’auteur a divisé
son Livre en trois chapitres à savoir l’applicabilité dans l’ordre
interne grec de la Sharia dans un premier chapitre, puis la
question de la mauvaise interprétation de l’obligation
internationale de la Grèce à l’égard de la minorité grecque et
enfin, les limites de cette applicabilité au regard de la protection
actuelle des droits de l’Homme.
Les bases juridiques
de droit grec dont est issue l’applicabilité sur le territoire grec
de la Sharia sont les lois n° 147/1914 « Περί
της εν ταις προσαρτωμέναις χώραις εφαρμοστέας νομοθεσίας και της
δικαστικής αυτών οργανώσεως »
qui concernaient, suite à l’agrandissement du territoire national
grec vers le Nord, les régions nouvellement intégrées qui
comportaient une forte population locale de confession musulmane
mais aussi apparemment de confession juive puisque cette loi
disposait que ces personnes en ce qui concerne le mariage et les
liens de parenté étaient soumises à la loi de leur religion. La Code
civil de 1946 n’abrogea pas cette disposition entièrement, elle ne
fut abrogée qu’à l’égard des Juifs par conséquent on peut penser
qu’elle est toujours en vigueur vis-à-vis des Musulmans puisque
l’article 6 de la loi introductive du nouveau code civil ne parle
que de l’abrogation de la loi vis-à-vis des Israélites. De plus,
l’article 8 de la loi introductive du code de procédure civile
conserve en vigueur l’article 10 de la loi 2345/1920 qui établit la
compétence du Mufti en tant que juge religieux. La loi 1920/1991
constitue avec la loi n°147/ 1914 les fondements juridiques de
l’application de la Sharia en Grèce.
En ce qui concerne
l’institution du Mufti, celui-ci est désigné par un décret
présidentiel après proposition du Ministre de l’Education nationale
et des Affaires religieuses. Pour être Mufti, il faut être musulman
de citoyenneté grecque, être diplômé de l’Ecole supérieure de
théologie islamique de Grèce ou/et de l’étranger ou/et avoir le
diplôme Itzmet Vamé ou/et avoir été Imam pendant au moins 10 ans et
se distinguer par sa morale et sa formation théologique. Les Muftis
sont donc des fonctionnaires de l’Etat grec et ils peuvent être
licenciés par un décret présidentiel.
Les trois tribunaux
religieux appelés aussi « Mufteia » concernés se situent en
Thrace occidentale dans les villes de Xanthi, de Komotini et de
Didymoticho (ici il y a une représentation du Mufti et non une
Mufteia). Ces trois tribunaux rendent leurs décisions en Ottoman,
décision qui peut être traduite en langue grecque par un
particulier, traduction qui doit être validé par le tribunal
religieux lui-même pour être ensuite présentée par les intéressés
aux autorités publiques grecques. En tous état de cause, les
décisions prises par les Muftis font automatiquement l’objet d’un
contrôle par le Tribunal d’Instance grec de la même circonscription
de la Mufteia qui examine l’applicabilité et donc nous
pouvons penser de la « validité », de la « légalité » de cette
décision. Si les circonscriptions de compétences sont délimitées (en
Thrace occidentale) se pose la question de savoir si les Muftis sont
compétents pour régler des questions soulevées entre Musulmans
d’autres régions de Grèce voire même ayant un élément d’extranéité
tel que la nationalité d’un autre pays. Si cette question semble
être réglée par les textes en pratique elle n’est pas si tranchée.
Ainsi, d’après la loi, seuls les Grecs musulmans de Thrace
occidentale qui n’ont pas été considérés comme échangeables (voir
sur ce point les échanges de population survenus entre la Grèce et
la Turquie, le fait aussi qu le Mufti ne peut agir que dans sa
juridiction donc là où il se trouve (loi 1920/1991) et pour
l’instant les trois tribunaux religieux sont en Thrace ) peuvent
saisir le Mufti et se voir appliquer la Sharia, les autres
musulmans habitant en dehors de la Thrace occidentale sont soumis
comme tous les autres citoyens de Grèce aux dispositions du Code
civil. Certaines affaires présentées par l’auteur montrent que cette
question n’est pas si tranchée et que les tribunaux religieux sont
compétents même à l’égard de citoyens grecs musulmans n’habitant
plus ou/et pas en Thrace occidentale De même, en ce qui concerne la
possession de la citoyenneté grecque par les parties musulmanes en
litige, c’est une condition sine qua non. Or, les tribunaux
religieux se jugent parfois compétents pour régler des affaires
concernant des musulmans étrangers ce qui est, en principe,
contraire à la loi 1920/1991.
En réalité, la
confusion aussi vient de ce que la compétence de célébrer le mariage
est donnée au Mufti en tant qu’homme d’Eglise et non en tant que
juge, la loi 1920/1991 n’est pas claire sur ce point. Or, en tant
qu’officiant religieux, le Mufti pourrait très bien en principe
marier deux personnes musulmanes sans considération de leur
nationalité mais en tant que juge religieux grec, il n’est pas
compétent pour les questions de mariage entre deux personnes
musulmanes non grecques. Dans les deux cas, un contrôle des
autorités grecques s’effectue mais par deux entités différentes et
au regard de deux textes juridiques différents (Code civil et
Constitution grecs). Le contrôle est donc confus et l’attitude des
tribunaux religieux aussi.
L’auteur précise
ensuite le contenu de la loi musulmane et comment il s’applique par
les tribunaux religieux. Ici nous parlerons que des points qui
différent grandement avec les différentes Lois occidentales à savoir
entre autres la polygamie et la décision unilatérale de l’époux de
divorcer de sa femme (sorte de répudiation). En ce qui concerne la
polygamie, là encore sous certaines conditions et avec autorisation
du Mufti, elle serait applicable mais elle serait
inconstitutionnelle. Dans la pratique, la polygamie diminue, le
Mufti posant souvent des obstacles.
En ce qui concerne
la dissolution du mariage sur la base de la seule volonté de
l’époux, là aussi la pratique est très rare. Dans ce cas et selon le
droit musulman, l’épouse reçoit une indemnisation prévue avant le
mariage. En ce qui concerne le mariage entre mineurs, l’autorisation
pour le mariage est donnée si la situation des mineurs semble
l’exiger (grossesse de la future épouse, réputation des familles,
etc.), l’auteur présente aussi les différents modes de dissolution
du mariage et leurs effets, les empêchements au mariage, les
questions de tutelle et d’héritage entre autres.
Nous venons de voir,
que l’application de la Sharia est contenue principalement
dans deux lois internes que sont la loi n°147/1914 et la loi
1920/1991. Existent-ils des dispositions d’ordre international
auxquelles la Grèce a contracté ? L’auteur explique que le traité de
Constantinople du 2/7/1881 et la loi d’application qui en découle
ΑΛΗ’/22.6.1882
« des chefs religieux des communautés de Mahométans » abordent pour
la première fois la question de l’application de la Loi sacrée et du
fonctionnement de tribunaux religieux spécifiques mais des régions
de Larissa, Pharphale, Tricala, Volos et non de Thrace. La Cour de
cassation considère que ce traité est encore en vigueur, le Conseil
d’Etat non, il aurait été abrogé par la loi 2345/1920.
Par la suite, le
Traité d’Athènes du 14 novembre 1913 « du renforcement de la paix et
de l’amitié entre la Grèce et la Turquie » mit fin à la guerre qui
opposait les deux pays et a sauvegardé la protection de la liberté
religieuse des Musulmans des nouveaux pays/territoires. Ce traité ne
concernait que les régions de Macédoine et de l’Epire. C’est dans la
suite de ce traité que les lois n° 147/1914 et 2345/1920 ont été
prises. Il est admis que le Traité d’Athènes n’est plus en vigueur
dans son ensemble. Le Conseil d’Etat en a décidé ainsi en regardant
ensuite l’évolution internationale qu’il y a eu, la Cour de
cassation, quant à elle, pense que ce traité est toujours la base
juridique de la protection de la minorité musulmane en Grèce et de
ce traité découle l’obligation internationale de la Grèce concernant
l’application de la Sharia.
Vient ensuite la
question du Traité de Sèvres, traité du 10 août 1920. Il devait
assurer un nouveau cadre général de protection des minorités qui
vivaient sur le territoire intérieur de la Grèce alors. De nouveaux
territoires sont encore attribués à la Grèce dont la Thrace.
L’octroi de celle-ci sera définitif lors de la Conférence de
Lausanne. Le traité ne fait pas référence à l’institution du Mufti,
il ne fait qu’une brève référence à la Loi sacrée. Pour le Conseil
d’ Etat grec ce traité est encore en vigueur et la Cour de cassation
grecque le mentionne comme un acte international qui impose
l’application de la Sharia. Nous ne rentrons pas ici dans la
question de savoir si le Traité de Sèvres est encore en vigueur,
avec la dissolution de la SDN, la seconde guerre mondiale, la
création de l’ONU, seuls, en droit international, à notre
connaissance le Traité de Lausanne de 1923 et le statut des îles
d’Åland de 1921 qui datent de l’époque de la SDN sont encore en
vigueur. Le Traité de Lausanne reprendrait donc le Traité de Sèvres
en ce qu’il fixe le régime juridique de protection des minorités non
musulmanes de Turquie et celle de la minorité musulmane en Grèce (en
Thrace).
Pour finir, dans sa
troisième et dernière partie, l’auteur aborde la question de la
compatibilité de la Sharia avec les traités internationaux
actuels et notamment la Convention européenne des droits de l’Homme
tant en ce qui concernerait le déroulement des actions judiciaires
des tribunaux religieux telle que l’audience et la comparution des
deux parties en cause devant eux (la comparution ne semble pas
toujours obligatoire en droit musulman, des décisions peuvent être
prises telles que par exemple lors de la dissolution du mariage par
simple déclaration de l’époux, sans que l’autre conjoint ait été
entendue et ne soit présente) qu’en ce qui concerne l’égalité des
sexes et la protection de l’enfant plus particulièrement.
Hélène APCHAIN
|
|

|
|
MAHIOU (Ahmed),
“La Charte arabe des droits de l’Homme”, in : L’évolution du Droit
international. Mélanges offerts à Hubert Thierry, Paris : Pédone,
1998, pp. 305-320.
D’emblée, l’auteur nous
explique que la genèse de la Charte arabe est à rechercher dans la
convergence d’une double pression, extérieure et intérieure. Le contexte
international qui tend à affirmer les droits de l’Homme comme un aspect de
plus en plus important du standard des normes régissant les relations
inter-étatiques aurait ainsi contraint les pays arabes à s’aligner sur ces
nouvelles priorités de la communauté internationale. L’adoption de la
Déclaration des droits de l’Homme en Islam par l’OCI dont tous les États
arabes sont membres a exercé aussi une influence sur le processus de mise
en oeuvre de la Charte arabe, libérant en quelques sorte les dernières
réticences. Cette Déclaration à laquelle tous les États arabes ont
souscrit permettait ainsi de dégager un cadre conceptuel régional pour
les droits de l’Homme dont allait s’inspirer la Charte comme l’illustre la
référence dans le préambule au texte de l’OCI. Mais c’est à l’intérieur
des États arabes qu’un changement significatif se produit avec la
structuration d’un discours revendicateur des droits de l’Homme émanant
d’acteurs sociaux de plus en plus audacieux et plus précisément
d’organisations indépendantes de défense des droits de l’Homme. La Charte
arabe qui est le fruit d’un long mûrissement dans le cadre de la
Commission des droits de l’Homme de la Ligue instituée en 1968 sera
adoptée en septembre 1994. Les rédacteurs de la Charte arabe ont voulu
inscrire leur initiative dans la continuité de la Déclaration universelle,
des Pactes de 1966 et de la Déclaration islamique de 1990. Par rapport à
cette dernière, l’auteur estime que la Charte arabe constitue une
“importante avancée” y voyant la marque de l’influence du courant
moderniste ou progressiste. Mais la Charte arabe se heurte à la difficulté
structurelle de concilier la plénitude des droits de l’Homme avec les
prescriptions de la Chariaâ qui constitue un corpus de règles
irréductibles du droit musulman.
D’emblée les rédacteurs de
la Charte situent le cadre conceptuel dans lequel doivent s’inscrire les
droits de l’Homme en terre arabe en soulignant l’importance des droits
collectifs à travers la référence aux droits des peuples, à la famille
mais aussi ce qui est plus étonnant, au “droit des minorités de bénéficier
de leur culture et de manifester leur religion par le culte et
l’accomplissement des rites”. En revanche la catégorie des règles à usage
individuel est relativement restreinte quant elle n’est pas “incertaine”
pour reprendre l’expression de l’auteur. Les règles ressortissant de l’habeas
corpus sont affirmées même si la formule retenue pour l’interdiction
de la torture et des traitements inhumains et dégradants est en recul par
rapport à la définition qu’en apporte la Convention internationale de
1984. Ceci est dû au fait que pour des pays comme l’Arabie saoudite les
châtiments corporels ou les mutilations prévues par la législation pénale
islamique n’entrent pas dans les catégories prévues par ladite Convention.
Quant à l’égalité homme-femme si elle révèle une certaine souplesse et
ouverture de la Charte par rapport au droit islamique, elle n’en reste pas
moins évoquée de manière générale et abstraite, les États comme le
souligne l’auteur restant tributaires des prescriptions de la Chariaâ.
L’auteur en conclut que
“la panoplie des droits reconnus par la Charte doit être évaluée à la
lumière de tout un contexte où d’autres facteurs s’ajoutent aux éléments
de droit positif pour aboutir, explicitement ou implicitement, à en
réduire le champ d’exercice, voire à les remettre en cause notamment par
le biais de dérogations”. En définitive, cette lecture très stimulante de
la Charte arabe des droits de l’Homme nous confirme l’ampleur des
obstacles et des contradictions d’essence religieuse et politique auxquels
est confronté toute entreprise de promotion des droits de l’Homme dans
cette région du monde. Quand on considère que la majorité des États arabes
restent dans les faits peu perméables au standard universel des droits de
l’Homme on ne peut qu’être sceptique quant à l’efficacité d’un texte qui
au-delà de son importance symbolique risque d’apparaître comme un
instrument destiné à dédouaner des régimes qui à un titre ou à un autre
ont quelque chose à se reprocher dans ce domaine.
A.
B.
|
|

|
|
MAYER (Ann
Elisabeth),
Islam and Human Rights: Tradition and Politics, Boulder : Westview
Press & London : Pinter Publishers, 1995, 2nd ed., 223 p.
Ann Elisabeth Mayer qui
est Professeur de Droit à l’Université de Pennsylvanie et spécialiste du
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord nous plonge dans un livre très
argumenté et très documenté. C’est une étude comparative de la formulation
des droits civils et politiques en droit international et du point de vue
islamique. Elle nous prévient que la référence à l’Islam dans le titre de
l’ouvrage ne signifie nullement que l’Islam est monolithique par rapport à
sa conception des droits de l’Homme, mais que cette religion à l’instar
des autres grandes religions concerne des pratiques et des traditions
souvent anciennes et complexes. Elle constate qu’en dépit d’une foi
unique, la position des musulmans à l’égard des droits de l’Homme est très
variable allant d’un rejet pur et simple à une adhésion sincère. Mais ce
qui différencie fondamentalement les approches des musulmans de celles des
Occidentaux, c'est que les premiers se réfèrent systématiquement aux
principes religieux et aux interprétations des sources islamiques pour
soutenir ou condamner les droits de l’Homme.
Cet ouvrage se décompose
en dix chapitres qui abordent la question des droits de l’Homme et de
l’Islam sous différents aspects. Les trois premiers portent sur les
similitudes et les différences entre le droit international et le droit
islamique des droits de l’Homme du point de vue de leurs sources et des
contextes historiques qui les ont vu naître et évoluer. Les chapitres 4 à
8 traitent des questions sensibles et conflictuelles relatives aux
discriminations à l’égard des femmes et des non-musulmans ainsi que de la
liberté de religion. Dans les deux derniers chapitres, l’auteur fait un
bilan de la mise en oeuvre des droits de l’Homme en Islam du point de vue
conceptuel insistant en particulier sur ce qu’elle qualifie de
“Culture-Based Resistance to Rights”. Contrairement aux précédents qui
reprennent le débat connu sur la difficulté à concilier principes du droit
international des droits de l’Homme et principes islamiques, les deux
derniers chapitres revêtent un intérêt particulier en ce qu’ils expriment
l’apport théorique de l’auteur à une problématique largement abordée.
Avec un sens certain de la
mesure pour une Américaine, on nous rend compte du lourd contentieux qui
caractérise les rapports entre ”Occident” et “Orient” qui s’exprime
aujourd’hui par la référence au “double standard” dans la mise en oeuvre
du droit international y compris dans le domaine des droits de l’Homme. Se
référant en particulier à la thèse d’Edward Said sur l’Orientalisme,
elle rend compte de l’expérience globalement négative que le monde
musulman a eu de l’Occident. Dès lors les droits de l’Homme pouvaient
apparaître pour de nombreux musulmans comme une nouvelle initiative
occidentale aux intentions douteuses car visant à évaluer les normes
islamiques par rapport à leur conformité au droit international qui est
considéré par de nombreux juristes musulmans comme étant d’essence
occidentale. Dès lors, pour l’auteur on peut expliquer l’émergence dans le
monde musulman d’une résistance à fondement culturel aux droits de
l’Homme. Celle-ci serait principalement animée par des courants de pensée
musulmans qui ont imposé une interprétation discutable des sources
islamiques. Nous partageons le constat selon lequel le bilan négatif des
droits de l’Homme dans le monde musulman serait moins le fait d’une
incompatibilité inhérente de l’Islam et des droits de l’Homme, mais le
résultat du travail des élites conservatrices - les bénéficiaires des
systèmes politiques autoritaires - qui légitiment leur opposition aux
droits de l’Homme par la référence à une spécificité culturelle. Mais
l’auteur oublie de mentionner que cette “résistance culturelle” animée par
les courants les plus conservateurs s’inscrit dans un phénomène plus
vaste, la dynamique de résistance à la mondialisation et à la
modernisation dont la portée va bien au-delà de la question des droits de
l’Homme.
Ann Elisabeth Mayer a le
mérite de se référer à une documentation diversifiée autant que pertinente
constituée non seulement d’une littérature anglo-saxonne dense mais aussi
aux programmes de partis politiques se revendiquant de l’Islam, des
constitutions et lois fondamentales de certains pays musulmans (Iran,
Arabie Saoudite), de la Déclaration du Caire et des écrits de spécialistes
éminents de la doctrine islamique (Mawdudi et Tabandeh), y compris d’Al-Azhar.
En cela, l’ouvrage de A.E. Mayer est une référence relativement complète
pour ceux qui désirent avoir une vue d’ensemble du point de vue juridique
sur la problématique “Islam et droits de l’Homme”.
A.
B.
|
|

|
|
MAYER (Ann
Elisabeth),
“Universal versus Islamic Human Rights: a Clash of Cultures or a Clash
with a Construct ?”, Michigan Journal of International Law, vol.15,
Winter 1994, pp. 307-404.
Ann Elisabeth Mayer s’est
incontestablement imposée comme une des spécialistes américaines des
droits de l’Homme en Islam à travers ses nombreux ouvrages et articles sur
la question. Dans cette étude très fouillée enrichie par de nombreuses
références bibliographiques, elle analyse le système des droits de l’Homme
dans le contexte islamique faisant ressortir son particularisme par
rapport au système universel. La spécificité des droits de l’Homme en
Islam illustre moins un conflit de culture (“a Clash of Cultures”)
qu’une alternative à l’universalisme; Elle insiste aussi sur le fait que
contrairement aux apparences, le monde musulman n’est pas un bloc
monolithique. Quelle est la place des droits de l’Homme dans la tradition
juridique islamique? Comment des éléments purement islamiques ont été
combinés avec les principes universels des droits de l’Homme ?
A propos de la thèse du
“Clash des civilisations”, elle réfute la position de Samuel Huntington
selon laquelle les Occidentaux devraient s’interdire d’insister sur
l’universalité des droits de l’Homme au risque d’offenser les autres
cultures et d’alimenter le fondamentalisme. Elle répond que les musulmans
ne sont pas hostiles par principe aux droits de l’Homme mais à la
politique du double standard dans ce domaine des gouvernements occidentaux
(p.313). L’adoption par les pays musulmans de leur propre Déclaration des
droits de l’Homme (Déclaration du Caire) comme alternative à la
Déclaration universelle exprime non un refus des droits de l’Homme mais la
volonté de les inscrire dans un système de valeur islamique qui se
distinguerait des valeurs judéo-chrétiennes. L’auteur nous rappelle que la
principale lacune de la conception islamique des droits de l’Homme réside
dans la non-reconnaissance de la liberté de changer de religion et de
l’égalité homme-femme. Elle note fort pertinemment que les juristes
musulmans ainsi que les textes islamiques concernant les droits de l’Homme
(Constitutions et déclarations) ne rejettent pas ouvertement et
explicitement l’égalité homme-femme mais le plus souvent la conditionnent
au respect des normes islamiques qui prévalent sur les différents droits
et libertés.
L’auteur procède à une
lecture minutieuse de la Déclaration du Caire sur les droits de l’Homme en
Islam (1990) et de la loi fondamentale de l’Arabie Saoudite (1994) d’un
point de vue comparatif, s’efforçant de dégager la compatibilité ou non
des droits qui y sont énoncés avec ceux proclamés dans les textes
internationaux (droits de la femme, liberté de religion, code pénal...).
Toutefois, ces deux textes font de nombreux emprunts au modèle occidental
des droits de l’Homme et paradoxalement s’inspirent de manière sélective
de l’héritage purement islamique. Mais, le drame dans ce débat est que les
musulmans du monde n’ont jamais été invités à se prononcer sur les droits
et libertés qu’ils désirent se voir reconnaître par leur gouvernements et
sur le caractère “islamique” ou non de tel ou tel droit de l’Homme. Ann
Elisabeth Mayer soulève ici la véritable question dans ce débat très
complexe sur Universalisme versus particularisme islamique.
A. B.
|
|

|
|
MEHRPOUR (Hossein),
“Islam and Human Rights”, The Iranian Journal of International Affairs,
vol.VIII, n°4, Winter 1996-97, pp. 729-760.
Après avoir dressé un
historique sur l’apparition du terme “droits de l’Homme” dans des textes
constitutionnels et en particulier la Déclaration française de 1789,
l’auteur - professeur de droit à l’Université Beheshti de Téhéran, nous
livre sa réflexion sur la conception des droits de l’Homme en Islam.
L’auteur procède à une comparaison entre les standards universels des
droits de l’Homme et les principes et concepts de l’Islam dans ce domaine.
Les principes de liberté et d’égalité qui sont à la base de la Déclaration
universelle sont analysés du point de vue islamique. Ainsi, le premier
facteur de confrontation entre conceptions universelle et islamique porte
sur l’esclavage que le Coran autorise explicitement en posant certaines
conditions de traitement humain et en encourageant leur libération. Cette
tolérance à l’égard de l’esclavage s’expliquerait selon l’auteur par les
conditions historiques qui prévalaient dans les sociétés arabes
préislamique ou l’esclavage était institutionnalisé. A l’en croire, le
Coran n’a fait que codifier une pratique sociale dominante, l’esclavage
devenant un “phénomène accidentel et non naturel”. Dès lors comme le
relève Sami Aldeeb Abu Sahlieh il y a une ambiguïté de l’Islam à l’égard
de l’esclavage qui tout en étant reconnu ne pouvait être considéré comme
légitime vu l’encouragement à la libération des esclaves. Mais nous ne
pouvons pas contrairement à Abu Sahlieh et Mehrpour interpréter pour
autant cette ambiguïté comme suggérant l’éradication de l’esclavage. De
même l’affirmation selon laquelle l’esclavage n’était permis qu’à l’égard
des infidèles capturés au combat est discutable quant on considère
la condition des concubines qui de surcroît n’étaient pas toutes des
non-musulmanes.
Abordant les libertés au
sens civil et politique énoncées dans la Déclaration universelle des
droits de l’Homme et le Pacte international de 1966, l’auteur considère
qu’il y a globalement compatibilité entre l’Islam et les instruments
internationaux. Il en veut pour preuve le fait que l’Islam reconnaît le
droit des Musulmans à participer aux affaires publiques, d’exprimer leurs
opinions, voir de critiquer la manière de gouverner. L’auteur cite pour
illustrer son propos le gouvernement islamique sous les quatre premiers
califes fondé sur la concertation et le refus du despotisme. Mais le
martyre de Ali marque la fin de cette expérience et l’avènement d’un
“gouvernement aux méthodes despotiques ”. La question de la liberté
religieuse est également abordée d’un point de vue comparatif pour
souligner que l’Islam n’admet pas de contrainte en religion, ni
l’imposition d’une croyance. Mais il tempère cette affirmation en
reconnaissant, citation de versets du Coran à l’appui, que la vérité
réside dans le message coranique. Il est tout de même décevant que
l’auteur n’ait pas abordé sur le fond la question de la liberté de changer
de religion qui en vertu d’une lecture littérale des textes islamiques est
assimilée à l’apostasie, crime suprême au plan religieux.
La primauté donnée au
message coranique expliquerait tout naturellement que les adeptes de ce
message ne pourraient être mis sur le même plan que les non-musulmans qui
seraient en quelque sorte dans l’erreur. Dès lors la non-discrimination
sur une base religieuse en terre d’Islam s’avère difficile à respecter.
Elle s’exprime à travers des règles civiles ou pénales en vertu desquelles
par exemple un non-musulman ne peut hériter d’un musulman ou une musulmane
ne peut épouser un non croyant; le contraire étant possible. Cette
dernière règle nous amène naturellement à évoquer la question du statut
inférieur de la femme en Islam. Mehrpour reconnaît que c’est sur la
question de l’égalité homme-femme que se situe la contradiction majeure
entre les conceptions universelles et islamiques des droits de l’Homme.
Donnant un bref aperçu des inégalités de droits - la responsabilité
familiale repose sur l’homme, la femme ne peut hériter que l’équivalent de
la moitié de la part qui revient à l’homme - l’auteur l’attribue non à une
volonté de discriminer la femme mais à des causes naturelles
essentiellement d’ordre physique. Ce serait donc dans “la nature des
choses” que l’homme ait à assumer des responsabilités et par conséquent
des droits supérieurs à ceux reconnus à la femme. Mais cela ne
signifierait pas selon l’auteur que ces deux êtres n’aient pas une “égale
valeur humaine” ou un mérite équivalent. Toutefois l’affirmation selon
laquelle la différence homme-femme en droit musulman n’est pas basée sur
une discrimination sexuelle, mais sur une division des tâches et des
responsabilités, est discutable. Comment expliquer, par exemple, que le
témoignage de deux femmes équivaut à celui d’un homme, dès lors qu’on
reconnaît un égal mérite et une égale valeur humaine aux deux sexes ?
L’auteur a le mérite
d’entrouvrir une porte lorsqu’il admet la possibilité de réformer les lois
islamiques pour les mettre en conformité avec l’époque mais sans affecter
la “vision originelle de l’Islam”. En l’absence d’une définition des
principes originels, cette affirmation apparaît comme un vœux pieux. Sans
être totalement convainquant cet article a le mérite de faire le point et
de poser de véritables questions sur les contradictions entre
universalisme et relativisme sans toujours apporter les réponses
attendues. Mais tel n’était peut être pas l’ambition de l’auteur.
A. B.
|
|

|
|
TAVERNIER (Paul),
”L’ONU et l’affirmation de l’universalité des droits de l’Homme“, Revue
trimestrielle des droits de l’Homme, n°31, juillet 1997, pp. 379-393.
Paul Tavernier, directeur
du Centre d’Études et de Recherches sur les droits de l’Homme et le droit
humanitaire (CREDHO), nous livre ici son analyse sur le cheminement du
concept d’universalité des doits de l’Homme, les résistances à son
affirmation et en fin de compte son affermissement. Cet article se compose
de deux parties. Dans la première on présente les différents discours
contestataires de l’universalisme qu’ils soient d’essence régionaliste ou
confessionnelle et culturaliste. Dans la deuxième partie l’auteur fait le
constat d’une évolution globalement favorable à l’universalisme des droits
de l’Homme.
Les rédacteurs de la
Déclaration des droits de l’Homme de 1948 (René Cassin) attachaient une
grande importance à son caractère universel ce qui n’était pas évident à
l’époque en raison de la méfiance des pays socialistes. La “coexistence et
l’harmonie” des systèmes régionaux et universels de protection des droits
de l’Homme si elle est une réalité dans le cas de l’Europe - la
Convention européenne des droits de l’Homme s’inscrivant dans la
lignée de la Déclaration universelle - n’ont pas toujours été
aisées. C’est en particulier le cas de la Charte africaine des droits
de l’Homme et des peuples qui marque sa spécificité par rapport à
l’universalisme à travers la référence aux valeurs de la tradition et de
la civilisation africaine ainsi qu’aux devoirs de l’individu à l’égard de
l’État, de la communauté et de la famille. La Charte arabe des droits
de l’Homme affirme également sa spécificité en insistant, nous
rappelle l’auteur, sur les “principes éternels définis par le droit
musulman”. Mais ces deux textes ne remettent pas en cause l’universalité
des droits proclamés dans la Déclaration de 1948. Ce n’est pas le cas des
conceptions confessionnelles et culturalistes des droits de l’Homme qui
s’inscrivent à contre-courant de l’universalisme. Ainsi la problématique
essentiellement religieuse dans laquelle s’insère la Déclaration
islamique universelle des droits de l’Homme (Conseil islamique pour
l’Europe, 1981) - à laquelle il faudrait ajouter la Déclaration des
droits de l’Homme en Islam de l’OCI que l’auteur a omit de mentionner
- réduit les droits de l’Homme à n’être que des garanties d’essence
religieuse. Ce qui a pour conséquence, comme le dit fort justement Paul
Tavernier, une interprétation des droits reconnus “dans un sens qui
risque fort de contredire celui qui est admis sur le plan universel”.
L’auteur termine son
analyse sur une note optimiste lorsqu’il nous réconforte sur la
consolidation de l’universalisme en dépit des tentatives faites notamment
par des États asiatiques au cours de la Conférence de Vienne (1993) pour
imposer la reconnaissance d’un relativisme culturel qui assurerait
à ces États un régime particulier de dualité des normes.
En définitive cet article
fait le point sur la problématique universalisme versus culturalisme
des droits de l’Homme, une question que d’aucuns croiraient résolue par la
Conférence de Vienne, mais qui au-delà des discours et des textes
juridiques est quotidiennement remise en cause par les pratiques des États
qui s’appuient sur une interprétation conservatrice des traditions
religieuses et culturelles conçues comme un instrument de marginalisation
de la société civile et un alibi pour le maintien de régimes autoritaires.
Mais c’est cela qui fait de la promotion des droits de l’Homme un
travail de Sisyphe.
A.
B.
|
|

|
|
TAVERNIER (Paul),
“Les États arabes, l’O.N.U. et les droits de l'Homme”, Les Cahiers de
l’Orient, n°19, 3ème trimestre 1992, pp. 183-197 [Etude reproduite
dans : Conac (Gérard) et Amor (Abdelfattah) (dir.), Islam et droits de
l'Homme, Paris : Economica, 1994, pp. 57-72.
L’auteur précise dès le
début le contexte dans lequel il situe sa contribution: “On souligne
souvent la contradiction - voire l’incompatibilité absolue - qui
existerait entre la doctrine des droits de l’Homme, d’origine
essentiellement laïque, issue de la philosophie des Lumières du XVIIIème
siècle européen, et la doctrine islamique, d’essence purement religieuse,
expression de la révélation divine faite au Prophète Mahomet, il y a
quatorze siècles dans le Coran et dont les préceptes demeurent toujours
valables. Certes, il s’agit d’un vaste débat, qui ne sera pas clos de
sitôt. Toutefois, dans cette perspective, il peut être intéressant
d’observer quelle a été l’attitude des États arabes vis à vis des textes
adoptés au sein de l’Organisation des Nations-Unies en matière de droits
de l’Homme”.
Cette étude est articulée
en deux parties, dans la première l’auteur traite de l’attitude des États
membres de la Ligue arabe avant et après l’adoption de la Déclaration
universelle de 1948, la seconde porte sur la position de ces pays à
l’égard des Pactes de 1966. Entre ces deux dates constate l’auteur la
position des États arabes a évolué dans le sens d’une plus grande
ouverture.
Lors de l’adoption de la
Déclaration universelle, la position des six États arabes membres à
l’époque des Nations-Unies révélait une certaine diversité: quatre voix en
faveur (Égypte, Irak, Liban et Syrie), une opposition (Arabie Saoudite) et
une absence au vote (Yémen). Ces positions doivent être appréciées par
rapport au contexte de l’époque. Si Paul Tavernier semble lier le vote
positif de l’Égypte et du Liban à leur participation active à la rédaction
de la Déclaration et celui de l’Arabie saoudite et du Yémen à des
considérations religieuses, aucune raison n’est donnée quant à l’adhésion
de l’Irak et de la Syrie dont il faudrait rechercher l’explication non
seulement dans les options modernistes de ces deux pays, mais aussi dans
leur caractère multiconfessionnel (Chrétiens, Juifs, Chi’ites et
Allaouites coexistant avec une majorité Sunnite). C’est une
explication tout aussi valables pour l’Égypte et le Liban.
Le fait qu’aucun vote
négatif arabe n’ait été répertorié lors de l’adoption par l’Assemblée
générale des Nations-Unies des deux Pactes de 1966 s’expliquerait pour
l’auteur par l’absence de toute référence à la religion contrairement à ce
qui s’était fait dans la Déclaration de 1948. Mais, Paul Tavernier nous
précise que la signature des Pactes ne signifie pas pour autant une
adhésion aux mécanismes de contrôle révélant une “certaine méfiance de la
part des États arabes, à l’égard des procédures de mise en oeuvre des deux
pactes, et notamment du pacte relatif aux droits civils et politiques qui
a le mérite d’avoir prévu la création d’un Comité des droits de l’Homme”,
constatant toutefois que cette méfiance “est moins systématique que celle
d’autres groupes d’États”. Il est vrai que si l’adhésion de l’Algérie, de
la Libye et de la Somalie au Protocole 1 du Pacte sur les droits civils et
politiques (1989) fut significative à l’époque, la suite des événements a
mis en exergue son coté paradoxal. Quant à la question des rapports
l’auteur note les retards mis par la plupart des États arabes dans la
remise de leurs rapports périodiques en notant toutefois que ces retards
regrettables “ne sont pas l’apanage des États arabes”.
Les problèmes de mise en
oeuvre des deux Pactes s’expliqueraient par la “difficile conciliation”
entre les impératifs de la Chariaâ et les normes universelles des
droits de l’Homme. Ainsi, les États arabes ont fréquemment recours à des
réserves ou des déclarations interprétatives pour limiter le champ
d’application des normes onusiennes dans les domaines qui relèvent
totalement ou partiellement de la loi islamique. Toutefois même dans ce
domaine il n'y a pas une position unifiée des pays arabes, certains plus
que d’autres insistant sur les prescriptions de la Chariaâ. C’est
une question complexe qui révèle l’absence de consensus parmi les juristes
musulmans qui a pour conséquence on le voit de créer une situation
complexe ou prévaut un double système de normes au champ d’application
imprécis car investissant pratiquement toutes les branches du droit
(civil, pénal, constitutionnel). Un travail de réforme doctrinal auquel a
procédé par exemple l’Église catholique depuis le Concile Vatican II
aurait certainement permis aux musulmans de solutionner ces contradictions
et d’adapter l’Islam aux impératifs de la modernité, mais là s’ouvre un
autre débat dans lequel l’auteur a évité de s’engager pour des raisons
compréhensibles. Il n’en demeure pas moins que cette contribution revêt un
intérêt certain pour ceux qui veulent mieux appréhender la variété des
attitudes, et parfois la subtilité avec laquelle les États arabes se sont
insérés dans une négociation à l’ONU, en faisant souvent preuve d’un
esprit coopératif sur une question qui a priori les plaçait en porte à
faux.
A. B.
|
|

|
|
TIBI (Bassam),
“Islamic Law/Shari’a, Human Rights, Universal Morality and
International Relations” Human Rights Quarterly, vol.16, n°4,
November 1994, pp. 277-299.
Pour l’auteur, qui situe
son article dans une perspective de relations internationales plus que de
droit, la valeur morale des droits de l’Homme représente un élément de
convergence du système international capable d’éviter le conflit de
civilisations (cher au Professeur Samuel Huntington et que recherchent les
fondamentalistes musulmans (Muslim fundamentalists) et de voire
naître une société internationale au sens où l’entendait Hedley Bull.
Reconnaissant que les droits de l’Homme sont d’origine européenne et que
les États occidentaux ont pu s’en servir comme d’une arme contre les pays
du Tiers-Monde, M.. Tibi n’en considère pas pour autant que le concept
même de droits de l’Homme doive être rejeté, puisque, tels que définis
dans la Déclaration universelle de 1948 et les Pactes de 1966, ils ont une
valeur transculturelle. A notre époque marquée à la fois par une
mondialisation structurelle et une fragmentation culturelle, il est
possible, et même indispensable, de rejeter l’hégémonie occidentale tout
en acceptant les bienfaits de la modernité culturelle dont font partie les
normes juridiques et les valeurs éthiques universelles des droits de
l’Homme qui ne doivent pas être confondues avec la puissance politique de
l’Occident. La Chariaâ étant incompatible avec les droits de
l’Homme, les musulmans doivent entreprendre des accommodations modernistes
de l’Islam., non en tant que foi mais en tant que système culturel et
juridique, afin d’y établir les droits de l’individu et de se débarrasser
du concept de devoirs (fara’id) vis-à-vis de La communauté (oumma).
Réfutant la tendance culturaliste, M. Tibi avoue sa foi weberienne en la
science occidentale moderne comme seule universellement valide et
considère qu’on peut parfaitement juger l’Islam d’après les critères du
monde moderne. Ce n’est qu’en abandonnant leur Weltanschauung
(expression utilisée par l’auteur en allemand dans le texte) prémoderne
au profit d’une vision du monde individualiste (en puisant dans
l’hellénisme musulman) que l’Islam pourra se concilier avec les droits de
l’Homme en tant que norme commune de la société internationale.
Ph. G.
|
|

|
|
WESTBROOK
(David A.),
“Islamic International Law and Public International Law : Separate
Expressions of World Order”, Virginia Journal of International Law,
vol.33, 1993, pp. 819-897.
Pour l’auteur, chercheur
libre à l’Université catholique de Louvain, qui ne se considère pas comme
un orientaliste (et critique l’approche du Pr Joseph Schacht, pp.891-893)
mais s’affirme disciple du Pr. Frank Vogel d’Harvard, seul l’Islam peut
fournir une vision du monde différente de la vision libérale qu’offre le
droit international public. Il s’interroge sur le point de savoir si le
droit international islamique et le droit international public peuvent
dialoguer. Après une substantielle présentation de la littérature
juridique islamique (pp.823-859), où il note que l’Islam distingue le
monde de la guerre (dar al-harb) et le monde de l’Islam (dar
al-Islam), mais oublie d’évoquer le monde de la conciliation (dar
al-sulh),
M. Westbrook considère
qu’exceptés quelques grands principes (pacta sunt servanda, bonne
foi, autodétermination), le droit islamique (plus précisément le siyar)
et le droit international ne convergent que dans le droit de la guerre (jus
ad bellum comme jus in bello). En ce qui concerne le droit de
la paix, les deux concepts sont inconciliables : tandis que le droit
international public, qui est une entreprise constitutionnelle d’essence
laïque, ne tient pas compte de l’histoire mais chercherait à établir un
avenir meilleur par la négociation et non par rapport à un ordre naturel,
le droit islamique, profondément enraciné dans l’histoire, ne peut
concevoir la paix qu’à travers le prisme du droit islamique lui-même et,
ne connaissant pas de mythe constitutionnel, est incapable d’exprimer les
préoccupations institutionnelles du droit international dans le
vocabulaire de la Chariaâ. La structure du discours juridique
islamique s’avère donc inadaptée à l’articulation du droit international
public. Le fiqh et le droit international ne peuvent qu’entretenir
un dialogue de sourds. Pour que le droit islamique puisse répondre aux
questions soulevées par le droit international, il faudrait trouver dans
le discours de l’Islam le moyen de traiter adéquatement de la légitimité
et de l’autorité des institutions (notamment de la nation), d’envisager le
droit comme un processus de mise en place d’un régime politique (polity)
et de développer une théorie de l’autorité politique. Conscient de son
manque de qualification pour entreprendre une telle réforme de la pensée
islamique, M. Westbrook s’abstient alors de formuler des propositions en
ce sens qui doivent émaner de juristes musulmans.
Ph.
G.
|
|

|
|
YACOUB (Joseph),
Réécrire la Déclaration universelle des droits de l’Homme, Paris :
Desclée de Brouwer, 1998, 108 p.
Ce petit ouvrage se veut
résolument critique du discours ambiant sur la Déclaration universelle
des droits de l’Homme. L’auteur, professeur de sciences politiques à
l’Université catholique de Lyon fonde sa thèse sur l’idée que la
Déclaration “onusienne” de 1948 “a la couleur de son temps (1945) et la
saveur de l’espace qui l’a vu naître - l’Occident”. Il constate que
“l’Occident a le don d’universaliser sa culture, de l’extraire de son
milieu et d’en faire une grille de lecture formalisée des autres
sociétés”. En effet, nous précise-t-il de “par leur source, leur contenu
et leurs bases, les droits de l’Homme sont un produit philosophique,
conceptuel, juridique et politique, institutionnel et éthique de
l’Occident”. On retrouve ici la thèse de l’approche culturaliste ou de la
spécificité régionale qui ne voit dans l’universalisme qu’un paravent
destiné à masquer l’occidentalisme.
Joseph Yacoub voit se
dessiner une nouvelle dynamique de la problématique des droits de l’Homme
face à l’émergence de nouveaux défis tels que le droit des peuples, des
minorités et des peuples autochtones, le droit au développement et à
l’environnement. Ces nouveaux défis sont révélateurs non seulement de la
dimension communautaire de l’Homme mais aussi de l’indivisibilité et de
l’interdépendance des droits de l’Homme “dans une diversité des cultures,
une pluralité des civilisations et une relativité/universalité des
valeurs”.
On ne peut qu’être
convaincu par certains arguments sur les insuffisances structurelles du
mécanisme international des droits de l’Homme qui a toujours des
difficultés à concilier protection des individus et respect souveraineté
des États - le premier impératif étant souvent sacrifié au profit du
second - et surtout “n’a pratiquement pas de valeur exécutoire et est
rédigé de manière à faciliter le consensus des pouvoirs politiques ”.
Mais, dans son “culte” des droits “communautaires”, l’auteur ne
risque-t-il pas de réduire les droits individuels à un résidu marginal.
Car en définitive, c’est au niveau de l’individu qu’est vécu l’expérience
des droits de l’Homme, loin des schéma abstraits et politisés que l’auteur
lui-même dénonce. On objectera qu’enfermer les droits de l’Homme dans un
cadre collectif, n’est-ce pas les rendre plus abstraits moins
perceptibles, plus délocalisés ?
L’auteur apporte sa
contribution en annexant un “projet de déclaration universelle des droits
de l’Homme” censée concrétiser cette réécriture du texte de 1948 qu’il
appelle de ses vœux. Cet essai qui se situe d’emblée à contre courant de
la “pensée unique” a surtout le mérite d’animer le débat sur la
Déclaration universelle de 1948 au moment ou l’on fête son 50ème
anniversaire.
A. B.
|
|

|
|
|